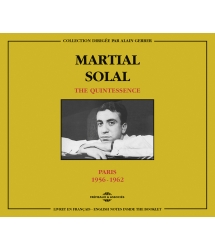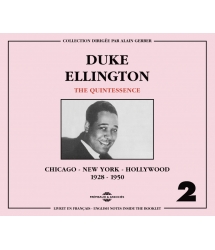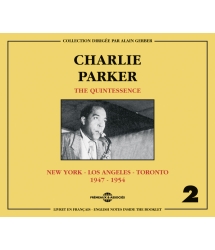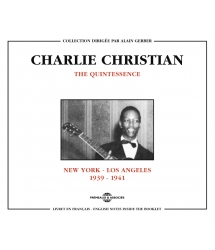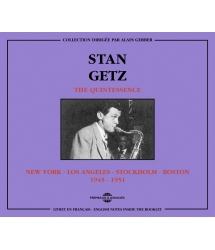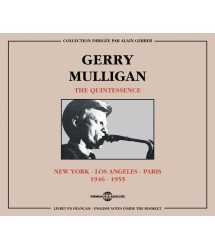- Our Catalog
- Philosophy
- Philosophers of the 20th century and today
- History of Philosophy (PUF)
- Counter-History and Brief Encyclopedia by Michel Onfray
- The philosophical work explained by Luc Ferry
- Ancient thought
- Thinkers of yesterday as seen by the philosophers of today
- Historical philosophical texts interpreted by great actors
- History
- Books (in French)
- Social science
- Historical words
- Audiobooks & Literature
- Our Catalog
- Jazz
- Blues
- Rock - Country - Cajun
- French song
- World music
- Africa
- France
- Québec / Canada
- Hawaï
- West Indies
- Caribbean
- Cuba & Afro-cubain
- Mexico
- South America
- Tango
- Brazil
- Tzigane / Gypsy
- Fado / Portugal
- Flamenco / Spain
- Yiddish / Israel
- China
- Tibet / Nepal
- Asia
- Indian Ocean / Madagascar
- Japan
- Indonesia
- Oceania
- India
- Bangladesh
- USSR / Communist songs
- World music / Miscellaneous
- Classical music
- Composers - Movie Soundtracks
- Sounds of nature
- Our Catalog
- Youth
- Philosophy
- News
- How to order ?
- Receive the catalog
- Manifesto
- Dictionnary











- Our Catalog
- Philosophy
- Philosophers of the 20th century and today
- History of Philosophy (PUF)
- Counter-History and Brief Encyclopedia by Michel Onfray
- The philosophical work explained by Luc Ferry
- Ancient thought
- Thinkers of yesterday as seen by the philosophers of today
- Historical philosophical texts interpreted by great actors
- History
- Books (in French)
- Social science
- Historical words
- Audiobooks & Literature
- Our Catalog
- Jazz
- Blues
- Rock - Country - Cajun
- French song
- World music
- Africa
- France
- Québec / Canada
- Hawaï
- West Indies
- Caribbean
- Cuba & Afro-cubain
- Mexico
- South America
- Tango
- Brazil
- Tzigane / Gypsy
- Fado / Portugal
- Flamenco / Spain
- Yiddish / Israel
- China
- Tibet / Nepal
- Asia
- Indian Ocean / Madagascar
- Japan
- Indonesia
- Oceania
- India
- Bangladesh
- USSR / Communist songs
- World music / Miscellaneous
- Classical music
- Composers - Movie Soundtracks
- Sounds of nature
- Our Catalog
- Youth
- Philosophy
- News
- How to order ?
- Receive the catalog
- Manifesto
- Dictionnary
LOS ANGELES - NEW YORK - STOCKHOLM (1952-1958)
STAN GETZ
Ref.: FA3061
Artistic Direction : ALAIN GERBER AVEC DANIEL NEVERS ET ALAIN TERCINET
Label : Frémeaux & Associés
Total duration of the pack : 2 hours 23 minutes
Nbre. CD : 2

LOS ANGELES - NEW YORK - STOCKHOLM (1952-1958)
LOS ANGELES - NEW YORK - STOCKHOLM (1952-1958)
“He would always remain, with a relentless determination that was sometimes heroic, Stanislas Stanley Getz “The Steamer”; in other words, one of the most generous purveyors of beauty known to the 20th century.” Alain GERBER
Frémeaux & Associés’ « Quintessence » products have undergone an analogical and digital restoration process which is recognized throughout the world. Each 2 CD set edition includes liner notes in English as well as a guarantee. This 2 CD set presents a selection of the best recordings by Stan Getz between 1952 and 1958.
-
PisteTitleMain artistAutorDurationRegistered in
-
1You Turned The Tables On MeStan Getz QuintetMitchell00:02:591952
-
2The Nearness Of YouStan Getz QuintetH. Carmichael00:03:441953
-
3PernodStan Getz QuintetJohnny Mandel00:06:501954
-
4It Don't Mean A ThingStan Getz, Dizzy Gillespie, Oscar Peterson TrioE. Ellington00:06:431953
-
5Down By The Sycamore TreeStan Getz QuartetTraditionnel00:03:041954
-
6CherokeeStan Getz with Lionel HamptonR. Noble00:09:191955
-
7ShineStan Getz QuintetF.T. Dabney00:08:571955
-
8A Handfull Of StarsStan Getz QuintetTed Shapiro00:03:201955
-
9Over The RainbowStan Getz QuartetE.Y. Harburg00:05:241955
-
10Be BopStan Getz, Sonny Stitt, Dizzy Gillespie00:13:041956
-
11There'll Never Be Another YouStan Getz, Sonny Stitt, Dizzy GillespieH. Warren00:09:181956
-
PisteTitleMain artistAutorDurationRegistered in
-
1Blues For Mary JaneStan Getz Quartet00:07:531956
-
2You're BlaseStan Getz QuartetSiever00:04:131956
-
3Down BeatStan Getz Quartet00:04:471957
-
4I'M Glad There Is YouStan Getz, Oscar Peterson TrioJ. Dorsey00:04:411957
-
5Tin Roof BluesStan Getz, Herb Hellis QuintetW. Melrose00:03:021957
-
6This Can't Be LoveStan Getz Quintet, Gerry MulliganL. Hart00:08:481957
-
7A BalladStan Getz Quintet, Gerry Mulligan00:05:461957
-
8Half Breed ApacheStan Getz, Chet Baker00:14:531958
-
9My Funny ValentineStan Getz, J.J. Johnson, Oscar Peterson TrioL. Hart00:08:281957
-
10It Never Entered My MindStan Getz, J.J. Johnson, Oscar Peterson TrioL. Hart00:03:551957
-
11Stockholm StreetStan Getz & His Swedish Jazzmen00:04:181958
CLICK TO DOWNLOAD THE BOOKLET
Stan Getz Vol. 2 FA3061
COLLECTION DIRIGÉE PAR ALAIN GERBER
STAN GETZ
THE QUINTESSENCE
LOS ANGELES - NEW YORK - STOCKHOLM
1952-1958
LIVRET EN FRANCAIS - ENGLISH NOTES INSIDE THE BOOKLET
DISCOGRAPHIE / DISCOGRAPHY
CD 1 (1952-1956)
STAN GETZ QUINTET “Stan plays Getz”
Stanley “Stan” GETZ (ts) ; Duke JORDAN (p) ; Jimmy RANEY (g) ; Bill CROW (b) ; Frank ISOLA (dm). New York City, 12/12/1952.
1. YOU TURNED THE TABLES ON ME (Mitchell-Alter) (Norgran 128/mx.963) 2’56
STAN GETZ QUINTET “More West Coast Jazz”
Bob BROOKMEYER (vtb) ; Stan GETZ (ts) ; Johnny WILLIAMS (p) ; Teddy KOTICK (b) ; Frank ISOLA (dm). Los Angeles, 12/08/1953.
2. THE NEARNESS OF YOU (H.Carmichael-N.Washington) (Norgran 106/mx.1278) 3,40
STAN GETZ QUINTET “At The Shrine”
Bob BROOKMEYER (vtb) ; Stan GETZ (ts) ; Johnny WILLIAMS (p) ; Bill ANTHONY (b) ; Art MADIGAN (dm). Los Angeles (“Shrine Auditorium”), 8/11/1954.
3. PERNOD (J.Mandel) (Norgran MGN 2000-2) 6’45
DIZ & GETZ (GILLESPIE & STAN) with The OSCAR PETERSON TRIO
John B. “Dizzy” GILLESPIE (tp) ; Stan GETZ (ts) ; Oscar PETERSON (p) ; Herb ELLIS (g) ; Ray BROWN (b) ; Max ROACH (dm). Los Angeles, 9/12/1953.
4. IT DON’T MEAN A THING (E.Ellington-I.Mills) (Norgran MGN-3/mx.1368) 6’40
STAN GETZ QUARTET “& the Cool Sounds”
Stan GETZ (ts) ; Jimmie ROWLES (p) ; Bobby WHITLOCK (b) ; Max ROACH (dm). Los Angeles, 23/01/1954.
5. DOWN BY THE SYCAMORE TREE (Trad.) (Norgran 119 / mx.1497) 3’00
HAMP & GETZ (LIONEL HAMPTON & STAN GETZ) with Rhythm Section
Stan GETZ (ts) ; Lionel HAMPTON (vibes) ; Lou LEVY (p) ; Leroy VINNNEGAR (b) ; Shelly MANNE (dm). Los Angeles, 1/08/1955.
6. CHEROKEE (R.Noble) (Norgran MGN 1038/mx.2368-6) 9’17
STAN GETZ QUINTET / QUARTET “& The Cool Sounds”
Conte CANDOLI (tp sur/on 7) ; Stan GETZ (ts) ; Lou LEVY (p) ; Leroy VINNEGAR (b) ; Max ROACH (dm). Los Angeles, 15 & 19/08/1955.
7. SHINE (F.T.Dabney-J.Brown-C.Mack) (Norgran MGN 1032/mx.2433) 8’53
8. A HANDFUL OF STARS (T.Shapiro-J.Lawrence) (Verve MGV 8200/mx.2435) 3’17
STAN GETZ QUARTET “In Stockholm
Stan GETZ (ts) ; Bengt HALLBERG (p) ; Gunnar JOHNSSON (b) ; Anders BURMAN (dm). Stockholm, 16/12/1955.
9. OVER THE RAINBOW (H.Arlen-E.Y.Harburg) (Karusell KEP 304 & Verve MGV 8213) 5’22
SONNY STITT, STAN GETZ & DIZZY GILLESPIE “For Musicians Only”
Dizzy GILLESPIE (tp) ; Sonny STITT (as) ; Stan GETZ (ts) ; John LEWIS (p) ; Herb ELLIS (g) ; Ray BROWN (b)?; Stan LEVEY (dm). Los Angeles, 16/10/1956.
10. BE BOP (J.B.Gillespie) (Verve MGV 8198/mx.4029) 13’00
STAN GETZ QUARTET “The Steamer”
Stan GETZ (ts) ; Lou Levy (p) ; Leroy VINNEGAR (b) ; Stan LEVEY (dm). Los Angeles, 24/11/1956.
11. THERE’LL NEVER BE ANOTHER YOU (H.Warren-M.Gordon) (Verve MGV 8294/mx.4060) 9’15
DISCOGRAPHIE / DISCOGRAPHY
CD 2 (1956-1958)
STAN GETZ QUARTET “The Steamer”
Stan GETZ (ts) ; Lou LEVY (p) ; Leroy VINNEGAR (b) ; Stan LEVEY (dm). Los Angeles, 24/11/1956.
1. BLUES FOR MARY JANE (S.Getz) (Verve MGV 8294/mx.4059) 7’51
2. YOU’RE BLASÉ (Ord-Sievier) (Verve MGV 8294/mx.4061) 4’11
STAN GETZ QUARTET “The Soft Swing”
Stan GETZ (ts) ; Mose ALLISON (p) ; Addison FARMER (b) ; Jerry SEGAL (dm). New York City, 12/07/1957.
3. DOWN BEAT (S.Getz) (Verve MGV 8321/mx.21204) 4’45
STAN GETZ with THE OSCAR PETERSON TRIO
Stan GETZ (ts) ; Oscar PETERSON (p) ; Herb ELLIS (g) ; Ray BROWN (b). Los Angeles, 10/10/1957.
4. I’M GLAD THERE IS YOU (J.Dorsey-P.Medeiro) (Verve MGV 8251/mx.21583) 4’39
HERB ELLIS & JATP ALL-STARS “Nothing But The Blues”
Roy ELDRIDGE (tp) ; Stan GETZ (ts) ; Herb ELLIS (g) ; Ray BROWN (b) ; Stan LEVEY (dm).
5. TIN ROOF BLUES (G.Brunies-P.Mares-L.Roppolo-B.Pollack-M. J.Stitzel-W.Melrose)
(Verve MGV 8252/mx.21615) 3’00
GETZ Meets MULLIGAN “In Hi-Fi”
Stan GETZ & Gerry MULLIGAN (ts & bar s) ; Lou LEVY (p) . Ray BROWN (b) ; Stan LEVEY (dm).
Los Angeles, 12/10/1957 (ou-or 22/10 ?).
6. THIS CAN’T BE LOVE (R.Rodgers-L.Hart) (Verve MGV 8249/mx.21701) 8’45
7. A BALLAD (S.Getz) (Verve MGV 8249/mx.21702) 5’44
STAN MEETS CHET
Chet BAKER (tp) ; Stan GETZ (ts) ; Jodie CHRISTIAN (p) ; Victor SPROLES (b) ; Marshall THOMPSON (dm). Chicago, 16/02/1958.
8. HALF-BREED APACHE (S.Getz) (Verve MGV 8263/mx.21957) 15,00
STAN GETZ & J.J. JOHNSON with THE OSCAR PETERSON TRIO
Jay Jay JOHNSON (tb) ; Stan GETZ (ts) ; Oscar PETERSON (p) ; Herb ELLIS (g) ; Ray BROWN (b) ; Connie KAY (dm). Los Angeles (“Shrine Auditorium”), 7/10/1957.
9. MY FUNNY VALENTINE (R.Rodgers-L.Hart) (Verve MGV 8265) 8’29
10. IT NEVER ENTERED MY MIND (R.Rodgers-L.Hart) (Verve MGV 8265) 3’53
STAN GETZ & HIS SWEDISH JAZZMEN
Benny BAILEY (tp) ; Åke PERSSON (tb) ; Stan GETZ (ts) ; Erik NORDSTRÖM (ts) ; Lars GULLIN (bar s, arr.)?; Jan JOHANSSON (p) ; Gunnar JOHNSSON (b) ; William SCHIÖPPFE (dm). Stockholm, 16/09/1958.
11. STOCKHOLM STREET (L.Gullin) (Karusell KP 350 & Verve MGV 8331) 4’18
STAN GETZ Volume 2
Le génie comme sacerdoce
Notre vieux fond de mentalité magique, qui ne nous égare pas toujours, nous incite à supposer qu’une œuvre et son créateur devraient présenter quelque ressemblance. Y compris au physique, si j’ose dire, tant il est vrai qu’on imagine assez mal l’auteur de Crepuscule with Nellie sous les traits d’Erroll Garner. L’un des profonds mystères de l’art, cependant, est que ce qui révèle, fût-ce en la déguisant, l’intimité la plus singulière et la plus irréductible d’un être humain puisse apparaître, en bien des cas, si peu accordé avec ce qu’il révèle de sa personne dans les autres circonstances de sa vie. Paul Desmond, c’est vrai, a la tête de l’emploi, et plus encore les gestes et les paroles. Buddy Rich aussi, dans un autre genre. Ou Miles Davis qui, ses différentes têtes, se les composait avec le plus grand soin. Ils ne sont pas les seuls. Mais peut-être ne sont-ils pas plus nombreux que les musiciens dont la musique et la nature offrent entre elles un contraste saisissant. Milt Jackson, si fruste à la ville, si raffiné à la scène, nous fournit un bel exemple de personnage paradoxal. Et Stan Getz, parmi d’autres, ne lui cède que de peu.
Ses façons échappaient au lyrisme. Le romantisme fuyait sa compagnie. Les évanescences n’étaient pas son quotidien. Depuis trop longtemps l’automne précoce avait pour lui le goût du réchauffé et les clairs de lune sur le Vermont à son avis n’éclairaient plus que des cimetières de voitures, des abattoirs de banlieue et des panneaux rouillés. Il avait mal survécu à la jeunesse qu’il n’avait pas eu, pas pris le temps d’avoir, lancé très tôt sur les routes dans les fourgons de Jack Teagarden, Stan Kenton puis Benny Goodman. Quand je l’ai rencontré, à la fin des années soixante, malgré «?Focus?», «?Jazz Samba?», «?Sweet Rain?», la susceptibilité le rongeait. Il se croyait volontiers un trésor qu’on néglige, un miracle que passaient par pertes et profit des sourds, des imbéciles et de mauvaises gens. On devinait en lui, sans trop comprendre cette souffrance, l’humiliation et l’amertume — à fleur de peau. (Au nom de Zoot Sims, cependant, son visage s’éclairait de l’intérieur. Il revoyait des scènes, il murmurait des choses. Il redevenait l’enfant prodigieux qu’une mère avait farouchement aimé, sous le ciel de tôle du Bronx1 — archétype du fils unique, bien qu’il eût un frère.)
Oh ! à ses heures, «?The Sound?» ne manquait pas de charme?; seulement, au moindre prétexte, ce beau masque lui glissait du visage. Son regard, alors, prenait flamme, ou bien se vitrifiait — et le fiel, alors, lui montait aux lèvres comme un relent. Ni la délicatesse ni la cordialité, de toute façon, n’étaient ce qui réglait ses relations avec autrui, en particulier avec les musiciens qui se plaçaient sous son autorité. Cependant, lorsqu’ils relevaient le défi de son infatigable et conquérante inspiration, lorsqu’ils étaient capables de l’électriser encore davantage2, il ne leur ménageait pas ses louanges. Mais, pas plus que la générosité, la mesquinerie ne lui était tout à fait inconnue. Lorsqu’il s’agissait des élégances du cœur, «?l’élégant Mr Getz?»3 n’était pas arbitre en la matière. Ce n’est pas insulter sa mémoire : lui-même ne faisait pas mystère de ses démons. Dans ses mauvais jours, il pouvait même prendre un plaisir ostentatoire à snober, voire à rabaisser ses pairs. Ceux qu’il admirait le plus, à l’image de Lester Young, en firent les frais autant que les autres, sinon davantage.
Ce sont là, j’en conviens, de ces choses qui nourrissent la chronique : au fond, elles ne concernent guère le mélomane. Néanmoins, ce sont des choses par lesquelles nous n’avons pas pu nous empêcher d’être déçus. Pour une raison majeure : elles nous ont pris au dépourvu. Car, de ce Getz-là, rien, absolument rien ne transpirait dans les œuvres qui nous avaient ouvert l’accès à son univers, alors que nous recevions Split Kick, Hershey Bar ou les morceaux captés en octobre 1951 au Club Storyville de Boston4, non seulement comme un cadeau inespéré, mais comme un privilège indu : une grâce tombée du ciel sans que nous nous en soyons vraiment montrés dignes. Rien n’en transpire non plus dans celles que rassemble la présente sélection. Rien n’en transpirerait, en vérité, dans tout héritage de l’artiste, de son premier enregistrement personnel avec Hank Jones et Max Roach5 à son dernier en duo avec Kenny Barron6 — la seule entorse éventuelle à cette règle étant Is There Any Word From The Lord?7 : parmi les centaines de pièces qu’il a gravées en plus d’un demi-siècle de carrière, sans doute la plus déconcertante, surtout pour les familiers de la sphère où il évoluait
Getz dans l’intimité de son art, Getz dans le privé de son existence8, ce sont des figures presque inconciliables, à peine moins contrastées que ne l’étaient en littérature Hyde et Jekill. Le musicien n’avait pas trop de merveilles à offrir pour qu’on pardonnât les faiblesses de l’homme. Auquel on doit accorder, d’ailleurs, de larges circonstances atténuantes. On serait mal venu en effet de lui reprocher une hypersensibilité dont nous avons tiré un profit aussi considérable. Et si elle fit de lui, au moral, un être d’une fragilité extrême, il conviendrait plutôt de l’en plaindre, sans ignorer pour autant les désagréments que cette situation entraîna pour les personnes qui l’approchaient (Chet Baker, par exemple, lorsqu’ils refirent équipe en 1983). Le désarroi accompagnait le saxophoniste comme son ombre. Des contrariétés minuscules le faisaient fondre en larmes, j’en fus témoin. Éternel enfant gâté, il se montrait plein de frustration, d’offenses et d’outrages impardonnés. De rancœurs et de remords. De morgue et d’apitoiement sur soi-même. Il est clair cependant que la balance ne penche pas de ce côté-là : en même temps il était aussi et demeurerait toujours, avec un acharnement quelquefois héroïque, Stanislas Stanley Getz «?The Steamer?», c’est-à-dire l’un des plus généreux pourvoyeurs de beauté que le XXe siècle ait connus.
Ceci compenserait donc cela ? Pareille symétrie, je le crains, repose sur une équation du degré zéro. On se doit d’envisager les choses d’une manière moins simpliste : et si ceci, bien plutôt, était la cause de cela ? Si Stan avait été celui à qui bien des gens reprochaient des manques et des manquements pour la principale raison que, presque toute sa richesse intérieure, il l’avait investie dans son art, dès l’adolescence et sans jamais en toucher les dividendes par la suite ? La musique s’était montrée à son égard d’une féroce exigence?; elle avait accaparé, confisqué, dévoré ce qu’il y avait de meilleur en lui?; que lui restait-il pour subvenir aux besoins de la vie en société, pour tenter d’entretenir une relation harmonieuse avec lui-même ? On ne saurait offrir énormément sans se priver de beaucoup. Cet homme-là s’est amputé de ce qui l’aurait rendu apte à la sérénité, à la convivialité, aux simples bonheurs de chaque jour. D’aucuns le déclarèrent «?invivable?». Peut-être. Mais, de sa propre existence, quelle part détenait-il encore, après avoir tant distribué de son âme, de sa chair, de son sang ? Il a consenti ce sacrifice exorbitant : au moins, ayons la décence de pas lui en tenir rigueur.
Les moralistes ont répété à l’envi que, ce qui compte chez un homme, ce n’est pas ce qu’il est fait, mais ce qu’il est. Cette philosophie consolatrice s’applique mal aux créateurs, on le voit bien : ils ne sont entièrement eux-mêmes que dans et par ce qu’ils créent, au risque flagrant, quand le moment vient de partir, d’avoir vécu à côté de leur vie.
Alain Gerber
© 2015 Frémeaux & Associés
1 «?She made it clear to everyone that Stan was her prince.?» (Donald L. Maggin in «?Stan Getz. A Life in Jazz?», publié par William Morrow & Company en 1996).
2 Ce fut notamment le cas de trois des batteurs qui se succédèrent à ses côtés : Roy Haynes, Tiny Kahn (voir le premier volume de ce florilège – FA 239) et, par la suite, Victor Lewis.
3 Le titre de l’édition française du microsillon Verve «?The Steamer?», réalisation capitale du saxophoniste à laquelle nous avons emprunté trois pièces : Blues For Mary Jane, There Will Never Be Another You, You’re Blasé. Nous aurions très bien pu y ajouter les trois autres, tant cette séance fut fertile.
4 Se reporter au volume I.
5 Opus de Bop, And The Angels Swing, etc.
6 «?People Time?», en 1991.
7 In «?Stan Getz Plays Music From The Soundtrack Of Mickey One?», enregistrement effectué en très grande formation au mois d’août 1965, sous la direction du compositeur-arrangeur Eddie Sauter, avec lequel Stan s’était déjà associé quatre ans plus tôt pour le fameux «?Focus?» qui avait relancé sa carrière aux Etats-Unis, après un assez long intermède européen (printemps 1958 — février 1961).
8 Parfois passé dans le domaine public en raison, soit de ses frasques (par exemple, en 1954 à Seattle, l’attaque d’un drugstore à l’aide d’un pistolet d’enfant), soit de l’intérêt médiatique éveillé par des réussites commerciales peu fréquentes chez les jazzmen, comme son Moonlight In Vermont avec le guitariste Johnny Smith ou son adaptation très personnelle de la bossa nova (fort peu orthodoxe, c’est le moins qu’on puisse dire, dans le «?Jazz Samba?» co-signé en 1962 par un autre guitariste : Charlie Byrd).
9 Bien sûr, il y a des exceptions à la règle : quelques-uns, en raisons de leurs dispositions particulières ou parce que leur tempérament les y autorise, trouvent en eux assez d’énergie ou de ressources — ou de fraîcheur d’âme ! — pour y échapper. Dans le domaine qui nous occupe, Louis Armstrong en est l’illustration frappante.
STAN GETZ Volume 2 — A propos de la présente sélection
Lorsque Stan Getz quitta le Storyville de Boston à la fin de l’année 1951, il laissait derrière lui une série d’enregistrements devenus historiques (voir The Quintessence – Stan Getz vol.1). Toutefois, devant les perspectives peu gratifiantes qui s’ouvraient devant lui, il décida de rejoindre la grande famille des musiciens de studio. Un état dont, avec un enthousiasme de néophyte, il vanta les mérites dans Down Beat… Pour mieux déchanter par la suite.
Stan passait donc ses après-midi aux studios NBC dans l’orchestre accompagnant le show télévisé de Kate Smith, ce qui ne l’empêchait pas, parallèlement, de se produire en club et de participer à des séances d’enregistrements. Au cours de l’une d’entre elles dirigée par le guitariste Johnny Smith, fut mise en boîte une version de Moonlight in Vermont qui fit un malheur. Une bonne raison pour inciter Norman Granz à s’intéresser de plus près à ceux qui l’avaient gravée. À la fin de 1952, Stan Getz rejoignait son écurie dans laquelle figuraient déjà Charlie Parker, Count Basie, Oscar Peterson, Lester Young, Dizzy Gillespie et quelques autres dont la réputation n’était plus à faire. Grâce aux initiatives de son nouveau directeur artistique, grand amateur de confrontations diverses et variées – après tout il avait inventé le J.A.T.P. -, Stan Getz allait petit à petit sortir de l’univers qui avait fait sa renommée pour empoigner la musique à bras-le-corps.
À l’occasion de la première séance qu’il réalisa au bénéfice du label Clef, l’ancêtre de Verve, Duke Jordan, Jimmy Raney, Bill Crow et Frank Isola l’accompagnèrent sur une série de standards éprouvés. Pris sur un tempo plus lent qu’il n’est coutume, You Turned the Tables On Me pourrait illustrer une phrase qu’Alain Gerber écrivit à propos de l’album «?Stan Getz Plays?» où figurait ce morceau : «?Il y a là des improvisations entières dont chaque phrase, ou presque, contient l’amorce d’un thème qui, parfois, touche au sublime.?»
Sous un prétexte fallacieux – un désaccord concernant la date choisie pour une nouvelle séance -, Jimmy Raney donna sa démission. En fait, il ne supportait plus la sujétion de Stan aux drogues dures et tout ce que cela entraînait. Ainsi se défit l’un des partenariats les plus gratifiants que le jazz dit «?cool?» ait connu. Getz ne montra pas la moindre rancune à l’endroit de Raney car, quatre mois plus tard, il participait à une séance du guitariste sous le pseudonyme de Sven Coolson.
Sur les conseils de Frank Isola, Stan choisit comme nouvel interlocuteur Bob Brookmeyer, tromboniste à pistons et pianiste, ex-étudiant au Conservatoire de Kansas City. Excellent compositeur et arrangeur, soliste imaginatif, il s’exprimait par le biais de phrases aux longues lignes sinueuses s’appuyant solidement sur les temps. Un excellent contrepoint au discours de Getz comme le donne à entendre The Nearness of You interprété de bout en bout de conserve par les deux partenaires qui ne laissent guère qu’un court solo à John Williams.
Getz avait décelé une faille dans leur association?: «?D’abord les deux instruments se situent dans un registre identique, réduit autant pour l’un que pour l’autre. En prenant en compte leurs sonorités d’origine, ils n’ont rien pour se mettre mutuellement en valeur, ce qui pose tout de même un problème. L’idée d’une solution m’effleura un instant : passer au baryton pour créer un contraste plus évident. Et puis, tout compte fait, j’ai réalisé que je n’avais pas à changer d’instrument tant que je n’aurais pas complètement maîtrisé le mien, à savoir le ténor (1).?» Si Getz avait choisi même temporairement une telle échappatoire, sa renommée en aurait probablement souffert et la très fameuse association Mulligan / Brookmeyer n’aurait jamais existé.
Pour pallier les inconvénients énumérés plus haut, Stan trouva une solution moins radicale : choisir suivant les cas un bec métallique pour se tenir sous Brookmeyer – ce qui est le cas dans The Nearness of You – ou un bec en plastique assurant un son plus pur qui convenait au jeu dans l’aigu.
La complicité existant entre Getz et Brookmeyer s’affiche au long d’un concert enregistré au Shrine Auditorium de Los Angeles. Galvanisés par la présence d’un public complice, après une suite de chorus accompagnés de contre-chants, ils terminèrent Pernod en improvisation collective?; un thème signé Johnny Mandel qui, lui-même tromboniste, avait remplacé un temps Brook. Malgré l’évidente réussite d’une association qui atteignait en cette occasion un sommet, ce récital en marqua la fin. Du moins sur une base régulière. Au fil des ans, elle se renouera à maintes reprises.
Si, au sein de l’organisation Granz, Getz restait le maître d’œuvre des séances dont il était responsable, il lui fallait prêter son concours à d’autres membres de l’écurie. Ce qu’il faisait sans rechigner, sachant que, d’instinct, il saurait quelle position adopter. Brookmeyer : «?Stan est remarquable parce que vous pouvez le placer dans n’importe quel contexte, il trouvera toujours ce qu’il faut faire (2).?» De prime abord, son face à face avec Gillespie pourrait apparaître comme contre-nature. Ce ne fut pas l’avis de Getz qui déclara plus tard : «?Diz m’a toujours été cher, autant musicalement que personnellement. Il semble que nous allions bien ensemble. Nous pensons de la même façon, bien que nous ayons chacun notre manière de nous exprimer?; nous empruntons des chemins différents mais parallèles (3).?» Certes, lors de leur première rencontre, comme on pouvait s’y attendre, Dizzy mène la danse, entraînant Getz sur un terrain qui, a priori, ne semblait pas lui être favorable. Toutefois, sans se démonter, il lui répond du tac au tac au long de It Don’t Mean a Thing.
Une seconde manche se déroula trois ans plus tard afin de mettre en boîte un LP intitulé «?For Musicians Only?». On raconta que Gillespie serait venu avec la ferme intention de faire tomber Getz. Une attitude qui ne correspondrait guère à sa personnalité?; une assertion faisant bon marché de son intelligence alors qu’il savait parfaitement à qui il avait à faire. Par contre que le troisième larron, Sonny Stitt, se soit vanté d’être le ténor le plus rapide du monde n’aurait rien de surprenant. Est-ce lui qui décida du tempo d’enfer sur lequel fut pris Be-Bop ? Sans doute. Malheureusement pour lui, l’histoire de l’arroseur arrosé se répéta. Aussi bon qu’ait été son chorus, il fut loin de surpasser ou même d’égaler celui de Stan parfaitement à son aise. Son instinct l’avait poussé à jouer legato en opposition à Stitt qui, lui, s’exprimait dans l’idiome musclé lié au be-bop. Un effet de contraste qui plaçait Stan sur un tout autre terrain que son adversaire et, en sus, fonctionnait parfaitement par rapport au jeu de Dizzy.
Basée sur une estime réciproque, la rencontre Lionel Hampton / Stan Getz fut, à l’époque, jugée avec sévérité. Très injustement et pour des raisons qui n’avaient rien à voir avec l’objectivité la plus élémentaire. En grande majorité fans inconditionnels d’Illinois Jacquet, les amateurs de Hamp n’appréciaient guère Getz. Pourtant l’éblouissante suite de paraphrases qu’il enchaîne sur Cherokee, le thème fétiche de Parker, aurait dû convaincre les plus récalcitrants. D’autant mieux que, bien décidé à ne pas s’en laisser conter, Lionel Hampton concluait le morceau avec enthousiasme en dialoguant avec Stan. Au gré des rééditions, justice finira par être rendue à «?Hamp and Getz?».
«?Nous avons arrêté Getz sur le champ?; plus tard il fut jugé et condamné à six mois de prison. Ce jeune musicien se faisait 3 500 $ par semaine à ce moment-là et il en dépensait une bonne partie en héroïne. Je ne me préoccupais nullement de savoir si c’était un brave type ou un salaud.?» Ainsi John O’Grady à l’époque directeur de la brigade des stupéfiants de Los Angeles, terminait-il le récit de sa descente au domicile de Getz à Hollywood Hills. Pour briller un peu plus, il décrivit son prisonnier comme un dangereux maniaque des armes à feu (4). On croit rêver…
Lorsqu’il prit connaissance de sa condamnation, sachant que le fait d’être une (relative) célébrité dans le monde du jazz jouerait plutôt en sa défaveur, Stan tenta de se suicider. Sa détention fut effectivement très pénible et, quelque temps avant sa libération, les autorités carcérales le transférèrent dans une ferme-pénitencier. Ainsi, à sa sortie, il n’apparaîtrait pas en trop mauvaise forme physique devant son public.
Monica Silfverskiold, qui deviendra sa seconde épouse, expliquait ainsi le fait que depuis l’âge de dix-huit ans, Stan ait été tributaire de la drogue : «?Hors de l’univers de sa musique, il s’était toujours senti perdu et vulnérable... Il avait connu des expériences traumatisantes. Il ne comprenait pas le monde et se méfiait de tous. Sa réaction première était de se réfugier derrière un mur de ressentiment, blessant les gens avant qu’ils ne puissent le blesser (5).?» Sa sphère musicale et le monde réel étaient pour lui deux choses étrangères, tellement qu’il arrivait à les séparer complètement. À l’écoute de la version apaisée, toute de sérénité, qu’il propose du thème traditionnel Down the Sycomore Tree, comment imaginer que son interprète ait été au moment de son enregistrement, en plein milieu de ses démêlés avec la justice ? On ne saurait parler d’indifférence non plus que de stoïcisme mais bien plutôt du choix délibéré d’une évasion loin de la réalité, à l’image de celle que, depuis sa cellule, avait adoptée Peter Ibbetson, le personnage de George Du Maurier.
Au cours des années Verve, la sonorité de Stan Getz gagna en sensualité, en rondeur, devenant du coup plus habitée?; l’épithète «?The Sound?» ne sera pas pour rien accolée à son nom. «?Techniquement parlant, je suppose que le ténor est l’instrument le plus facile à apprendre. Se contenter de jouer du saxophone n’est pas une chose difficile. Seulement ce n’est pas suffisant. Pour n’être qu’un bon interprète, il suffit de savoir en jouer correctement comme c’est le cas pour n’importe quel autre instrument. Acquérir une sonorité, belle, musicale, ce n’est pas facile du tout. Le saxophone est pourrait-on dire un instrument bâtard. Il n’est pas pur comme le violon, le piano ou la trompette. Vous remarquerez que l’on ne trouve aucun saxophone dans les orchestres symphoniques. Le ténor, tout spécialement, est mal défini, dans le sens qu’un instrumentiste peut pratiquement en faire ce qu’il veut. C’est la raison pour laquelle il y a tant de styles différents de ténor - ou de sons (6).?» Selon Jean-Claude Fohrenbach, l’un des grands spécialistes français de l’instrument, Getz aurait atteint à une sorte d’idéal : «?Il réunit toutes les qualités. Jamais une fausse note, jamais une erreur et, pourtant, un engagement total, à chaque instant, une flamme sans pareille. Il a su, en synthèse propre, retenir quelque chose de Hawk, de Lester, de Parker, comme il a créé le son le plus merveilleux du monde, le son saxophonique qui se souvient de celui de la flûte, le son optimal de l’instrument (7).?»
Durant la même période, Getz faisait tout autant montre d’un irrépressible sens du swing, dispensé avec fougue et une prodigalité qui en surprirent plus d’un. «?You ain’t from the cool school, you’re the Steamer !?» s’exclama un soir Oscar Peterson. Les deux musiciens se connaissaient bien, leurs chemins s’étant croisés à maintes reprises en studio ou au sein du JATP.
Granz estima qu’un album réunissant Stan et le trio d’Oscar serait le bienvenu. Un pianiste, Peterson bien sûr, un guitariste, Herb Ellis, un bassiste, Ray Brown. Pas de batteur. Une instrumentation qui, pour inédite qu’elle fut dans sa discographie, ne gêna Getz en rien. Décontraction et complicité s’instaurèrent dès les premières mesures. «?C’est l’un des disques les plus plaisants auquel j’ai jamais participé. Qu’il est reposant de jouer avec des professionnels de ce calibre !?» Exposé par Stan avec le seul soutien d’Herb Ellis - Ray Brown puis Oscar Peterson n’entrant à leur tour que plus tard sur la pointe des pieds - I’m Glad There Is You pourrait bien trouver sa place parmi les chefs-d’œuvre de Stan.
De nouveau en compagnie d’Herb Ellis et de Ray Brown - sans Oscar mais avec Stan Levey à la batterie -, il rendit visite à Roy Eldridge qui porta sur lui ce jugement : «?Il vient de l’ancienne école lui aussi et il le prouve. Beaucoup de jeunes ne peuvent travailler que dans un seul genre. Getz, lui, peut assurer dans des morceaux comme Royal Garden Blues ou Tin Roof. Il l’a fait.?» Ce compliment dû à Little Jazz lui fut inspiré par l’une des plus jolies séances qu’ait organisée Norman Granz. Au long de son entrée dans Tin Roof, Stan évoque avec une grande révérence la filiation qui le lie à Lester Young. Un hommage qu’il jugea bon de rendre au Pres au cours de cet album entièrement consacré au blues. Une forme musicale que Stan connaissait bien : s’il signa peu de thèmes, l’un d’entre eux était Blues for Mary Jane.
Enregistrée en novembre 1956, cette composition avait été écrite en hommage à Mary Jane Outwater, la secrétaire personnelle de Norman Granz. En état de grâce, Stan Getz enchaîne pendant près de huit minutes sur tempo médium, idées sur idées avec un sens imparable de la logique. Au cours de ses dix-huit chorus, chaque enchaînement donne naissance à une phrase inattendue. Aucun cliché, nulle redite, pas l’ombre d’une tergiversation, le discours coule de source avec une impétuosité particulièrement manifeste au cours du «?stop chorus?». Un procédé auquel Getz eut souvent recours à l’époque, l’utilisant ainsi en ouverture de Down Beat.
Blues for Mary Jane appartenait à l’album «?The Steamer?», tout comme There’ll Never Be Another You dans lequel le solo de Lou Levy est tout aussi remarquable que l’introduction a capella jouée par Getz. Ce dernier fit toujours preuve d’un flair infaillible dans le choix de pianistes capables de le servir tout autant que de l’inspirer : Horace Silver, Duke Jordan, John Williams, Lou Levy. Un ami de longue date qui avait appartenu à l’orchestre de Woody Herman conjointement aux Four Brothers. Au moment où il avait rejoint Getz au studio, Lou Levy appartenait encore aux «?Giants?» de Shorty Rogers.
Accompagnateur hors pair fort sollicité - «?J’ai accompagné tout le monde sauf Pavarotti?» -, en dehors d’une remarquable précision rythmique qui séduisait Getz, Lou Levy possédait un vrai talent de mélodiste. S’il avait écouté Bud Powell et Al Haig, il reconnaissait avoir tout autant subi les influences de Nat King Cole, Teddy Wilson et Art Tatum «?un univers à lui tout seul?». Ses divers partenariats avec Getz se dérouleront dans un climat d’admiration réciproque?: «?Quand vous jouez avec Stan, il arrive toujours à vous pousser à un niveau de créativité supérieure?» reconnaissait-il.
En compagnie de Leroy Vinnegar à la basse et de Shelly Manne à la batterie, Lou Levy assista Getz au long de deux morceaux qui, différents l’un de l’autre, représentent les deux pôles du champ d’action qu’il entendait alors couvrir. Pris sur un tempo ultra-rapide - soixante-seize mesures à la minute - Stan laisse transparaître dans S-h-i-n-e une vraie jubilation qui n’oblitère en rien son goût pour la mélodie, non plus que son sens de l’architecture dans les improvisations. À Steve Voce qui lui demandait «?Ce n’était pas difficile de jouer ces chorus bouillonnants ??», il répondit «?Aussi facile que de se laisser tomber comme une bûche. En fait, ce ne fut que plusieurs mois après la séance, lorsque quelqu’un me l’a fait remarquer, que j’ai réalisé avoir pris dix-huit chorus…?» Pour l’occasion Getz avait choisi comme interlocuteur le trompettiste Conte Candoli un peu trop vite rangé parmi les suiveurs anonymes de Gillespie. Certes, il l’admirait mais il pouvait parfaitement lui tailler des croupières, tant sur le plan de la technique que sur ceux de l’imagination, de la logique et de l’intensité du discours. Il le démontre ici.
À l’exact opposé de S-h-i-n-e, A Handful of Stars à propos duquel, dans une chronique, Alain Gerber écrivait que son écoute prouvait que la vie valait d’être vécue. L’une de ces ballades au long desquelles, Stan Getz, par modifications infimes, retouches et détournements, amende insidieusement la partition du compositeur. Comme il le fera avec There’ll Never Be Another You et You’re Blasé. «?Elles éveillent ma curiosité. Je ne me concentre pas sur un seul aspect de la chanson?; ni sur les paroles, ni sur le tempo, ni sur n’importe quoi d’autre. J’aime l’aspect romantique de ces airs mélodieux, faciles. Je laisse l’ambiance s’installer toute seule. Rien n’est prémédité. Tout vient de ce que le morceau me dicte. Vous avez peut-être remarqué que je ne joue jamais les yeux fermés pourtant mon esprit ne s’intéresse qu’à la musique. Rien de ce qui peut traverser mon champ visuel n’est capable de m’en distraire. Chaque chose sort de l’intérieur, aucune des images qui me vient n’a pour origine un élément extérieur (8).?»
Rarement Getz s’employait longtemps à leur arracher leurs secrets. Il le faisait durant un laps de temps donné qui, généralement, coïncidait avec une tournée ou un engagement?; quelquefois en fonction de hasards liés aux enregistrements. Certains thèmes n’apparaissent qu’une fois dans sa discographie, ainsi Over the Rainbow, la chanson d’Harold Arlen que les producteurs avaient hésité à inclure dans «?The Wizard of Oz?» sous prétexte que personne ne se souviendrait de sa mélodie. Ce fut à Stockholm, entouré de musiciens suédois dont l’excellent pianiste Bengt Hallberg, que Stan en proposa une version. N’étant pas musicien à privilégier la routine lorsqu’il s’agissait de constituer son répertoire, il ne l’était pas non plus au moment de recruter de ses accompagnateurs.
Mose Allison : «?C’est grâce à Frank Isola que j’ai été engagé par Stan Getz. Je n’ai jamais auditionné pour lui. Il ne le faisait pour personne – le travail tenait lieu d’audition. S’il était satisfait du vôtre ce soir-là, vous restiez. Pendant que j’étais avec lui, il utilisa quelque chose comme dix ou douze batteurs, parfois l’espace d’une nuit seulement (9).?» L’un d’entre eux fut probablement le valeureux Jerry Segal que l’on peut entendre sur Down Beat extrait de l’album «?The Soft Swing?»?; le seul témoignage subsistant de la collaboration Getz/Mose Allison. Pianiste, chanteur, trompettiste, compositeur parfaitement inclassable, ce dernier puisait son inspiration aussi bien dans le blues rural que chez Thelonious Monk. Curieusement Getz ne grava pas le moindre de ses thèmes alors, que dans un club, en guise d’intermède, il lui offrait l’occasion d’interpréter des extraits de sa Back Ground Suite.
Nés tous deux en 1927, Stan Getz et Gerry Mulligan présentaient nombre de similitudes venues d’itinéraires musicaux proches : débuts au sein des grands orchestres swing, choc éprouvé à l’écoute de Charlie Parker, goût prononcé pour la musique de Lester Young. Enthousiasmé par le tout nouveau quartette de Gerry Mulligan, Stan Getz lui avait même proposé officiellement, par l’intermédiaire du Down Beat daté du 25 février 1953, de le rejoindre. Une suggestion parfaitement saugrenue du point de vue de Mulligan qui la repoussa avec une certaine vivacité. Getz aurait dû y réfléchir à deux fois avant de lui faire une telle avance. Les deux hommes ayant déjà travaillé ensemble, il avait eu l’occasion de tester le caractère irascible de Gerry.
De l’eau avait coulé sous les ponts depuis. Tous deux appartenant à l’écurie Norman Granz, il était fatal que Getz affronte Mulligan un jour. Grand amateur de rencontres devant l’Éternel, ce dernier s’était déjà mesuré à Thelonious Monk puis à Paul Desmond en compagnie duquel il avait inauguré la série «?Gerry Mulligan Meets…?». En tête de la liste des adversaires qu’il convoitait, se trouvait le nom de Getz qui, lui-même, déclarait brûler d’envie de croiser le fer avec lui. Une joute qui s’annonçait donc sous les meilleurs auspices.
Compte tenu du talent que montrait Mulligan pour fourbir de petits arrangements destinés à des formations réduites, il faut bien dire que l’on reste quelque peu sur sa faim devant le résultat global de la confrontation : les deux protagonistes profitèrent de l’occasion pour s’adonner sans complexe aux joies de la jam-session informelle. Sans toutefois se faire de cadeaux, ils s’amusèrent de bon cœur, allant jusqu’à échanger leurs instruments sur deux morceaux.
Dans semblable contexte, la mise en phase spontanée des improvisations peut donner naissance à quelques moments d’exception. Durant Ballad et This Can’t Be Love par exemple. «?Il y a des ballades sur lesquelles je ne joue rien d’autre que la mélodie. Lush Life est l’une d’entre elles. La mélodie en est si belle que pour moi elle se suffit à elle-même. Il en existe d’autres comme celle de Ballad que Gerry Mulligan composa pour notre album commun?; elle coule simplement, facilement. C’est fascinant d’un simple point de vue rythmique (10).?» On ne saurait mieux dire, la seule erreur de Getz étant de croire que Gerry avait écrit Ballad pour l’occasion?; elle figurait déjà au répertoire de son Tentet californien… Solos, contrechants, improvisations collectives composent pour l’occasion un seul et même chorus à deux voix dont la valeur surpasse la simple addition de talents individuels pourtant exceptionnels. Bien que pris sur tempo rapide, This Can’t Be Love relève d’un même état de grâce.
Décidé à s’installer en Suède avec armes et bagages durant le printemps de 1958, Getz s’y était produit avec quelques-uns des meilleurs musiciens locaux. Au mois d’août, en compagnie d’un septette, il se rendit à l’Europa Film Studio de Sundbyberg pour y enregistrer une séance dont chaque interprétation avait été soigneusement préméditée. Une musique élaborée, complexe, dans l’esprit du jazz suédois d’alors qui s’inscrivait dans le droit fil des expériences conduites d’un côté par le Nonette de Miles Davis, de l’autre par Lennie Tristano. Stockholm Street avait été composé et arrangé par Lars Gullin, un musicien exceptionnel qui s’exprimait au baryton avec une fluidité rare pour délivrer un discours lyrique empreint de la mélancolie douce-amère propre à une partie du folklore suédois. Une ambiance dans laquelle baigne Stockholm Street dont la structure harmonique complexe servait de prétexte à une orchestration d’une belle musicalité. Privilégiant la délicatesse méditative, soutenu par un discret accompagnement instrumental, Stan Getz en est le seul soliste.
Pour l’occasion, Lars Gullin réalisait ce que Mulligan n’avait pas été tenté de faire. Ou n’avait pas eu le loisir de mettre sur pied?; une hypothèse plausible quand on prend en considération l’aversion de Norman Granz pour tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à une répétition…
Lorsqu’en 1953 Gerry Mulligan avait été retiré de la scène du jazz à la suite d’une arrestation dont se vantera également James O’Grady, Stan Getz avait tenté de le remplacer au côté de Chet Baker. Avec un résultat d’autant moins convaincant qu’une antipathie quasi épidermique s’était déclarée entre Chet et Stan.
Quelle mouche piqua Norman Granz en février 1958 ? Qu’est-ce qui avait bien pu le pousser à les réunir dans une séance d’enregistrement ? À Chicago en sus, une ville qui n’était le port d’attache d’aucun des deux. Certes, en compagnie de Johnny Griffin, Getz y donnait un concert à la DuSable High School accompagné par la rythmique qui se retrouvera à ses côtés au studio Robert Oaks Jordan and Associates Recorders. Mais Chet ? N’ayant plus d’orchestre régulier, sans doute assurait-il un engagement dans la Cité des Vents avec des accompagnateurs locaux… À quoi pouvait bien s’attendre Granz ? Le pianiste Jodie Christian reconnut : «?Personne ne savait ce que nous étions censés faire au studio. C’était bizarre, on aurait dit que tout avait été décidé sur un coup de tête. C’était ce à quoi cela ressemblait.?»
Stan Getz affirma qu’il en ressortit le plus mauvais album de sa carrière. Il n’avait pas tout à fait tort... à un morceau près, Half – Breed Apache. Un thème de Getz qui, pris sur un tempo proprement insensé, sert de défouloir durant un quart d’heure à deux musiciens au bord d’en venir aux mains. En rage, Getz exécute un stop chorus à couper le souffle et Chet qui ne se le tient pas pour dit, s’empare littéralement du micro avec une violence et une prolixité qui lui ressemblent peu. La rythmique suivait le mouvement dans une furia orchestrée par Jodie Christian dont les conceptions pianistiques étaient proches de celles d’Horace Silver - «?J’aimais danser. J’ai toujours été beaucoup plus attiré par le côté rythmique que par le côté harmonique.?» Half –Breed Apache suggère que la colère peut parfois être bonne conseillère. Lorsqu’ils se retrouveront en 1983 à l’occasion d’une tournée commune, Chet et Stan mirent un peu d’eau dans leur vin…Un petit peu seulement.
Le fruit de l’association Getz – J.J. Johnson se situe aux antipodes de ce qui naquit de cette journée de dupes. Les deux musiciens s’étaient déjà rencontrés en février 1950 sous la houlette de Miles Davis, à l’occasion d’un concert radiodiffusé puis, au sein de la «?Modern Jazz Society?» pour mettre en boîte un album sous la direction conjointe de John Lewis et de Gunther Schuller. Deux brèves rencontres qui n’expliquent pas vraiment la complicité qui, d’emblée, s’installe entre eux.
Getz ne pouvait être pris au dépourvu par le langage de J. J. dont la parfaite élocution possédait plus d’un point commun avec celle d’un tromboniste à pistons comme Brookmeyer. La construction savamment élaborée de ses interventions, sa maîtrise de toutes les ressources de son instrument, sa conception même du jazz, le rendaient proche de Stan. Il n’empêche... À l’écoute de leurs improvisations collectives sur My Funny Valentine, il semble incroyable qu’elles puissent être nées dans la fièvre d’un concert, face à un public indiscipliné. Une musique d’un tel équilibre, d’un niveau d’inspiration aussi élevé, compte parmi ces instants miraculeux que le jazz est susceptible de faire parfois naître.
Getz en était bien conscient. À la question d’un journaliste de Jazz Magazine qui lui demandait quel album il préférait parmi ceux dont il avait été le co-leader, il répondit : «?Celui enregistré à l’Opera House avec Jay Jay Johnson?». Opera House de Chicago ? Shrine Auditorium de Los Angeles ? Norman Granz n’ayant jamais fait grand cas des localisations et des dates précises, les rencontres J.J./ Stan n’ont pas cessé de passer d’un lieu à l’autre au gré des éditions et rééditions. D’autant plus facilement que, durant les deux concerts, les thèmes interprétés étaient les mêmes.
D’où qu’elle provienne, la version de It Never Entered My Mind ici reproduite figure parmi les plus grandes interprétations de Getz. La qualifier tout bonnement de chef-d’œuvre n’aurait rien d’exagéré. À lui tout seul It Never Entered My Mind suffirait à expliquer l’apostrophe lancée à Stan par Lester Young dans les coulisses du Blue Note de la rue d’Artois : «?Tu es mon chanteur?».
Lorsqu’il enregistra Stockholm Street en compagnie de Lars Gullin, Stan Getz avait trente-et-un ans?; depuis la moitié de cet âge, il était musicien professionnel. Cinq années - de 1953 à 1958 – suffirent à le débarrasser d’une étiquette d’espoir certes prometteur mais marginal pour le hisser au premier plan du paysage jazzistique. Dorénavant, que cela plaise ou non, chacun savait qu’il fallait compter avec lui. Au cours d’une carrière qui allait s’étendre encore sur plus de trois décennies, Stan Getz connaîtra des hauts et des bas. Sans jamais rien perdre de ce qui faisait de lui le dernier des romantiques, ainsi qu’il se plaisait à le rappeler. Un après-midi, à Nice dans les jardins de Cimiez, il nous confia l’un de ses secrets : «?Nombreux sont ceux qui m’ont imité, enfin plus exactement, j’ai influencé beaucoup de monde. Mais mon style est très dur à copier. Il est trop… simple (11).?»
Alain Tercinet
© 2015 Frémeaux & Associés
(1) Notes de pochette de «?More West Coast Jazz With Stan Getz?» (Verve).
(2) Burt Korall, «?Stan Getz – Soul & Lyricism?», Jazz Journal, vol. 44 n° 9, septembre 1991.
(3) Donald L. Maggin, «?Dizzy - The Life and Times of John Birks Gillespie?», Harper Entertainment, New York, 2005.
(4) John O’Grady & Nolan Davis «?O’Grady – The Life and Times of Hollywood N°1 Private Eye?», P.J. Tarcher Inc., Los Angeles, 1974.
(5) Don DeMicheal, «?A Long Look at Stan Getz?», Down Beat, août 1996.
(6) Notes de pochette de «?Stan Getz ’57?» (Verve).
(7) Jean-Claude Fohrenbach, «?Visites aux grands ténors?», Les Cahiers du Jazz n°9, novembre 1996, P.U.F.
(8) Arnold Jay Smith, «?Influentially Yours, Stan Getz», Down Beat, 12 août 1976.
(9) Gordon Jack, «?Mose Allison?», Jazz Journal vol.48, n° 6, juin 1995.
(10) comme (8).
(11) Claude Carrière, Alain Tercinet, «?Stan’s Mood – interview?», Jazz Hot n° 353, septembre 1978.
STAN GETZ Volume 2 - RANDOM TRACKNOTES
When Stan Getz moved on from Boston’s Storyville at the end of 1951, he left behind a series of recordings which have become historic (cf. The Quintessence – Stan Getz vol.1). But at the time, his prospects held little reward for him and he decided to rejoin the great family of studio musicians, a condition whose merits he vaunted in Down Beat with all the enthusiasm of a new convert… it would make his later disillusion all the greater.
So Stan would spend his afternoons at NBC’s studios, in the orchestra on Kate Smith’s television show, although that didn’t stop him appearing in clubs over the same period, nor from doing record-sessions. In one of the latter, led by guitarist Johnny Smith, they taped a superb version of Moonlight in Vermont and it gave Norman Granz good reason to take a closer interest in those who’d recorded it. At the end of 1952 Stan Getz moved into his stable, joining Charlie Parker, Count Basie, Oscar Peterson, Lester Young, Dizzy Gillespie and a few others with a reputation already second to none. Thanks to the initiatives of his new artistic director, a man very attached to all kinds of musical confrontations — after all, Granz had invented J.A.T.P. —, Stan Getz would gradually emerge from the universe which had made him famous and seize music in a firm grip.
On the first session he did for the Clef label (Verve’s ancestor), Duke Jordan, Jimmy Raney, Bill Crow and Frank Isola accompanied him on a series of tried and trusted standards. Taken at a slower tempo than usual, You Turned the Tables On Me could well illustrate Alain Gerber’s words on the subject of the “Stan Getz Plays” album where this title was featured: “There are whole improvisations in this [record] where each phrase, or almost, contains a primer for a theme which sometimes borders on the sublime.”
Under a fallacious pretext — disagreement over the date chosen for a new session — Jimmy Raney resigned; his real reason was that he could no longer put up with Stan’s dependency on drugs and all that it entailed. And so ended one of the most rewarding partnerships known to what they called “cool” jazz. Stan didn’t hold this against Raney at all, because four months later he played on a session for the guitarist under the pseudonym Sven Coolson.
Taking advice from Frank Isola, Stan chose Bob Brookmeyer as his new partner, a valve-trombonist and pianist who’d studied at the Conservatory in Kansas City. Bob was not only an excellent composer/arranger but also an imaginative soloist who expressed himself in phrases with long, sinuous lines that were solidly tied to the time-signatures. His playing provided excellent counterpoint for Stan’s discourse, as you can hear from The Nearness of You, played from end to end by the two new partners acting in concert, leaving barely one short solo to John Williams. Getz had spotted a flaw in the saxophone/trombone association: “They are both in the same register, for one thing. Each instrument has a small range and, as far as actual sound is concerned, they don’t glorify each other. Well, this is quite a problem. One solution that occurred to me was the thought of switching over to baritone saxophone – to create a more effective contrast. But then I realized something else – I have no business switching to another instrument until I’ve mastered my own, the tenor.”1 If Getz had chosen that solution, even temporarily, his reputation would probably have suffered and, no doubt, the celebrated Mulligan / Brookmeyer pairing would never have existed.
To compensate for the disadvantages he mentioned, Stan found a less radical solution: depending on the circumstances, he chose a metal mouthpiece to remain beneath Brookmeyer – which is the case in The Nearness of You – or a plastic one to provide a purer sound which would suit playing in the upper register.
The complicity reigning between Getz and Brookmeyer is displayed throughout the concert they recorded at the Shrine Auditorium in Los Angeles. Galvanized by the presence of a comprehending audience, they follow the descants accompanying a succession of choruses by concluding Pernod with a collective improvisation. Johnny Mandel wrote the tune and, himself a trombonist, he’d stepped in for “Brook” for a time. Despite the obvious success of a partnership which reaches the summits at the Shrine, this recital marked its end. Or at least on a regular basis; over the years they would get together again on many occasions.
While Stan remained firmly in charge of the sessions for which he was responsible within the Granz organization, he was still required to lend a hand to others in the stable. He did so without balking, in the knowledge that his instinct would indicate which position to adopt. According to Brookmeyer, “Stanley was remarkable because you could put him in any context and he found the right thing to do.”2 At first sight, confronting Gillespie might seem counter to nature, but that wasn’t Stan’s opinion; he later said that, “Diz has always been close to my heart musically and personally. We two seem to go together. We think alike, and yet we are entirely our own men with our own way of expressing ourselves – travelling different yet parallel paths.”3 Indeed, as you might expect, Dizzy leads the dance in their first encounter, drawing Getz towards ground which, a priori, doesn’t seem to favour him. But Stan doesn’t let that disconcert him and he gives as good as he gets all the way through It Don’t Mean a Thing.
A return match took place three years later in order to record the LP called “For Musicians Only”. They say that Gillespie turned up with the firm intention of knocking Getz off his pedestal, an attitude which hardly seems in character (and an assertion which belittles the intelligence of someone who knew exactly who he was up against). On the other hand, the third horn on the session, Sonny Stitt, reportedly boasted that he was the fastest tenor in the world; not many would be surprised to hear that coming from him. Was he the one who picked the furious tempo taken for Be-Bop? It probably was, but unfortunately for him, the old story of the biter bit just repeated itself. As good as his chorus is he’s still a long way from surpassing, never mind equalling, the chorus played by Stan with immaculate assurance. His instinct here told him to play legato opposite Stitt, who expresses himself in the muscular idiom associated with bebop. The contrast places Stan in quite another ball-park from that of his adversary, and to cap it all, its effect functions perfectly where Dizzy’s playing is concerned.
The encounter between Lionel Hampton and Stan Getz was based on mutual esteem, and at the time it was harshly judged. That was quite unfair, and motivated by reasons which had nothing to do with the most elementary objectivity. People who liked Hamp were, in their great majority, unconditional fans of Illinois Jacquet and showed hardly any appreciation for Getz. And yet the dazzling succession of paraphrases he puts together on Cherokee, Parker’s lucky-mascot tune, ought to have convinced the most reticent among them. All the more so since Hamp, quite determined not to be done out of things, brings the piece to an enthusiastic end in a dialogue with Stan. In the course of its various reissues, “Hamp and Getz” would finally see justice done.
“We arrested Getz on the spot; later he was convicted and sentenced to six months in jail. This young musician was making $3500 a week in those days and spending a lot of it on heroin. I didn’t care whether he was a nice person or a bad person.” John O’Grady was head of the L.A. narcotics squad when the events to which he was referring took place, and he was relating the raid on Stan’s home in Hollywood Hills. To make himself look an even better cop, O’Grady went on to describe his prisoner as “armed and dangerous”.4 He must have been dreaming… When Stan Getz was awaiting trial, he realized that his (relative) celebrity in the jazz world would probably go against him and he attempted to take his own life. The conditions of his detention were hard indeed, and he was transferred to a prison farm some time before his release: that way, when he finally came out, his physical condition wouldn’t be too poor for him to appear in front of an audience again.
Monica Silfverskiold, who would become his second wife, had this to say by way of explaining Stan’s addiction since the age of eighteen: “Outside his world of music, he always felt vulnerable and lost. In the past, he’d had a life of frightening experiences. He didn’t understand the world, and he distrusted the people in it. His reaction was to close up behind a wall of anger, to hurt before he might be hurt.”5 His musical sphere and the real world were things foreign to Getz, so much so that he managed to separate them completely. Listening to the peaceful, totally serene version he proposes of the traditional tune Down by the Sycamore Tree, how could you possibly imagine that this artist, at the moment he recorded it, was embroiled in so many problems with the law? There’s no question of this having anything to do with indifference or stoicism; he was deliberately choosing to escape from reality, in the image of the choice made in another cell by Peter Ibbetson, George Du Maurier’s hero.
In the course of his Verve years, Stan Getz’ sound gained more sensuality; it became rounder and therefore more inhabited; not for nothing was the epithet “The Sound” coupled with his name. “Technically speaking, I suppose it’s the easiest from that point of view. Just to play the saxophone – well, that’s not so hard to learn. But mere playing isn’t enough. To be any good you have to play the saxophone properly, as you would any other instrument; you have to get a good musical sound and that is not so easy at all… The saxophone is – well, you might go so far as to call it a bastard instrument. It’s not pure, like the violin or the piano or the trumpet. You don’t see any saxophones in symphony orchestras, you’ll notice. The tenor, especially, is out of tune in a sense, and a musician can pretty much make of the tenor saxophone what he will. That’s one reason why there are so many different tenor styles – or noises…”6 According to Jean-Claude Fohrenbach, one of the great French specialists on the instrument, Getz had possibly reached a kind of ideal: “He has every quality. Never a false note, never a mistake, and yet there’s total commitment at every instant, a flame without equal. In a synthesis of his own he manages to take something from Hawk, Lester and Parker, as if he’d created the most marvellous sound in the world, the saxophone sound which remembers the sound of the flute, the optimal instrumental sound.”7
During the same period, Getz demonstrated his irresistible feeling for swing — which he dispensed with fire — as much as his extravagance, and they both surprised more than one: “You ain’t from the cool school, you’re the Steamer!”, exclaimed Oscar Peterson one night. The two knew each other well, as their paths had crossed time and again either in a studio or with JATP.
Granz thought an album with Stan and Oscar’s Trio would be welcome: Peterson on piano of course, plus guitarist Herb Ellis and bassist Ray Brown. No drummer. The line-up was unheard-of in Stan’s discography up until then, but that didn’t faze him in the least. A laid-back atmosphere with everyone feeling close settles in right from the opening bars: “This is one of the most enjoyable recordings I ever made. How refreshing it is to play with these pros!” Stan states the theme with just Herb Ellis for support, and then Ray Brown and Oscar Peterson come in on tip-toe to give I’m Glad There Is You its rightful place, which might well be that of another Getz masterpiece.
Accompanied by Ellis and Ray Brown — without Oscar, but with Stan Levey on drums — Stan paid a visit to Roy Eldridge, who made this judgement: “He comes from the old school too, you know, and he proved it on that date. Most of the younger cats can’t get with but one thing; Getz can fit into something like this too. Like Royal Garden Blues and Tin Roof. He fitted there.” That compliment paid by Little Jazz was inspired by one of the nicest sessions Norman Granz ever set up. Throughout his introduction to Tin Roof, Stan reverently recalls his kinship with Lester Young. It was a tribute he thought worth making to Prez all the way through this album devoted solely to the blues.
Stan knew the blues like the back of his hand; he didn’t write many, but one of them was Blues for Mary Jane. Recorded in November 1956, this composition was dedicated to Mary Jane Outwater, who was Norman Granz’ personal assistant. In a state of grace, Stan Getz takes up a medium tempo and for almost eight minutes he plays one idea after another with an unassailable sense of logic. During his eighteen choruses, each link in the chain gives birth to an unexpected phrase. With no clichés, no repeats and no sign of hesitation, the discourse flows in a seemingly obvious manner; it has an impetuosity which is particularly manifest during the stop choruses. Getz often resorted to the latter during this period, and plays this way as an overture to Down Beat. The title Blues for Mary Jane belonged to the album “The Steamer”, as did There’ll Never Be Another You, where Lou Levy’s solo is just as remarkable as the a cappella introduction played by Getz.
Stan always showed infallible flair in choosing pianists who could serve him as much as they could inspire him: Horace Silver, Duke Jordan, John Williams, and now Lou Levy, a long-time friend who’d been in Woody Herman’s orchestra together with the Four Brothers. At the time he joined Getz in the studio, Lou Levy was still one of Shorty Rogers’ “Giants”. He was a peerless accompanist, and justifiably sought-after — “I’ve accompanied everyone save Pavarotti” — and apart from possessing the remarkable rhythmical precision which seduced Getz, Lou Levy had a genuine gift for melody. While he’d listened to Bud Powell and Al Haig, he recognized he’d been influenced just as much by Nat King Cole, Teddy Wilson and Art Tatum (“a universe all on his own.”) His various partnerships with Getz would always unfold in a climate of mutual admiration: “When you played with Stan,” he recognized, “he would bring you up to a different creative level.” Accompanied by Leroy Vinnegar on bass and Shelly Manne on drums, Lou Levy assists Getz over two pieces — quite different from one another — which represent the two poles of the domain which Getz then intended to explore. Taken at an ultra-fast tempo — seventy-six beats to the minute — Stan gives a glimpse of real jubilation in S-h-i-n-e, and it erases none of his taste for melody, nor his architectural sense when improvising. Steve Voce asked him, “Wasn’t it difficult to play all those steaming choruses?” His answer: “It was as easy as falling off a log. In fact, it wasn’t until many months after the session, when someone told me, that I realised I’d played eighteen choruses…” As his partner for the occasion, Getz had chosen trumpeter Conte Candoli, a musician rather too quickly stored away as an anonymous Gillespie follower. Well, yes, he was an admirer; but he could easily give him a hiding: in technique, imagination, logic, and in the intensity of his discourse. He demonstrates that here.
Diametrically opposed to S-h-i-n-e we have A Handful of Stars, on whose subject Alain Gerber wrote that “listening to it proves that life is worth living.” This is one of those ballads where Stan Getz, by means of infinitely small touches, little changes and detours, used to insidiously amend the score written by the composer. He does that also with There’ll Never Be Another You and You’re Blasé. “They intrigue me. I don’t concentrate on any single aspect of the song – not the lyrics, not the tempo, not any of them per se. I like those romantic elements of easy, melodic tunes. I let the mood do what it wants. I never intend to do anything. It just comes out as the piece dictates. You will notice that I never even close my eyes, but my mind is on the music. No amount of intrusion upon my visual sense can detract from the music. Everything comes from within; no images are conjured up based on what I see.”8
Getz rarely took a long time to wrench their secrets from them. He did so in a given lapse of time which, in general, coincided with a tour or a booking somewhere; or even sometimes by chance in the context of a recording. Certain themes only appear once in his discography, like Over the Rainbow, the Harold Arlen song which the producers of “The Wizard of Oz” failed to include in the musical, on the pretext that nobody would remember the tune… It was in Stockholm, surrounded by Swedish musicians (among them the excellent pianist Bengt Hallberg) that Stan would propose his own version of it. He wasn’t inclined to routine when it came to building his own repertoire; nor did he give in to it when choosing his musicians.
Mose Allison: “It was thanks to Frank Isola that I got the job with Stan Getz. I didn’t audition for Stan, because he never really auditioned anybody – the job was the audition, and if he was satisfied with your playing on the night, you stayed with the band. While I was with him he probably used about ten or twelve drummers, often for one night only.”9 One of them was probably the valiant Jerry Segal who can be heard on Down Beat, which is taken from the album “The Soft Swing”; it’s the only evidence that remains to testify to the collaboration between Getz and Mose Allison. A totally unclassifiable pianist, singer, trumpeter and composer, Mose used to draw his inspiration both from rural blues and from Thelonious Monk; curiously enough, Getz never recorded any of Allison’s tunes, but in clubs, as a kind of intermission, he had occasion to play excerpts from his Back Ground Suite.
Both born in 1927, Stan Getz and Gerry Mulligan had a number of similarities due to music careers which were quite close: they both began in large swing orchestras, and they’d both been shaken when listening to Charlie Parker; and the pair also had a keen taste for the music of Lester Young. In enthusing over Gerry Mulligan’s brand new Quartet in ‘Down Beat’ dated February 25th 1953, Stan Getz had even officially proposed that Mulligan should join him. The suggestion was seen as quite ridiculous by Mulligan, who brushed him off in a lively manner. Getz should have thought twice before making such advances: the pair had already worked together and he’d had the opportunity to witness Gerry’s irascible character at first hand.
A great deal of water had gone under the bridge since those days, and, with both musicians now in Norman Granz’ stable, Getz was bound to come up against Mulligan sooner or later. We’ve already mentioned Norman’s penchant for putting one and one together, and Mulligan had already faced up with Thelonious Monk, and then Paul Desmond, in whose company Gerry inaugurated the series “Gerry Mulligan Meets…” At the top of the list of desirable adversaries was the name Stan Getz, and Stan, too, declared he was dying to cross swords with him. So the joust seemed an auspicious occasion.
Given Mulligan’s talent for crafting lovely little arrangements for small-groups, it has to be said that the global result of their confrontation leaves something to be desired: the two protagonists, without showing any complexes, take advantage of the encounter to abandon themselves to the joys of an informal jam session. Without being exactly generous, they have a great time, even swapping instruments on two titles.
In a context like this, setting up spontaneous improvisations can give rise to exceptional moments. Take Ballad and This Can’t Be Love for example. “There are some ballads on which I just don’t play anything but the melody. Lush Life is one of those. The melody is so beautiful, it says everything for me. There are others, too. Ballad, which Gerry Mulligan wrote for our album together, just flows easily; it’s rhythmically absorbing in itself.”10 You couldn’t put it better, and Stan’s only error was to believe that Gerry had written Ballad just for the session; actually it was already in the repertoire of his Californian Tentet… Here, solos, descants and collective improvisations compose one and the same chorus for two voices, a chorus whose value surpasses the sum of the (exceptional) talents present. This Can’t Be Love has the same state of grace even though they take it at a quick tempo.
Having decided to settle in Sweden, in summer 1958 Getz unpacked his bags and instruments and began playing with some of the best local musicians. In August he took a septet to Sundbyberg’s Europa Film Studio to record a session where each performance had been carefully premeditated. The music that came out of it was elaborate, complex, and in the spirit of the jazz played in Sweden at the time, situated in a direct line with experiments conducted by the Miles Davis Nonet on one side, and by Lennie Tristano on the other. Stockholm Street had been composed and arranged by Lars Gullin, an exceptional musician who played baritone with rare fluidity; his lyrical discourse bears the stamp of bittersweet melancholy which is part of Swedish folk music. Stockholm Street bathes in this atmosphere, and its complex harmonic structure serves as a pretext for an orchestration that is beautifully musical. Getz’ preference here is for meditative refinement, and he’s the only soloist, carried discreetly by the accompanying instruments. For the occasion, Lars Gullin had pulled off something which hadn’t tempted Mulligan. Or which Mulligan hadn’t been free to set up… It’s a possible hypothesis when you consider Norman Granz’ aversion to anything that even remotely resembled a rehearsal…
When Gerry Mulligan had retired from the jazz scene in 1953 after being arrested — James O’Grady boasted about that one, too — Stan Getz had been tempted to replace him alongside Chet Baker. The result was all the less convincing given the quasi-visceral antipathy which had declared itself between Chet and Stan. Whatever got into Norman Granz in February 1958? What was he thinking of when he pushed both of them into a record-session? And in Chicago, of all places, a city where neither of them had any ties… Getz had given a concert with Johnny Griffin there, at DuSable High School, playing with a rhythm section which turned out with him again in the studios at Robert Jordan & Associates Recorders. But Chet? He didn’t have a working-group, so he was probably playing somewhere in the Windy City with local sidemen… So what was Granz expecting? Pianist Jodie Christian admitted, “Nobody knew what we were going to do in the studio. It was kind of strange, a spur-of-the-moment thing. That’s the way it seemed.”
Stan Getz declared that what came out of it was the worst album in his career. He wasn’t totally wrong… with one exception, Half-Breed Apache. This Getz tune taken at an insane tempo (the word isn’t too strong) serves to let off steam for fifteen whole minutes, with the two musicians close to strangling each other. In a rage, Getz plays a breathtaking stop chorus and Chet, who won’t take it lying down, literally grabs the microphone with a violence and verbosity which barely resemble him. The rhythm section follows along in a fury orchestrated by Jodie Christian, whose pianistic conceptions are close to those of Horace Silver: “I used to dance. I’ve always been drawn more to rhythmic things than to harmonic things.” Half-Breed Apache suggests that anger can sometimes provide good counsel. When they found themselves together again in 1983 on the same tour, Chet and Stan diluted their wine… but only a little.
The fruits of the association between Getz and J. J. Johnson are diametrically opposed to the results of the above game of fools. The two musicians had already met in February 1950 with Miles Davis, first for a concert aired over radio, and then as part of “The Modern Jazz Society”, for the recording of an album under the combined aegis of John Lewis and Gunther Schuller. Two brief encounters, but they don’t really explain the closeness which instantly developed between them.
Getz couldn’t be taken off-guard by Johnson’s language: his perfect elocution had more than one thing in common with the way a valve-trombonist like Bob Brookmeyer played. The skilfully elaborate construction of his contributions, indeed his very concept of jazz, made Jay Jay close to Stan. Nevertheless… Listening to their collective improvisations on My Funny Valentine, it seems incredible that these were born in the fever of a concert given in front of an unruly audience. Music with this kind of balance, and of such a high level of inspiration, counts as one of those miraculous moments which jazz is sometimes capable of generating.
Getz was well aware of it. A journalist at Jazz Magazine asked him which album he preferred amongst those he’d shared as a leader, and Stan replied, “The one recorded at the Opera House with Jay Jay Johnson.” Indeed. Would that be the Opera House in Chicago, or the Shrine Auditorium in Los Angeles? Norman Granz never paid much attention to locations and precise dates, and the encounters between Jay Jay and Stan seem to have moved constantly from one venue to the other in the course of this album’s various releases and reissues. The moves were all the easier due to the fact that the pieces played in both concerts were the same. Wherever the Opera was located, the version of It Never Entered My Mind reproduced here is one of the great Getz performances. It would be no exaggeration to simply qualify it as a masterpiece. All on its own, It Never Entered My Mind would suffice to explain what Lester Young meant when, backstage at the Blue Note on the rue d’Artois in Paris, he shouted to Stan, “You are my singer.”
When he recorded Stockholm Street with Lars Gullin, Stan Getz was thirty-one; he’d been a professional musician since he’d been only half that age. Five years — from 1953 to 1958 — were enough for him to rid himself of his label as a “hopeful” — he had promise indeed, and he was also a marginal — and haul himself to the forefront of the jazz scene. From then on, like it or not, everyone knew that Getz was someone to be reckoned with. In the course of a career that would continue to extend another thirty years and more, Stan Getz would have his ups and downs but never lose that something special which made him the last of the Romantics, as he liked to remind people. One afternoon, in the Cimiez Gardens in Nice, he told me one of his secrets: “There are many who have copied me, well, more exactly, I’ve influenced a lot of people. But my style is very hard to copy. It’s too… simple.”11
Adapted by Martin Davies
from the French text of Alain Tercinet
© 2015 Frémeaux & Associés
1. Sleeve-notes, More West Coast Jazz with Stan Getz (Verve).
2. Burt Korall, Stan Getz – Soul & Lyricism, in Jazz Journal vol. 44, N°9, September 1991.
3. Donald L. Maggin, Dizzy - The Life and Times of John Birks Gillespie, Harper Entertainment, New York, 2005.
4. John O’Grady & Nolan Davis, O’Grady – The Life and Times of Hollywood’s No.1 Private Eye, J. P. Tarcher Inc., Los Angeles, 1974.
5. Don DeMicheal, A Long Look at Stan Getz in Down Beat, August 1996.
6. Sleeve-notes, Stan Getz ’57 (Verve).
7. Jean-Claude Fohrenbach, Visites aux grands ténors in Les Cahiers du Jazz N° 9, P.U.F., November 1996.
8. Arnold Jay Smith, Influentially Yours, Stan Getz in Down Beat, 12 August 1976.
9. Gordon Jack, Mose Allison in Jazz Journal vol. 48, N°6, June 1995.
10. Cf. (8).
11. Claude Carrière, Alain Tercinet, Stan’s Mood, interview in Jazz Hot N° 353, September 1978.
Il demeurerait toujours, avec un acharnement quelquefois héroïque, Stanislas Stanley Getz «?The Steamer?», c’est-à-dire l’un des plus généreux pourvoyeurs de beauté que le XXe siècle ait connus.
Alain Gerber
He would always remain, with a relentless determination that was sometimes heroic, Stanislas Stanley Getz “The Steamer”; in other words, one of the most generous purveyors of beauty known to the 20th century. Alain Gerber