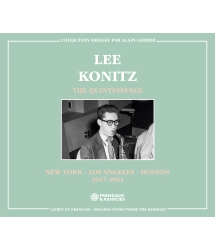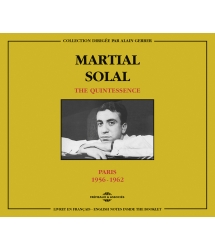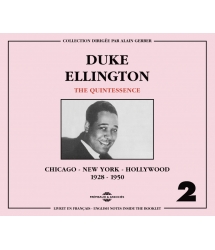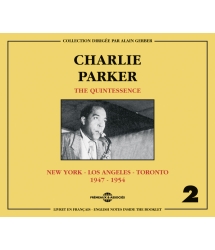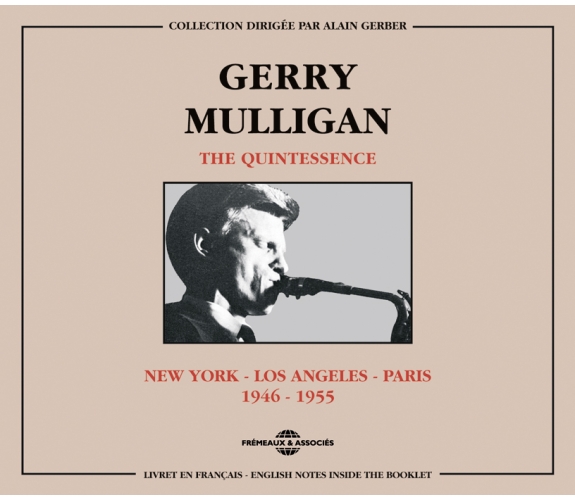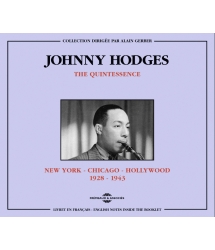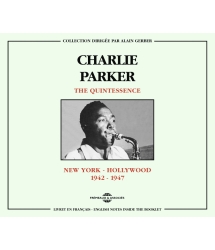- Our Catalog
- Philosophy
- Philosophers of the 20th century and today
- History of Philosophy (PUF)
- Counter-History and Brief Encyclopedia by Michel Onfray
- The philosophical work explained by Luc Ferry
- Ancient thought
- Thinkers of yesterday as seen by the philosophers of today
- Historical philosophical texts interpreted by great actors
- History
- Books (in French)
- Social science
- Historical words
- Audiobooks & Literature
- Our Catalog
- Jazz
- Blues
- Rock - Country - Cajun
- French song
- World music
- Africa
- France
- Québec / Canada
- Hawaï
- West Indies
- Caribbean
- Cuba & Afro-cubain
- Mexico
- South America
- Tango
- Brazil
- Tzigane / Gypsy
- Fado / Portugal
- Flamenco / Spain
- Yiddish / Israel
- China
- Tibet / Nepal
- Asia
- Indian Ocean / Madagascar
- Japan
- Indonesia
- Oceania
- India
- Bangladesh
- USSR / Communist songs
- World music / Miscellaneous
- Classical music
- Composers - Movie Soundtracks
- Sounds of nature
- Our Catalog
- Youth
- Philosophy
- News
- How to order ?
- Receive the catalog
- Manifesto
- Dictionnary











- Our Catalog
- Philosophy
- Philosophers of the 20th century and today
- History of Philosophy (PUF)
- Counter-History and Brief Encyclopedia by Michel Onfray
- The philosophical work explained by Luc Ferry
- Ancient thought
- Thinkers of yesterday as seen by the philosophers of today
- Historical philosophical texts interpreted by great actors
- History
- Books (in French)
- Social science
- Historical words
- Audiobooks & Literature
- Our Catalog
- Jazz
- Blues
- Rock - Country - Cajun
- French song
- World music
- Africa
- France
- Québec / Canada
- Hawaï
- West Indies
- Caribbean
- Cuba & Afro-cubain
- Mexico
- South America
- Tango
- Brazil
- Tzigane / Gypsy
- Fado / Portugal
- Flamenco / Spain
- Yiddish / Israel
- China
- Tibet / Nepal
- Asia
- Indian Ocean / Madagascar
- Japan
- Indonesia
- Oceania
- India
- Bangladesh
- USSR / Communist songs
- World music / Miscellaneous
- Classical music
- Composers - Movie Soundtracks
- Sounds of nature
- Our Catalog
- Youth
- Philosophy
- News
- How to order ?
- Receive the catalog
- Manifesto
- Dictionnary
NEW YORK LOS ANGELES PARIS 1946-1955
GERRY MULLIGAN
Ref.: FA246
EAN : 3448960224628
Artistic Direction : ALAIN GERBER, DANIEL NEVERS, ALAIN TERCINET
Label : Frémeaux & Associés
Total duration of the pack : 2 hours 27 minutes
Nbre. CD : 2
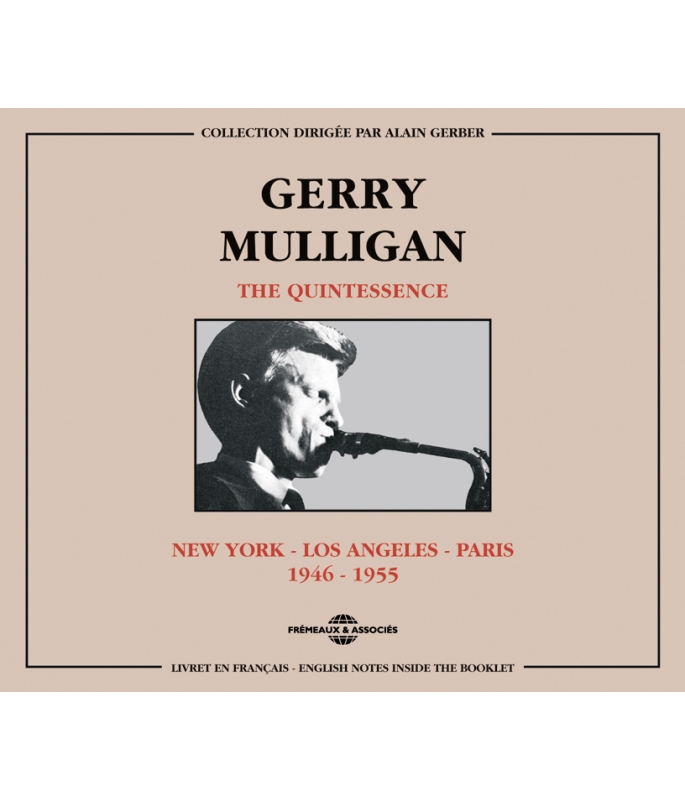
NEW YORK LOS ANGELES PARIS 1946-1955
NEW YORK LOS ANGELES PARIS 1946-1955
“I'm determined to come out with quality music which is good to hear and can interest as many enlightened listeners as possible, and using the chosen musical material in the best way possible.” Gerry Mulligan
-
PisteTitleMain artistAutorDurationRegistered in
-
1How High Is This MoonTRISCARIMORGAN LEWIS00:03:271946
-
2JeruGERRY MULLIGAN00:03:131949
-
3Wallington S GodchildGERRY MULLIGAN00:03:001949
-
4ElevationGERRY MULLIGANE LAWRENCE00:02:401949
-
5IglooGERRY MULLIGAN00:02:371949
-
6Gold RushGERRY MULLIGAN00:03:151949
-
7Between The Devil And The Deep Blue SeaGERRY MULLIGANHAROLD ARLEN00:03:151949
-
8RockerGERRY MULLIGAN00:03:071950
-
9So WhatMCGHEE00:02:501950
-
10I May Be WrongMCGHEESULLIVAN00:03:301950
-
11Gerry Mulligan's TooGERRY MULLIGAN00:17:551951
-
12Lullaby Of The LeavesGERRY MULLIGANJ YOUNG00:03:171952
-
13Bernie's TuneGERRY MULLIGAN00:02:551952
-
14Line For LyonsGERRY MULLIGAN00:02:391952
-
15Bark For BarksdaleGERRY MULLIGAN00:03:211952
-
16My Funny ValentineGERRY MULLIGANL HART00:03:031952
-
17Young BloodGERRY MULLIGAN00:03:171952
-
18The Lady is a TrampGERRY MULLIGANL HART00:03:151953
-
PisteTitleMain artistAutorDurationRegistered in
-
1A BalladBAKER00:02:571953
-
2Westwood WalkBAKER00:02:391953
-
3Walkin' ShoesBAKER00:03:431953
-
4Almost Like Being In LoveBAKERF LOEWE00:02:581953
-
5SextetBAKER00:03:011953
-
6Darn That DreamBAKERE DELANGE00:03:501953
-
7Five BrothersBROOKMEYER00:04:471954
-
8Moonlight In VermonBROOKMEYERJ BLACKBURN00:03:201954
-
9Piano BluesGERRY MULLIGAN00:05:421954
-
10I Know Don't Know WhyGERRY MULLIGAN00:05:371954
-
11Polka Dots And MoonbeamsGERRY MULLIGANJ BURKE00:07:101954
-
12The Red DoorGERRY MULLIGAN00:07:251954
-
13Happy HooliganGERRY MULLIGAN00:02:451955
-
14Duke Ellington Medley (Moon Mist In A SentimentalGERRY MULLIGAN00:04:301955
-
15DemantonGERRY MULLIGAN00:05:391955
-
16The Lady is a TrampGERRY MULLIGANL HART00:05:251955
-
17Everything Happens To MeGERRY MULLIGANT M ADAIR00:05:221955
Gerry Mulligan
GERRY MULLIGAN - QUINTESSENCE
NEW YORK LOS ANGELES PARIS 1946-1955
“Je pense - confiait un jour Stan Getz - que le jazz est surtout l’affaire des Noirs, mais quelques rares Blancs peuvent en jouer aussi bien, d’une façon aussi originale que n’importe quel Noir. Pas beaucoup, mais je sais être l’un d’eux... Pour ma part, j’en suis fermement convaincu, Bill Evans est un authentique créateur, tout comme Gerry Mulligan.”
Tout le monde ne fut pas toujours de cet avis. À un demi-siècle de distance, on a tendance à oublier ce que, à son corps défendant, Gerry représenta dans le monde occidental, au milieu des années 50 : à la fois un modèle et un contre-modèle, un héros et un anti-héros, une icône et une figure de jeu de massacre, un fétiche et une malédiction. De ce point de vue, il forma presque une trinité avec James Dean et Marlon Brando. Ce n’est nullement un hasard si la bande son du film de Marcel Carné Les Tricheurs (en 1958), inspiré par la rage et le mal de vivre d’“une certaine jeunesse”, emprunte son illustre Bernie’s Tune avec Chet Baker. En pleine guerre froide, alors que le Sénat des Etats-Unis venait à peine de dénoncer les excès du maccarthisme, Mulligan avait dans son pays le statut d’une divinité beatnick, adorée du routard, du motard, de l’auto-stoppeuse, du collégien perturbé, de l’enfiévré du samedi soir, du conscrit plus fragile que la fleur des champs, du pilier de juke-box, du don juan de fast food et des terreurs de station-service. Quelques années durant, plus qu’aucun autre musicien au monde peut-être - Elvis mis à part -, il incarna, dans une débauche de skaï, de décibels et de néons, aux yeux d’une génération turbulente et inquiète, pas forcément férue ni même frottée de jazz, le reniement des valeurs consacrées et cette “rébellion” de la jeunesse qui, hier comme aujourd’hui, s’employait à conjuguer mouvement de masse et individualisme effréné. Il avait une gueule, et même une silhouette. Il jouait d’un drôle d’instrument, long comme un jour sans pain, qui lui ressemblait beaucoup. Il avait sillonné les routes de l’Amérique. Il avait séjourné dans une ferme pénitentiaire pour détention illégale de stupéfiants. Bref, il semblait un porte-drapeau rêvé pour les crises d’adolescence qui se prolongent. Ce qui, bien sûr, allait lui valoir aussi la rancune des frileux et la rancœur des bien-pensants. Dans le jazz, de la même façon, la vénération sans doute excessive des uns lui assurerait, de la part des autres, une détestation dont la radicalité n’avait guère de sens. Sinon, pour les accusateurs, celui d’enraciner leurs critiques dans les obscures profondeurs des réactions viscérales, lesquelles n’ont pas à se justifier.
Sur cette rive de l’Atlantique en particulier, il fut de bon ton de le regarder de haut. De le tenir pour la créature de la mode, de la publicité et de la dépravation du sentiment esthétique. Il portait, d’ailleurs, sa faute sur sa figure : trop blanc, trop pâle, vidé du sang chaud qui était l’humeur sacrée du jazz. Pendant ce temps, Coleman Hawkins - le Faucon, le Grand Prédateur, l’Exécuteur de tous les saxophonistes qui n’étaient pas capables de lui tenir la dragée haute - déclarait publiquement que Gerry Mulligan était “habité par l’esprit”...
Surnommé “Jeru” (mais par les musiciens plutôt que par les amateurs), Gerald Joseph Mulligan est né à New York le 6 avril 1927. Pour l’état civil, il n’était irlandais qu’aux trois quarts. Pour tous ceux qui le fréquentèrent, il l’était de la pointe des orteils jusqu’au sommet de la tête qu’il avait, à l’image de ses ancêtres, fort près du bonnet. Catholique irlandais avec tout ce que cela suppose : principes rigides, éducation stricte, coup de poing facile et solide dose d’humour. Sans parler des réflexes d’enfant gâté, voire de fils unique, alors qu’il était le dernier né de quatre frères. Pur produit de la classe moyenne, il eut la chance d’avoir un père qui encouragea plutôt son intérêt, précoce, pour la musique, né de sa fascination pour la vie itinérante d’une célébrité de l’époque, le cornettiste Red Nichols.
Il commença par jouer du piano, comme beaucoup d’enfants à cette époque. Puis il se mit à la clarinette, avant de passer au saxophone alto. Ces instruments, il se les était payés de sa poche, en travaillant après l’école et en économisant sou par sou. Après quoi, il ajouta le ténor à sa panoplie, se familiarisa avec trois instruments à pistons : le cornet, la trompette et le bugle. En fait, le baryton fut le bon dernier à passer entre ses mains. C’est qu’il n’avait découvert que sur le tard Harry Carney, l’une des chevilles ouvrières du Duke Ellington Orchestra, et le personnage qui, dans ce domaine particulier, était à l’origine de la plupart des vocations. Quoique beaucoup moins prestigieux, un autre spécialiste de l’instrument fit grosse impression sur lui à l’âge des culottes courtes : Lloyd “Skip” Martin. Gerry fut initié à la théorie musicale par son professeur de clarinette, Sammy Correnti. Lequel lui inculquera dans la foulée quelques rudiments d’orchestration.
En 1944, la famille Mulligan déménage de New York à Philadelphie. C’est dans un collège de cette ville que le fils cadet mettra sur pied sa première formation : un orchestre de danse. Un peu plus tard, une station de radio locale, W.C.A.U., lui achète deux arrangements pour sa propre formation, dirigée par Elliot Lawrence, lequel se trouve si satisfait de ses services qu’il l’incite à devenir son fournisseur de partitions attitré. Pendant les vacances scolaires, Gerry suit en tournée l’orchestre de Tommy Tucker. Heureuse initiative : c’est à cette occasion qu’il entend le tout premier des big bands bebop réguliers, celui de Billy Eckstine dont Dizzy Gillespie assume les fonctions de directeur musical. C’est une révélation. Sur-le-champ, il décide de devenir un “moderniste” à son tour. Il accepte alors l’invitation de W.C.A.U, dont il reste le salarié pendant environ un an. À la fin de l’année 1945, il regagne New York, où le petit monde du jazz est en pleine ébullition. Sa rencontre avec Charlie Parker sera décisive : “En tant que soliste, le moins qu’on puisse dire était que je ne me sentais pas très sûr de moi. C’est lui qui, littéralement, m’a poussé sur scène un beau soir. Il était à mes yeux le plus grand et il m’ordonnait de me jeter à l’eau. C’est ce qui m’a donné la confiance en moi dont je manquais.” Il fait ensuite la connaissance de Gene Krupa, pour lequel il jouera et écrira des arrangements. Celui de How High The Moon présente cette particularité d’inclure une référence très directe au bebop, via le thème de Ornithology.
Le batteur et lui sont comme chien et chat. Ils finiront par se séparer. Krupa, par la suite, n’en déclarera pas moins : “En fait son attitude me plaisait bien. J’admirais Gerry pour cela. Il n’y a que trop d’obséquieux dans notre profession.” Mulligan restera de ces gens qui ont l’admiration facile, mais la soumission impossible : un homme libre, aussi susceptible que généreux. En 1947, il rejoint un autre big band, celui de Claude Thornhill, le seul ensemble de l’époque à présenter au public deux cornistes et un joueur de tuba. À quoi s’ajoute l’utilisation très particulière que fait de cet effectif l’arrangeur en chef : un dénommé Gil Evans, avec lequel le nouveau venu se lie d’amitié. “Sa fréquentation m’a permis d’accomplir de rapides progrès en matière d’écriture musicale ; qui plus est sans renoncer à ma personnalité.” Deux autres hommes de plume sont impliqués dans l’entreprise : George Russell et John Carisi. Tout ce petit monde se retrouvera bientôt aux côtés de Miles Davis, dont le nonette prend forme en un lieu pénombreux, qualifié de magique par tous ceux qui s’y croisent : le studio en sous-sol que Gil occupe derrière une blanchisserie chinoise, sur la 55e Rue Ouest (âgé de trente-six ans, et d’un calme olympien, il faisait figure de vieux sage). Miles affirmait : “C’est Gerry qui nous a écrit les arrangements les plus confortables, les seuls qui, le jour venu, soient sortis avec facilité et dans le bonheur.” Ce à quoi l’intéressé rétorquait : “Peut-être parce que, pour moi, le jazz c’est d’abord et avant tout du plaisir. Cette musique est faite pour être jouée, non pour que l’on coupe les cheveux en quatre à son propos.” Et de faire cet aveu : “Ce que j’ai réalisé dans les années 50, ce n’était pas du neuf : tout était basé sur ce que j’avais écrit pour Miles.” Il confiera à ce dernier qu’en dépit de tous ses efforts, jamais plus il n’avait réussi à obtenir le même son, même si son tentette de 1953 - avec cor et tuba lui aussi - n’était qu’à deux doigts de la formule originale.
Son credo en matière d’arrangement : “Alléger, alléger... C’est le grand secret quand on veut fabriquer du naturel. Un arrangement consiste à dire le plus clairement et le plus simplement du monde ce qu’on veut dire. Point. Telle a toujours été ma conviction profonde. Et pas seulement la mienne. Dizzy Gillespie disait que ‘ce qui compte le plus n’est pas ce que vous mettez dans un arrangement, c’est ce que vous décidez de ne pas y laisser.’ Le naturel est à ce prix. Or, en musique, selon moi, il faut que les événements surviennent comme les fruits mûrs tombent de l’arbre.”
Sans conteste, l’événement le plus marquant de la vie du jazz sur la côte pacifique des États-Unis, dans la première moitié des années 50, fut la fondation, en 1952, du pianoless quartet mulliganien. L’esthétique de ce groupe ne pouvait pas ne pas influer sur le jazz west coast (une variété de cool, mâtinée de néo-classicisme). Gerry, pourtant, n’appréciait guère qu’on lui en fît compliment. Comme son complice Bob Brookmeyer, il professait un grand mépris à l’égard du style californien, qu’il réduisait à une simple émanation du kentonisme. Or Stan Kenton, auquel il avait confié de fort belles choses (Young Blood n’est pas la seule), mais avec qui c’est peu dire qu’il ne s’était pas entendu, représentait à ses yeux le comble du pompeux et du pompier. Toutefois, le corniste et arrangeur John Graas a risqué sur ce point une observation qui, moins entachée de subjectivité et, surtout, plus argumentée, mérite d’être prise en compte : “Je pense que l’influence de Mulligan s’est exercée sur le jazz west coast dans la manière de traiter les lignes mélodiques et dans la recherche, pour obtenir certains effets, de batteurs au jeu plus retenu tels que Larry Bunker et Chico Hamilton.” On retiendra de cette controverse que les conceptions de Gerry ont, au minimum, inspiré certains west-coasters dans quelques-unes de leurs oeuvres. Plus que sur les jazzmen de l’Ouest, cependant, elles ont eu un impact sur tout un groupe de musiciens du Sud. Mais ce n’est pas à la partie méridionale des États-Unis que l’on songe : c’est au sud de ce sud. À l’Amérique latine, et singulièrement au Brésil. Avec Stan Getz, Miles Davis et quelques autres - mais peut-être plus qu’eux -, il y faisait au milieu des années 50 l’admiration de personnages comme Antonio Carlos Jobim, lequel s’est largement exprimé sur sa dette à l’égard du baryton. On est en droit d’affirmer que la bossa nova n’aurait pas été tout à fait ce qu’elle fut sans les arrangements de Mulligan pour le nonette de Miles, sans le son de Mulligan dans le cadre de son quartette puis, à partir de la fin de l’année 1954, de son sextette avec Brookmeyer et Zoot Sims.
Et le soliste ? Quelqu’un lui avait dit un jour, sans ambages : “Avec le talent que tu as pour trousser une partition, pourquoi t’empoisonnes-tu l’existence à souffler dans un instrument ?” Il fut, c’est un fait, un peu moins admirable dans ce rôle que dans celui d’arrangeur-compositeur et de chef d’orchestre. Nuance qui ne fait pas ipso facto de lui, héritier de Lester Young comme tant d’autres, un improvisateur du second rayon. “Artiste à la sensibilité exquise, Gerry Mulligan vaut surtout par l’émotion qui se dégage de ses solos”, a écrit André Hodeir. Déjà, ce n’est pas rien. Il faut aussi lui reconnaître le mérite d’un inépuisable enthousiasme. À la fin des années 40 et au début de la décennie suivante, quand la musique réussissait à peine à le faire vivre, il ne vivait lui, que pour et par la musique. “Habité par l’esprit”, hanté par le désir de jouer, il resterait jusqu’au bout le genre de musicien qui ne peut entendre parler d’une jam à l’autre bout de la ville sans essayer de s’y infiltrer, ayant vidé ses poches pour prendre le taxi. Il aurait voulu être de toutes les fêtes. Participer à toutes les répétitions. Donner la réplique à tout le monde et son frère, disposé à pratiquer tour à tour, pourvu qu’il ait l’occasion d’y prendre du plaisir, tous les styles en usage après 1945, du plus traditionnel au plus contemporain. Si King Oliver avait encore été vivant, voire Buddy Bolden, un jour ou l’autre Jeru aurait trouvé l’occasion de faire le bœuf en leur compagnie.
On comprend que l’arrangeur George Russell l’ait baptisé “Mr. Mainstream”, c’est-à-dire en somme “l’homme du milieu des choses”. Celui qui s’adapte à tous les partenaires que le hasard lui assigne. Brubeck, dont il deviendrait en 1968 l’interlocuteur privilégié, a dit de lui : “Quand vous l’écoutez, vous avez le sentiment d’entendre rassemblés dans une même interprétation, le présent, le passé et l’avenir du jazz”. Paul Desmond, auquel il succéda dans ce rôle, a enfoncé le clou : “En nul autre instrumentiste peut-être vous ne pourrez trouver une progression si limpide du dixieland au swing, du swing au be-bop et au-delà du be-bop, inscrite dans le même disque, sinon dans le même solo.” Grâce à quoi, la musique de Gerald Joseph Mulligan, mort à Darien (Connecticut) le 20 janvier 1996, aura été l’un des carrefours les plus fréquentés de l’histoire du jazz. Comment pourrions-nous la contourner, - et, d’ailleurs, pour quel bénéfice?
“Je me rappelle avoir vu, quand j’étais en culottes courtes, le bus du cornettiste Red Nichols, garé devant un hôtel. C’était un petit Greyhound. On avait peint sur ses flancs Red Nichols & The Five Pennies. Ce véhicule symbolisait à mes yeux le voyage et l’aventure. C’est à cet instant précis que je me suis juré de devenir musicien et de partir sur la route à mon tour. Après cela, je n’ai plus jamais été le même homme.” Toutes proportions gardées, nous non plus.
Alain Gerber
© FRÉMEAUX & ASSOCIÉS - GROUPE FRÉMEAUX COLOMBINI SAS 2007
GERRY MULLIGAN
A propos de la présente sélection
Qui aurait pu imaginer que la chanson How High the Moon, passée parfaitement inaperçue dans la revue “Two for the Show”, puisse devenir la coqueluche des musiciens de jazz ? Certainement pas ses auteurs, Nancy Hamilton et Morgan Lewis, non plus sans doute que Benny Goodman qui, le premier, l’avait enregistrée le 7 février 1940, la veille de la première du show à Broadway.
En 1946, How High the Moon n’avait plus rien d’une nouveauté. Tout le monde ou presque, de King Cole à Django Reinhardt en passant par Art Tatum, Teddy Wilson, Dave Brubeck, en avait donné sa version et Ella Fitzgerald n’allait pas tarder à le faire. Mulligan s’y était déjà attaqué l’année précédente pour le compte d’Elliott Lawrence, lui fournissant une partition somme toute assez traditionnelle. Celle qu’il destinait à Gene Krupa l’était beaucoup moins. Dans un arrangement nerveux, moins respectueux de la structure d’origine du morceau, s’interpolait une longue citation d’Ornithology, la paraphrase que Charlie Parker avait tiré de How High the Moon. (1) La greffe n’engendrait pas le moindre hiatus dans une partition donnant la parole à des solistes – Charlie Kennedy (as), Dick Taylor (tb), Red Rodney (tp) et Charlie Ventura (ts) – que les révolutionnaires du Minton’s n’avaient pas laissés indifférents. Pour passionné qu’il fût par le bop, Mulligan ne faisait pas pour autant du passé table rase et ne reniait aucunement les leçons reçues des arrangeurs de la “Swing Era”. Il devait confier à Leonard Feather : “Gil (Evans) ne fut pas le seul à exercer une influence sur ma façon d’écrire ; il fut l’ultime à en avoir une. Avant, il y a eu Ben Homer qui écrivit de belles choses pour Tommy Tucker ainsi que Eddie Finckel chez Krupa. Ils eurent sur moi une influence majeure. George Williams m’inspira sur le plan de l’écriture pour sections. (…) J’ai aussi été très marqué par la manière dont Bobby Sherwood écrivait pour les ballades .(…) Ralph Burns et Neal Hefti m’ont également impressionné.” (2)
Vouloir faire avancer les choses sans jouer à l’iconoclaste, voilà ce que reflètent deux partitions conçues pour Elliott Lawrence dans les années 1945/47 (reprises en 1949 alors que Mulligan avait rejoint l’orchestre), Between the Devil and the Deep Blue Sea et Elevation. Même revue et corrigée, la chanson d’Harold Arlen continue à assurer son rôle de “musique à faire danser” malgré le mélange des genres dont Gerry s’était rendu coupable : avant le solo de trombone dû à Sy Berger et son propre chorus, la section de saxes exécute une paraphrase que Parker aurait pu inventer alors même qu’en fin de morceau, les cuivres exécutent des figures qui n’auraient pas déparé une interprétation de Glenn Miller.
En décembre 1947, au Palladium Ballroom d’Hollywood, Elliott Lawrence présenta Elevation comme une composition originale de Mulligan qui insufflait les trouvailles du bop dans une partition destinée à un orchestre swing. On ne saurait mieux définir cette pièce alors exemplaire de son auteur qui l’adaptera quelques années plus tard pour son propre ensemble. En 1955 Elliott Lawrence consacra un album entier à des arrangements que Mulligan avait composés à son intention. L’ambiguïté qui avait été la marque de fabrique de ses partitions “d’époque” a disparu de l’excellent Happy Hooligan tout de bonne humeur et de légèreté, qui inspire particulièrement Al Cohn. A cette période, Gerry ne doit déjà plus rien à personne.
Mulligan était entré pour un an dans l’orchestre de Gene Krupa poussé par la promesse qui lui avait été faite de trouver une place parmi les instrumentistes ; l’engagement n’ayant été qu’à moitié tenu, il reprit sa liberté. En laissant à son ex-employeur une partition promise à un joli succès, Disc Jockey Jump.
“Après que j’ai eu arrangé et joué du ténor et de l’alto pour divers orchestres pendant un couple d’années, je suis retourné à Philadelphie – j’avais alors 19 ans – et, pour la première fois, je me suis concentré sur le baryton.” (3). Un instrument qu’il jugeait apte à figurer dans tous les amalgames.
Alors qu’il appartenait encore à la formation de Krupa, Mulligan avait fait la connaissance de Gil Evans - il admirait son œuvre - durant une répétition de l’orchestre Claude Thornhill qui l’intriguait fort. A Philadelphie, Gerry reçut un mot de Gil Evans lui demandant ce qu’il faisait là-bas alors que tant de choses se passaient à New York. Il le prit au mot et débarqua dans la Grosse Pomme. Gil persuada Thornhill de l’engager comme arrangeur et en tant qu’instrumentiste, éventuellement. Ce qui plaça un temps Gerry dans une section de saxes comprenant Lee Konitz et Danny Polo. De cette formation - “la plus sous-estimée et la meilleure de son époque” -, Mulligan retiendra l’extraordinaire efficacité d’un son d’ensemble qui, tout en douceur, investissait complètement une salle.
Gil Evans habitait un sous-sol de la 55ème Rue fréquenté par tout un groupe de jeunes musiciens plus ou moins en colère. Dont Miles Davis. Tous discutaient de l’après-bop en traversant une période de vaches maigres. George Russell se souviendra qu’à cinq - Gil Evans, Johnny Carisi, John Lewis, lui-même et Mulligan qui composa l’intro - , ils concoctèrent un arrangement pour Buddy Johnson. Et le signèrent tous afin d’impressionner le chef d’orchestre qui, du coup, acheta la partition - assez mauvaise selon Russell.
Gil Evans travaillait sur l’idée de transposer le “son Thornhill” à une moyenne formation qui entourerait un soliste acceptant de n’être que la partie d’un tout ; un projet qui passionnait Mulligan. Pressenti, Charlie Parker tergiversa ; Miles qui venait justement de le quitter, se déclara intéressé car il portait une haute estime à Gil et à l’orchestre Thornhill. Fut alors mis sur pied un nonette à la composition inusitée - trompette, trombone, cor, tuba, saxophones alto et baryton, piano, basse et batterie – , une instrumentation à la fois adéquate et minimale pour réaliser leur projet. L’écriture s’attachait au son d’ensemble, à la recherche de sonorités rares obtenues par l’association d’instruments. Elle recherchait l’unité en donnant mission aux ensembles d’introduire un solo, de l’accompagner et de le prolonger ; le tout en privilégiant la retenue dans l’expression.
Du 30 août au 4 septembre puis du 13 au 18 septembre 1948, le Royal Roost programma le “Miles Davis Band - Arrangements by Gerry Mulligan, Gil Evans and John Lewis”. Une formulation parfaitement inédite qui n’attira guère le public. Prévoyant, Miles Davis avait signé avec Pete Rugolo un contrat qui confiait au label Capitol le soin d’enregistrer son orchestre. Le Nonet n’ayant eu qu’une brève existence, les séances s’échelonnèrent sur plus d’un an avec un personnel changeant.
Baptisé d’après le surnom que Miles donnait à Gerry, Jeru contient l’une des meilleures interventions du baryton, d’une fluidité de langage encore rare sur l’instrument à cette époque et dans ce style. Quant à la partition dont il est le responsable, elle inclut des passages en 3/4, une audace qu’André Hodeir releva dans son ouvrage dans “Hommes et problèmes du jazz”. Gravé plus tardivement, Rocker est l’un des rares thèmes de Mulligan qui soit vraiment bop - Parker l’interprétera d’ailleurs avec son ensemble à cordes. Retaillé sur mesure pour Miles, il perd en agressivité ce qu’il gagne en poésie. Des partitions de Gerry, Miles reconnaîtra qu’“elles furent les seules à se mettre en place facilement, agréablement, rapidement.” (4) Pour sa part l’intéressé dira de ces séances : “Je me considère comme un privilégié d’y avoir participé et je remercie ma bonne étoile, quelle qu’elle soit, de m’avoir conduit là. Il y a comme une sorte de perfection dans ces enregistrements.” (5)
En avril 1949, figurait à l’affiche du Bop City le “Kai Winding Sextet”. Un ensemble à géométrie variable - pourvu, en studio, de raisons sociales diverses - , représentatif d’une autre vision de l’après-bop dont Mulligan était l’une des chevilles ouvrières. Auteur de certaines des compositions, il signait des arrangements qui, pour être moins poussés et aventureux que ceux écrits pour le Nonet de Miles Davis, possédaient leur efficacité en jouant sur une interaction entre les voix du trombone de Kai Winding, du ténor de Brew Moore et la sienne propre auxquelles venait s’ajouter à l’occasion la trompette de Jerry Lloyd.
Kai Winding était un bopper de la première heure ; Brew Moore, un disciple inconditionnel de Lester Young. En tant que soliste, Mulligan n’entendait pas marcher sur les brisées de Leo Parker ou de Serge Chaloff qu’il n’aimait guère : “Au travers de son instrument, Serge ne s’exprimait pas comme un compositeur ainsi que Bird le faisait. Quand Bird jouait des clichés , au moins c’étaient les siens.” (6). Par contre, il ne tarissait pas d’éloges sur Adrian Rollini et Harry Carney qui pour sa part jugea très justement le jeu de Gerry : “Je ne doute pas que son expérience comme arrangeur l’a beaucoup aidé. Je sais qu’il aime “jammer” chaque fois qu’il le peut mais l’esprit d’un arrangeur est celui d’un architecte : cela signifie des solos qui ont une forme et une construction.”
Revu en fonction de ce triumvirat, Wallington’s Godchild perd quelque peu de la tension qui sous-tendait la version du Nonet pour mieux séduire. Bien qu’Igloo signé de Jerry Lloyd soit un thème bop chimiquement pur – son auteur s’y fait entendre dans un style un peu hésitant -, le traitement des ensembles et les chorus de Brew Moore et de Mulligan n’usent que fort peu du vocabulaire défini au Minton’s. L’orthodoxie est garantie par les batteurs Max Roach, Roy Haynes, Charlie Perry, le bassiste Curley Russell et George Wallington, le pianiste engagé dans la première formation bop que Dizzy Gillespie avait présenté en janvier 1944 à l’Onyx. “Mon drame est que tout le monde joue bop et je n’y trouve pas la moindre place pour moi” déplorait Brew Moore. Pourtant, c’est dans ce cadre qui flirtait outrageusement avec justement ce qui le dérangeait qu’il signa quelques-uns de ses meilleurs chorus. Dont celui de Gold Rush.
Chubby Jackson qui avait été le bassiste attitré du célèbre First Herd de Woody Herman, s’était produit au mois de mars 1949 à la tête d’une grande formation d’obédience bop. Avaient été gravés quatre morceaux qui furent plutôt bien reçus. L’année suivante, il décida de renouveler l’expérience. Les membres du premier ensemble important à être enregistré par le label Prestige se retrouvèrent donc aux studios Cinemart de New York. Dans une pièce qui était si exiguë que la section de trompette joua face à l’un des murs pour obtenir une balance correcte… Pour détendre l’atmosphère, Chubby Jackson se laissa aller à son goût prononcé pour le port de faux nez surmontés de lunettes fantaisistes. Il en offrit généreusement à Georgie Auld et Don Lamond. Gerry Mulligan - son sens de l’humour ne correspondait pas vraiment à celui de Chubby - n’apprécia guère si je me réfère à certains grognements nettement désapprobateurs par lesquels il commenta en ma présence les faits et gestes du leader.
Assez hétéroclite, le personnel était en grande partie composé de ceux qui, à l’exemple de Zoot Sims, J.J. Johnson ou Mulligan, participaient aux jam-sessions du Tin Pan Alley, le bar tenu par le saxophoniste Georgie Auld. Pour la première fois, Gerry Mulligan enregistrait avec son complice Zoot Sims. A l’exception d’une intervention de Charlie Kennedy à l’alto, ils se partagent l’intégralité de So What alias Apple Core alors que Gerry seul se taille la part du lion au long de I May be Wrong. Ce choix d’une chanson remontant à 1929 - il la reprendra pour son compte par la suite -, témoigne de la curiosité dont Mulligan savait faire preuve à l’égard des “songs” venus de Broadway. Certains standards - on pense à Makin’ Whoopee ou My Funny Valentine – lui doivent le regain d’intérêt qu’ils suscitèrent.
Une séance réalisée sous la houlette de Chubby Jackson, une ultime retrouvaille avec le Nonet, quatre faces gravées en compagnie de la chanteuse Mary Ann McCall, une participation à “l’orchestre qui n’exista jamais” réuni autour de Parker par l’arrangeur Gene Roland sans jamais dépasser le stade des répétitions, un engagement dans l’ensemble de Stan Getz à l’Apollo, l’année 1950 ne fut guère laborieuse pour Mulligan. Ce qui ne contribuait pas à apaiser son caractère déjà irascible : il fit un scandale durant une séance d’enregistrement dirigée par Herbie Fields et échangea quelques invectives avec Benny Goodman dont la patience n’était pas non plus la qualité première. Deux chefs d’orchestre qui avaient eu le malheur de ne pas respecter à la lettre ses arrangements...
En fait Mulligan ne voulait plus être l’employé de personne. Encouragé par sa compagne du moment, Gail Madden qui prétendait soigner la toxicomanie par la persuasion et le sommeil – ce qui le concernait au premier chef – , il mit sur pied une formation dite de “répétition” afin d’entendre ses partitions telles qu’il les avait conçues. Buddy Clark : “Gerry en était réduit à jouer en plein air, quelquefois il y avait deux ou trois basses pour suppléer à l’absence de piano. Nous avons même donné le premier concert de jazz moderne dans les Catskills – autour de la piscine du Waldemere Hotel.” (7)
Au mois d’août 1951, Gerry finit enfin par pénétrer dans un studio d’enregistrement à la tête de son propre ensemble ; un nonette sécable à la demande, agrémenté de la présence de Gail Madden aux maraccas. Des huit morceaux mis en boîte, Mulligan’s Too est le plus inattendu : il couvre une face entière de LP 25cm. Soutenu par la seule rythmique, Mulligan se contente de dialoguer avec Allen Eager ; un personnage hors du commun - il suscita l’intérêt de Jack Kerouac – avec lequel il avait coutume d’aller jouer à Central Park. Eager s’était frotté aux boppers dans l’ensemble que Tadd Dameron avait présenté en 1948 au Royal Roost. Il y avait côtoyé aussi bien Fats Navarro que Wardell Gray, Kenny Clarke ou Milt Jackson. Pratiquant un jeu net, dépouillé, il se montrait un partenaire idéal pour Mulligan, les deux saxophonistes communiant dans une même révérence envers Lester Young.
Las de New York, désenchanté, Gerry entreprend en compagnie de Gail Madden, une traversée des Etats-Unis en auto-stop. Pour finalement échouer en Californie après avoir fait étape à Albuquerque. Sa compagne connaît Stan Kenton et tente d’obtenir de sa part un poste d’arrangeur pour Gerry. Le chef d’orchestre temporise, arguant du fait que le style de Mulligan qui s’efforçait de faire sonner un grand ensemble comme une petite formation n’avait rien à voir avec le sien propre. Finalement il se laissa convaincre. Mulligan : “Il y avait un morceau intitulé Young Blood que j’avais écrit en pestant parce que j’essayais vraiment de lui plaire. C’était son orchestre, il achetait l’arrangement, aussi j’essayais d’écrire quelque chose qui soit à sa convenance mais vraiment ce n’était pas dans mes cordes de concevoir de larges nappes de sons. J’ai toujours pensé plus horizontalement que verticalement mais j’essayais de le satisfaire. (…) Quand ils l’ont enregistré - plus tard et en mon absence -, ils ont doublé le tempo!” (8) Evidemment. Avec la publication récente de l’intégralité des morceaux gravés par le Concert Jazz Band de Mulligan, on a pu avoir une idée précise de la façon dont Gerry envisageait le rendu de sa composition. Il n’empêche, Young Blood façon Kenton compte parmi les chefs-d’œuvre gravés par l’orchestre durant cette période. Après tout, comme l’affirmait Alexandre Dumas “On a le droit de violer l’histoire à condition de lui faire de beaux enfants.”
Les choses ne prirent vraiment une tournure intéressante pour Mulligan qu’au printemps 1952. En charge de la promotion du Haig’s, un petit club situé à Los Angeles sur Wilshire Boulevard, Richard Bock lui demanda d’assurer les soirées du lundi en s’entourant de partenaires disponibles sur l’heure. Défileront ainsi Jimmy Rowles, Ernie Royal, Red Mitchell et quelques autres dont un trompettiste nouveau venu que Charlie Parker s’était choisi comme interlocuteur en Californie, Chesney H. Baker.
Gerry Mulligan : “Je pense que Chet possédait une espèce de talent hors normes. Il a surgi et personne ne pouvait dire qui l’avait influencé ni où il avait appris ce qu’il savait. On se trouvait en face de quelque chose de rare : un talent qui émergeait tout armé (…) Chet est l’un des meilleurs musiciens intuitifs que j’aie jamais connus.”(10) Une entente musicale quasi médiumnique s’installa entre les deux hommes au sein d’un quartette composé d’une trompette, d’un saxo baryton, d’une basse et d’une batterie. Pas de piano. Mulligan considère qu’il s’agit d’un instrument trop riche pour le condamner à un rôle secondaire et, en sus, lorsqu’il figure dans une rythmique, les instruments mélodiques doivent s’y adapter. Selon Mulligan l’idée du “Pianoless Quartet” revenait à Gail Madden. Certains insinuèrent que cette option découlait en fait d’une contrainte liée à la formation programmée au Haig, celle de Red Norvo, qui ne comportait pas cet instrument. Une hypothèse émise par des gens qui connaissaient bien mal Mulligan… Quoiqu’il en soit le succès est au rendez-vous.
Sans enregistrement, ses efforts risquent de bénéficier seulement d’une estime locale. Mulligan travaille au corps Richard Bock, peu enthousiaste à l’idée de replonger dans le marigot de l’industrie phonographique au sein duquel il avait déjà pataugé. D’un autre côté, le quartette est parfaitement vendable… Roy Harte, batteur et propriétaire du Drum City de Los Angeles, avance deux cent cinquante dollars et fournit un local. Pacific Jazz est né.
La première séance se déroule au domicile de l’ingénieur du son, Phil Turesky. Sont mis en boîte Bernie’s Tune et Lullaby of the Leaves, les deux faces d’un 78 t qui, publié à la fin de l’année, reçoit un accueil triomphal. Aucun des deux thèmes n’est de Gerry, cependant tout le monde lui attribuera la paternité de Bernie’s Tune tellement ce morceau est indissolublement lié au quartette. De Lullaby of the Leaves, une chansonnette créée en 1932, le quartette fait une pièce “impressionniste”. Contrepoints spontanés – les arrangements étaient vaguement esquissés dans la voiture qui emmenait Chet et Gerry au Haig’s –, réhabilitation de l’improvisation collective – on parlera de néo-dixieland –, un climat privilégiant la litote musicale sans pour autant refuser la séduction au premier degré, le jazz prenait là un fameux bain de fraîcheur après les tornades du bop. Le quartette est engagé au Blackhawk de San Francisco suscitant dans le numéro de Down Beat daté du 22 octobre 1952 un article enthousiaste qui proclamait que “le Quartette de Gerry Mulligan constitue certainement le son le plus rafraîchissant et le plus intéressant à avoir émergé dans le jazz depuis un certain temps.” L’année suivante, l’auteur de ce jugement, Ralph J. Gleason, devra remettre le couvert pour défendre le quartette contre les attaques de Nat Hentoff qui, d’habitude mieux inspiré, avait prophétisé que dans vingt-cinq ans on ne l’écouterait pas plus que l’on n’écoutait Muggsy Spanier. New York n’entendait pas s’en laisser conter par la Californie.
Au cours de leur premier passage à San Francisco, Chet et Mulligan gravent pour Fantasy quelques morceaux. Deux d’entre eux connaîtront une belle fortune : Line for Lyons, un thème que Mulligan gardera constamment à son répertoire et My Funny Valentine dont la mélodie douce-amère, signée Rodgers et Hart, se voyait détaillée avec délicatesse par un Chet recueilli, émouvant dans sa fragilité désenchantée. Malgré un beau chorus mélodique de Chico Hamilton, Bark for Barksdale ne connut pas la même gloire, ce qui est quelque peu injuste en regard de la dose d’humour qui s’y dissimulait. Pour le même label mais à Hollywood cette fois, le quartette mit en boîte The Lady Is a Tramp, une autre chanson du tandem Lorenz et Hart, qui allait comme un gant à la formation ; Mulligan y est superbe et les contre-chants de Chet, irréfutables. Ce dernier jugera à bon escient que ses interventions sur Darn That Dream qu’accompagnaient une partie vocale à bouche fermée exécutée par Mulligan, Carson Smith et Larry Bunker, figuraient parmi les meilleures qu’il ait gravées avec le quartette. Qui, ici, revisitait un arrangement que Gerry avait écrit pour le Nonet de Miles augmenté du chanteur Kenneth Hagood.
Malgré le succès rencontré par une formule qui reposait sur l’une de ces ententes musicales exceptionnelles dont l’histoire du jazz n’est guère prodigue, elle n’était que transitoire dans l’esprit de Gerry: “Pendant que nous jouions au Haig’s avec le quartette, j’avais mis sur pied un Tentet en tant qu’orchestre de répétition afin d’avoir l’occasion d’écrire pour un ensemble (…) Je pense que, musicalement, il fonctionnait parfaitement autour de l’idée qui servait de base au quartette et il était très facile d’écrire pour lui. J’aurais voulu continuer l’expérience à l’époque mais c’est la vie.” (10) Une sombre histoire de production sonna le glas d’une expérience passionnante. Tout de simplicité, de légèreté et de swing, Westwood Walk offre l’exemple même de l’expansion que Gerry entendait donner à la musique de son quartette. Remarquable pièce prise sur un tempo très lent, A Ballad. n’est pas tant un épigone du Moondreams arrangé par Gil Evans pour Miles qu’une relecture du “son Thornhill” au travers de l’optique du Mulligan des années 50. Un retour qui met en évidence dans l’usage qui y est fait de l’instrumentation, l’influence qu’Ellington - ici celui de la “période impressionniste” - exerça sur Gerry.
Est-ce en janvier ou en juin 1953 que Lee Konitz, en congé de l’orchestre Kenton, vint au Haig’s ? Personne n’a réussi à fixer une date de façon indiscutable encore que la fin du mois de janvier semble très vraisemblable. Une formation dirigée par Mulligan ne saurait fonctionner en autarcie. En conséquence, comment quelqu’un comme Konitz que Gerry avait côtoyé chez Thornhill et imposé dans le Nonet de Miles n’aurait-il pas été accueilli à bras ouverts ? Sur la scène du Haig’s et en studio où furent gravés trois titres dont Almost Being in Love qui illustre de façon exemplaire les opportunités offertes par la musique “ouverte” de Mulligan. Les partenaires laissent les choses se dérouler naturellement sans que l’adjonction d’une voix supplémentaire n’entraîne la moindre solution de continuité non plus d’ailleurs qu’une sensation de pléthore. Konitz signe un très beau chorus et s’allie à Gerry pour exécuter un contre-chant parfaitement en situation destiné à Chet. Les habitudes du quartette sont respectées. Avec Sextet les choses changent quelque peu car ce morceau trahit une certaine préméditation sur le plan de la combinaison des timbres : une opportunité nouvelle offerte par la réunion de trois instruments mélodiques. Pour autant l’interprétation ne perd rien de sa spontanéité. Une sorte de mini-miracle que Gerry renouvellera en compagnie de son sextette. Pour l’heure il doit dissoudre son quartette au milieu de l’année car il vient d’être convié à séjourner six mois à la Sheriff’s Honor Farm pour détention de stupéfiants.
Si l’entente musicale entre Mulligan et Chet relevait de l’incroyable, les choses en allaient tout autrement sur le plan humain. Les deux hommes n’avaient rien, mais alors rien, en commun. Aux dires de Chico Hamilton, ils en étaient même arrivés à jouer en se tournant plus ou moins le dos. Lorsque Gerry eut purgé sa peine, Chet, devenu une vedette à part entière avec son propre quartette, n’avait guère envie de revenir en arrière. Il demanda une augmentation substantielle qui, bien entendu, lui fut refusée. Trop c’est trop. Adieu la Californie, Gerry rejoint New York.
Dans un article de Down Beat daté du 25 février 1953, Stan Getz avait exprimé sa vive admiration pour la formation de Mulligan et se déclarait prêt à la rejoindre en compagnie de son nouveau partenaire Bob Brookmeyer. Un joueur de trombone à pistons dont le discours s’exprimait au travers de longues phrases sinueuses, solidement appuyées sur les temps selon la tradition de son Kansas City natal. Tous deux étaient d’ailleurs venu faire le bœuf au Haig’s. Poliment mais fermement, Gerry avait décliné une proposition… qu’il allait réaliser à sa façon un peu plus tard avec Zoot Sims plutôt que Getz, ce qui évitera des problèmes d’ego.
Durant la semaine de Noël 1953, Mulligan se présenta à la tête d’un nouveau quartette, son interlocuteur n’étant autre que Bob Brookmeyer que Gerry connaissait en fait depuis l’époque où Brook, tout jeune tromboniste, était venu se joindre au sextette de Kai Winding en tournée à K.C. Pour Gerry l’idéal aurait été évidemment de réunir autour de lui Chet et Bobby mais il ne fallait pas rêver. C’est donc en la seule compagnie de Brookmeyer que Mulligan débarqua à Paris au mois de juin 1954, répondant à l’invitation de Charles Delaunay lui demandant de participer au 3ème Salon du Jazz. En compagnie, entre autres, de Thelonious Monk. La presque totalité des cinq concerts donnés par le quartette fut enregistrée. Interprété au cours de leur seconde prestation, Five Brothers montre à quel niveau d’une complicité jouant autant sur l’intelligence que sur la sensibilité étaient arrivés Mulligan et Brookmeyer. En sus ils partageaient un solide sens de l’humour qui se manifeste pendant la coda. L’alliage baryton/trombone à pistons générait une sonorité mate et veloutée faisant merveille sur les pièces comme Moonlight in Vermont qui met en lumière l’irréprochable jeu de basse de Red Mitchell et la souplesse de l’accompagnement fourni par Frank Isola aux balais.
Qu’est-ce qui poussa Mulligan à vouloir ressusciter son quartette avec trompettiste ? Mystère. Au Festival de Newport, il apparaît en compagnie de Tony Fruscella – une fugitive mais alléchante collaboration dont on aurait aimé profiter – et, le 12 novembre à Stockton, avec Jon Eardley. Un très bon instrumentiste s’exprimant dans un style classique/moderne qui éprouve encore quelque difficulté à chausser les mocassins de Chet d’où un malaise perceptible au cours de Piano Blues. Se qualifiant lui-même de “the most courageous pianist”, Gerry s’était pour l’occasion assis devant le clavier, jouant dans un style déhanché, hybride, dont l’énergie n’était sans évoquer celle d’un tapeur de piano de “honky tonk” qui aurait entendu Monk. Un cocktail au demeurant fort sympathique.
Un mois plus tard, le même quartette dans lequel John Eardley a définitivement trouvé ses marques, se produit au Hoover High School Auditorium de San Diego. Au début de la seconde partie, Larry Bunker s’installe à la place de Chico Hamilton et entrent alors sur scène, Bob Brookmeyer et Zoot Sims venus en droite ligne du Haig’s où ils se produisaient. Exposé par Zoot accompagné des autres souffleurs, I Know, Don’t Know How se termine en une collective totalement enthousiasmante ; sur Polka Dots and Moonbeams Gerry signe l’un de ses plus beaux solos où il utilise de subtiles paraphrases. L’accompagne au piano Brookmeyer qui avait commencé sa carrière sur cet instrument – il gravera en 1959 un album avec Bill Evans “The Ivory Hunters”. Il demeure au clavier pendant The Red Door un des rares thèmes composés par Zoot Sims, baptisé en l’honneur d’un studio new yorkais antédiluvien, le Don Jose’s. “Nous interprétons The Red Door comme un duel pour ténor et baryton” prévenait Mulligan. On ne saurait mieux dire. Leur première escarmouche sur So What durait 2’44, The Red Door atteint 7’12 pour la plus grande joie du public. A la suite de ce concert, Gerry décide de dissoudre son quartette et de se retirer à New York pour composer. Ce qu’il avait pressenti lorsque Getz et Brook étaient venus se joindre à son quartette se trouvait confirmé. Pas de doute, le sextette avec quatre souffleurs, une basse et une batterie était bien l’extension logique qui permettrait à sa musique de s’épanouir sans contraintes. A la fin de l’été 55, il bat le rappel. Jon Eardley, Bob Brookmeyer, Zoot Sims, Peck Morrisson et Dave Bailey répondent présent. Le “Gerry Mulligan Sextet” est né. Une formation qui ne ressemble à aucune autre et qui, peut-être, fut celle qui apporta à son inventeur le plus de satisfaction. Celle aussi qui toucha au plus près à son idéal d’écrivain. “Mon approche a toujours tendu vers la simplification plutôt que vers la complication (…) J’ai utilisé mes dons d’arrangeur non pas pour écrire des orchestrations mais pour concevoir des arrangements spontanés et des choses non écrites à partir desquelles nous travaillions. Le principal était de pouvoir changer l’arrangement au gré de notre fantaisie.”(11)
Ce n’est pas par goût de la provocation qu’au Basin Street de New York, Gerry Mulligan présenta Night at the Turntable comme “un ancien morceau écrit pour le quartette que j’ai développé pour un grand orchestre. Ce qu’est le sextette.” Une déclaration qui peut prêter à sourire si l’on pense “grand orchestre” selon les concepts de Don Redman et Fletcher Henderson, à savoir l’écriture par sections mais qui prend tout son sens si l’on se réfère à Duke Ellington et à Gil Evans qui, d’ailleurs, écrira pour le sextette une adaptation de La plus que lente de Debussy. Harry Carney salué au travers de In a Sentimental Mood que Mulligan enchaîne au Moon Mist interprété par Brookmeyer dans l’Ellington Medley ; Demanton tiré par Jon Eadley de Sweet Georgia Brown, The lady is a Tramp, Everything Happens to Me dans lequel le piano de Brook accompagne les confidences de Gerry… en aucun cas le sextette ne fut une formation transitoire servant de brouillon à la grande aventure du Concert Jazz Band. Il en fut la bande-annonce.
Alain Tercinet
© FRÉMEAUX & ASSOCIÉS - GROUPE FRÉMEAUX COLOMBINI SAS 2007
(1) How High the Moon fut gravé le 27 mai 1946. Gerry n’avait pas perdu de temps puisqu’Ornithology enregistré à Hollywood le 28 mars 1946, avait été mis sur le marché par le label Dial au début du mois d’avril. En décembre 1947 Shorty Rogers fera jouer par la section de saxes un extrait du solo de Bird sur Dark Shadows au cours de I’ve Got News for You enregistré sous la houlette de Woody Herman.
(2) Leonard Feather “Gerry Mulligan Then and Now” Down Beat , 26 mai 1960.
(3) Patricia Willard “Mulligan Full Steam Ahead” Down Beat, 24 octobre 1974.
(4) Joe Goldberg “Jazz Masters of the 50’s” Mc Millan, NYC, 1965.
(5) Jack Chambers “Milestones I – The Music and Times of Miles Davis to 1960” University of Toronto Press, 1983.
(6) Comme (2).
(7) Comme (2).
(8) Bob Rusch “Gerry Mulligan Interview”, Cadence vol. 3 n°4/5, octobre 1977.
(9) Livret “The Original Gerry Mulligan Quartet with Chet Baker” coffret Mosaic.
(10) Notes de pochette du LP “Gerry Mulligan Tentette” Capitol Jazz 5C052.80 801.
(11) Gene Lees “Gerry Mulligan : A Writer’s Credo” Down Beat, 17 janvier 1963.
English Notes
Who would have thought that the song How High The Moon, which went unnoticed in ‘Two For The Show’ was to become a prized jazz number? The signees, Nancy Hamilton and Morgan Lewis, never believed so and neither did Benny Goodman, the first to record it on 7 February 1940, the day before the show’s première on Broadway. By 1946, How High The Moon was no longer a novelty. Almost everyone, including King Cole, Django Reinhardt, Art Tatum, Teddy Wilson and Dave Brubeck had come out with a version and Ella Fitzgerald was soon to present her own rendition. Gerry Mulligan had started the previous year, using a rather traditional score, provided by Elliott Lawrence. That given to Gene Krupa was less conventional and his interpretation enabled soloists – Charlie Kennedy, Dick Taylor, Red Rodney and Charlie Ventura – to express themselves. As much as Mulligan loved bop, he had not turned his back on his experience from the Swing Era, and as he admitted to Leonard Feather, his writing was well-influenced by Gil Evans, Ben Homer, George Williams, Bobby Sherwood, Ralph Burns and Neal Hefti.
Between The Devil And The Deep Blue Sea and Elevation written for Elliott Lawrence in 1945/47 (again played in 1949 when Mulligan had joined the band) reflect progress without being iconoclastic, and despite all modifications Harold Arlen’s song still brought people to the dance floor.
In December 1947 in Hollywood’s Palladium Ballroom, Elliott Lawrence presented Elevation as Mulligan’s original composition. In 1955 Lawrence came out with an album featuring Mulligan’s compositions written for him.
Mulligan joined Gene Krupa’s orchestra for a year with the promise to be among the instrumentalists, but as this understanding wasn’t entirely respected, he left. However, while in the band, he became acquainted with Gil Evans during the rehearsal of Claude Thornhill’s orchestra, which intrigued him. Following his return journey to Philadelphia, Evans wrote to him, informing him that so much was happening in New York. Gerry took heed and left for the Big Apple where Gil persuaded Thornhill to hire him as arranger and possible instrumentalist. For a while Gerry performed in a sax section along with Lee Konitz and Danny Polo. Gil Evans lived in a basement apartment in 55nd Street where a number of young musicians stopped by, including Miles Davis. Times were tough and they discussed post-bop. George Russell recalls how himself, Gil Evans, Johnny Carisi, John Lewis and Mulligan concocted an arrangement for Buddy Johnson and they all signed the score to impress the band leader who bought their work!
Gil Evans was working on a project of transposing ‘his Thornhill’ to a medium-sized band surrounding a soloist – an idea which inspired Mulligan. Although Charlie Parker was hesitant and wriggled out, Miles was interested, highly esteeming Gil and the Thornhill orchestra. A nonet thus resulted including a trumpet, trombone, horn, tuba, alto and baritone saxes, piano, bass and drums, and the group sought after rare sounds with the instrumental association.
From 30 August to 4 September then from 13 to 18 September 1948 the Miles Davis Band was billed at the Royal Roost with “arrangements by Gerry Mulligan, Gil Evans and John Lewis”. This new-fangled formula hardly attracted the crowds. Miles had signed a contract with Pete Rugulo allowing Capitol to record the band. The Nonet was short-lived, playing for over a year with various members.
Named after Miles’ nickname for Gerry, Jeru includes one of the finest baritone interventions, the instrument using a fluid form of language, which was then rare. Cut at a later date, Rocker is one of Mulligan’s few truly bebop tunes. Miles appreciated Gerry’s sojourn with his band, as did Mulligan himself.
In April 1949 Bop City billed the ‘Kai Winding Sextet’, heralding the post-bop sounds. Mulligan signed some arrangements and although they were less adventurous than those written for the Miles Davis Nonet, they boasted efficient interactivity between Kai Winding’s trombone, Brew Moore’s tenor and his own, sometimes topped up with Jerry Lloyd’s trumpet. Their version of Wallington’s Godchild was more fluid compared to that played by the Nonet and although Igloo is pure bop, Brew Moore and Mulligan’s chorus borrow little from Minton’s vocabulary.
Chubby Jackson, who was Woody Herman’s bassist in the celebrated First Herd, appeared in March 1949 heading a big bop band, resulting in the recording of four titles. The following year he again called for the members of the first band to record for the Prestige label in New York’s Cinemart studios. The somewhat incongruous crowd included a majority of artists, such as Zoot Sims, J.J. Johnson and Mulligan, who participated in Tin Pan Alley jam sessions. This was Gerry Mulligan’s first opportunity to record with his friend Zoot Sims. Excepting Charlie Kennedy’s intervention on the alto, the couple shared So What alias Apple Core whereas Gerry alone took the lion’s share of I May Be Wrong, a 1929 Broadway number.
1950 was an unproductive year for Mulligan, which did nothing to calm his irascible nature. Indeed, he no longer wanted to be shadowed by an employer. Encouraged by his partner of the moment, Gail Madden, he founded a ‘rehearsal’ group in order to hear his music as he envisaged it. In August 1951, Gerry finally found himself heading his own set-up in a recording studio – a nonet with Gail Madden on the maracas. Eight titles were cut with Mulligan’s Too being the most unexpected, covering an entire 10 inch LP and featuring a fine dialogue with the extraordinary saxist Allen Eager.
Disappointed in New York, Gerry, accompanied by Gail Madden, hitched across the US, ending up in California after stopping off in Albuquerque. His partner knew Stan Kenton and tried to persuade him to hire Gerry as arranger. Initially hesitant, Kenton finally agreed. But their individual styles differed as we find in Young Blood, signed by Mulligan and which Kenton recorded at a later date, without its creator and doubling the tempo. Nevertheless Young Blood stands out as one of the Kenton band’s master-pieces of the period.
Only in spring 1952 did things liven up for Mulligan. He was asked to cover the Monday nights in Haig’s, a small club on Wilshire Boulevard, Los Angeles, taking other available artists. Among his collaborators were Jimmy Rowles, Ernie Royal, Red Mitchell and a new trumpeter, Chesney H. Baker. Gerry was truly impressed by Chet’s intuitive playing and their musical relationship flourished in a quartet comprising a trumpet, baritone sax, bass and drums. According to Mulligan this ‘pianoless’ concept stemmed from Gail Madden but as he also stated, ‘eliminating the piano means that I’ve always worked closer with the bass than most players’. Without recording, however, his efforts only heightened his local repute. Drummer Roy Harte owned Los Angeles’ Drum City and advanced the sum of two hundred and fifty dollars plus an establishment. Pacific Jazz was born.
The debut session was held in the home of the sound engineer, Phil Turesky, and gave birth to Bernie’s Tune and Lullaby of the Leaves which were both a huge success. Gerry wrote neither tune, though many believe he signed Bernie’s Tune. The quartet gave an impressionistic rendition of the 1932 song, Lullaby of the Leaves.
The quartet was billed in San Francisco’s Blackhawk resulting in an enthusiastic write-up in Down Beat by Ralph J. Gleason. The following year, Gleason again stood up for the quartet further to an attack made by ‘The Boston Strongboy’ Nat Hentoff who had written, ‘Mulligan, I think, will not last as long as Muggsy Spanier’. When they first went to San Francisco, Chet and Mulligan cut a few pieces for Fantasy. Two were to strike lucky: Line for Lyons, a tune which always featured in Mulligan’s repertory and My Funny Valentine with its sweet and sour tune, signed by Rodgers and Hart. Bark for Barksdale was less successful but boasts a fine melodic chorus by Chico Hamilton. For the same label, but this time in Hollywood, the quartet cut The Lady is a Tramp, another song by Lorenz and Hart and which suited the group perfectly.
Despite the quartet’s success, Gerry wanted to expand and consequently created a tentet. Westwood Walk is an example of this extended musical sound and A Ballad is a remarkable tune on a very slow tempo.
In January or June 1953, Lee Konitz, on leave from the Kenton orchestra, came to Haig’s. Mulligan welcomed him with open arms, and Lee joined them on stage and in the studios where three titles were recorded including Almost Being in Love and Sextet. A wonderful experience for all before Gerry was jailed in Sheriff’s Honor Farm for six months for a narcotics charge.
Mulligan and Chet may have understood each other musically, albeit surprisingly, but otherwise the two men had nothing in common. When Gerry was released, Chet had become a star in his own rights, having founded his quartet and had no intention of stepping back. Consequently Gerry left California and returned to New York.
In a February 1953 issue of Down Beat, Stan Getz expressed his admiration for Mulligan’s band adding he would be ready to join it with his new partner, trombonist Bob Brookmeyer. They did actually jam at Haig’s and Gerry politely turned down an offer – one he was to take up personally a while later with Zoot Sims rather than with Getz. At the end of the year, around Christmas, Mulligan appeared leading a new quartet featuring trombonist Bob Brookmeyer. Gerry knew Brook when the latter was on tour with Kai Winding’s sextet. And with Brookmeyer alone Mulligan set off for Paris in June 1954, answering Charles Delaunay’s invitation to participate in the 3rd Salon de Jazz, to appear with Thelonious Monk, among others. The totality of the quartet’s five concerts, or almost, was recorded. From the second show, Five Brothers demonstrates the complicity between Mulligan and Brookmeyer as well as their sense of humour in the coda. Pieces such as Moonlight in Vermont can be noted for the velvety sound and the latter title throws light on Red Mitchell’s irreproachable bass and Frank Isola’s supple use of the brushes.
Mulligan decided to adjust his quartet formula, adding a trumpet with Tony Fruscella in the Newport Festival and, on 12 November, brought Jon Eardley to Stockton who we can hear in Piano Blues in which Gerry, tagging himself as ‘the most courageous pianist’, took over the keyboard.
A month later the same quartet, still with Jon Eardley, was billed in San Diego’s Hoover High School Auditorium. At the beginning of the second part, Larry Bunker took Chico Hamilton’s place and Bob Brookmeyer and Zoot Sims stepped on stage, coming straight from Haig’s, where they had been playing. I Know, Don’t Know How ends with joint fervour among all members and in Polka Dots and Moonbeams Gerry signs one of his finest solos with use of subtle paraphrasing. Brookmeyer was on the piano and remained on the stool for The Red Door, one of the rare tunes composed by Zoot Sims.
Following this concert, Gerry decided to disband and settled in New York to compose. As he had foreseen when Getz and Brook joined the quartet, he believed a sextet with four blowers, a bass and drums was a logical progression to aim for and which would offer his music freer expression. Indeed, he had ‘always been attracted to the jazz band in an orchestral way, rather than a band way’.
In late summer 1955 he called for Jon Eardley, Bob Brookmeyer, Zoot Sims, Peck Morrisson and Dave Bailey, thus forming the ‘Gerry Mulligan Sextet’. A band like no other and which perhaps gave its creator the most satisfaction and fulfilled his dreams as a writer.
In autumn of the same year the sextet with its extended sonority came out with Duke Ellington Medley, Demanton, The Lady is a Tramp and Everything Happens to Me. This was a mere transition, a preview before the great adventure of the Concert Jazz Band.
English adaptation by Laure WRIGHT
from the French text of Alain Tercinet
© 2007 FRÉMEAUX & ASSOCIÉS - GROUPE FRÉMEAUX COLOMBINI SAS
CD GERRY MULLIGAN - QUINTESSENCE. NEW YORK LOS ANGELES PARIS 1946-1955 © Frémeaux & Associés