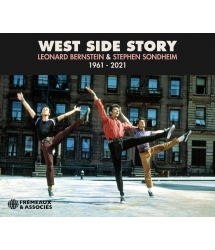- Notre Catalogue
- Philosophie
- Philosophes du XXème siècle et d'aujourd'hui
- Histoire de la philosophie (PUF)
- Contre-Histoire et Brève encyclopédie par Michel Onfray
- L'œuvre philosophique expliquée par Luc Ferry
- La pensée antique
- Les penseurs d'hier vus par les philosophes d'aujourd'hui
- Textes philosophiques historiques interprétés par de grands comédiens
- Histoire
- Livres
- Sciences Humaines
- Paroles historiques
- Livres audio & Littérature
- Notre Catalogue
- Jazz
- Blues - R'n'B - Soul - Gospel
- Rock - Country - Cajun
- Chanson française
- Musiques du monde
- Afrique
- France
- Québec / Canada
- Hawaï
- Antilles
- Caraïbes
- Cuba & Afro-cubain
- Mexique
- Amérique du Sud
- Tango
- Brésil
- Tzigane / Gypsy
- Fado / Portugal
- Flamenco / Espagne
- Yiddish / Israël
- Chine
- Tibet / Népal
- Asie
- Océan indien / Madagascar
- Japon
- Indonésie
- Océanie
- Inde
- Bangladesh
- URSS / Chants communistes
- Musiques du monde / Divers
- Musique classique
- Compositeurs - Musiques de film - B.O.
- Sons de la nature
- Notre Catalogue
- Jeunesse
- Philosophie
- Nouveautés
- Comment commander ?
- Recevoir le catalogue
- Manifeste
- Dictionnaire











- Notre Catalogue
- Philosophie
- Philosophes du XXème siècle et d'aujourd'hui
- Histoire de la philosophie (PUF)
- Contre-Histoire et Brève encyclopédie par Michel Onfray
- L'œuvre philosophique expliquée par Luc Ferry
- La pensée antique
- Les penseurs d'hier vus par les philosophes d'aujourd'hui
- Textes philosophiques historiques interprétés par de grands comédiens
- Histoire
- Livres
- Sciences Humaines
- Paroles historiques
- Livres audio & Littérature
- Notre Catalogue
- Jazz
- Blues - R'n'B - Soul - Gospel
- Rock - Country - Cajun
- Chanson française
- Musiques du monde
- Afrique
- France
- Québec / Canada
- Hawaï
- Antilles
- Caraïbes
- Cuba & Afro-cubain
- Mexique
- Amérique du Sud
- Tango
- Brésil
- Tzigane / Gypsy
- Fado / Portugal
- Flamenco / Espagne
- Yiddish / Israël
- Chine
- Tibet / Népal
- Asie
- Océan indien / Madagascar
- Japon
- Indonésie
- Océanie
- Inde
- Bangladesh
- URSS / Chants communistes
- Musiques du monde / Divers
- Musique classique
- Compositeurs - Musiques de film - B.O.
- Sons de la nature
- Notre Catalogue
- Jeunesse
- Philosophie
- Nouveautés
- Comment commander ?
- Recevoir le catalogue
- Manifeste
- Dictionnaire
LA QUINTESSENCE DU JAZZ
Ref.: FA059
Direction Artistique : ALAIN GERBER
Label : Frémeaux & Associés
Durée totale de l'œuvre : 1 heures 57 minutes
Nbre. CD : 2

LA QUINTESSENCE DU JAZZ
- - DIAPASON HISTORIQUE
- - CHOC JAZZMAN
- - SUGGÉRÉ PAR “COMPRENDRE LE JAZZ” CHEZ LAROUSSE
La quintessence du jazz distillée en 36 chefs-d'œuvre par Alain Gerber s'expliquant dans un livret de 40 pages. La uite du premier coffret devenu l'anthologie de Jazz de référence.
Patrick Frémeaux
"36 chefs-d'œuvre (en deux CD) sélectionnés par une équipe de choc : Alain Gerber (direction artistique, textes), Daniel Nevers (producteur délégué), Don Waterhouse (adaptation anglaise), Patrick Frémeaux (éditorialisaton) et Noël Hervé (production artistique). Si tous les professeurs de musique, dans les lycées et collèges de France et de Navarre, pouvaient faire écouter au moins une fois ces trésors à leurs élèves..."
Jazz Magazine
Droits éditorialisation : Frémeaux & Associés Jazz - L'histoire sonore de notre mémoire collective à écouter - Collection The Quintessence hors série.
ALBERT 'BUDD' JOHNSON/EARL HINES : FATHER STEPS IN • CHU BERRY : BLOWING UP A BREEZE • HOWARD MCGHEE/ANDY KIRK : MCGHEE SPECIAL • JACK TEAGARDEN/THE CAPITOL JAZZMEN : CASANOVA'S LAMENT • ROY ELDRIDGE : THE GASSER • STAN KENTON : ARTISTRY IN RHYTHM • COUNT BASIE : BASIE STRIDES AGAIN (ALONG AVENUE C) • ORAN 'HOT LIPS' PAGE : UNCLE SAM BLUES • BILLY ECKSTINE : BLOWING THE BLUES AWAY • JOHNNY HODGES/DUKE ELLINGTON : THE MOOD TO BE WOOED • DIZZY GILLESPIE SEXTET : I CAN'T GET STARTED (WITH YOU) • ARTIE SHAW : THE GRABTOWN GRAPPLE • COLEMAN/HAWKINS : STUFFY • AL HAIG/DIZZY GILLESPIE : SALT PEANUTS • SARAH VAUGHAN : MEAN TO ME • RED NORVO : CONGO BLUES • DON BYAS : I GOT RHYTHM • WOODY HERMAN : THE GOOD EARTH • ERROLL GARNER : SWEET GEORGIA BROWN • ELLA FITZGERALD : FLYING HOME • MILES DAVIS/CHARLIE PARKER : BILLIE'S BOUNCE • LESTER YOUNG : THESE FOOLISH THINGS • SLIM GAILLARD : SLIM'S JAM • JAZZ AT THE PHILHARMONIC : I CAN'T GET STARTED (WITH YOU) • DEXTER GORDON : LONG TALL DEXTER • DJANGO REINHARDT/STEPHANE GRAPPELLY : ECHOES OF FRANCE (VARIATIONS SUR 'LA MARSEILLAISE') • NAT 'KING' COLE : ROUTE 66 (GET YOUR KICKS ON) • CHARLIE PARKER : NIGHT IN TUNISIA • LOUIS ARMSTRONG : BACK O'TOWN BLUES • BILLIE HOLIDAY/JAZZ AT THE PHILHARMONIC : THE MAN I LOVE • JAY JAY JOHNSON : MAD BE BOP • DIZZY GILLESPIE ORCHESTRA : THINGS TO COME • BUD POWELL /SONNY STITT : FOOL'S FANCY • FATS NAVARRO/THE BE-BOP BOYS : FAT BOY • SIDNEY BECHET : CHINA BOY • DUKE ELLINGTON : HAPPY-GO-LUCKY LOCAL, PARTS I & II.
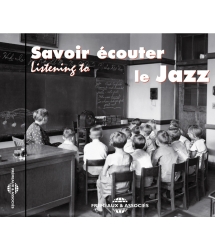
LISTENING TO JAZZ

ANTHOLOGIE 1927-1942

LADY AND PRES 1937-1941
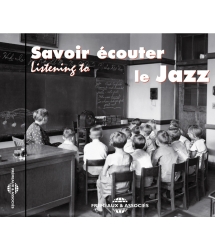



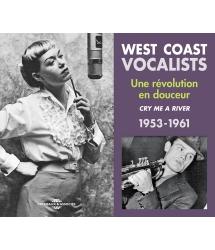
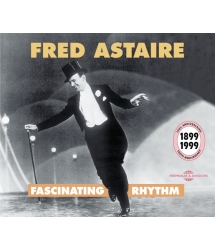
-
PisteTitreArtiste principalAuteurDuréeEnregistré en
-
1FATHER STEPS INALBERT BUDD JOHNSONDIXON00:03:031939
-
2BLOWING UP A BREEZECHU BERRYL BERRY00:02:421941
-
3MCGHEE SPECIALHOWARD MC GHEEHOWARD MC GHEE00:02:501942
-
4CASANOVA S LAMENTJACK TEAGARDENP BAXTER00:02:581943
-
5THE GASSERROY ELRIDGEROY ELRIDGE00:02:511943
-
6ARTISTRY IN RHYTHMSTANKENTON00:03:171943
-
7BASIE STRIDES AGAINCOUNT BASIEB CLAYTON00:02:581944
-
8UNCLE SAM BLUESORAN HOT LIPS PAGEPAGE00:03:161944
-
9BLOWING THE BLUES AWAYBILLY ECKSTINEBILLY ECKSTINE00:03:051944
-
10THE MOOD TO BE WOOEDJOHNNY HODGESJOHNNY HODGES00:02:571945
-
11I CAN T GET STARTEDDIZZY GILESPIEDUKE00:03:011945
-
12THE GRABTOWN GRAPPLEARTIE SHAWARTIE SHAW00:02:541945
-
13STUFFYCOLEMAN HAWKINSCOLEMAN HAWKINS00:02:591945
-
14SALT PEANUTSAL HAIGDIZZY GILLESPIE00:03:131945
-
15MEAN TO MESARAHR TURK00:02:391945
-
16CONGO BLUESRED NORVORED NORVO00:03:441945
-
17I GOT RHYTHMDON BYASGEORGE GERSHWIN00:05:021945
-
18THE GOOD EARTHWOODYNEAL HEFTI00:02:311945
-
PisteTitreArtiste principalAuteurDuréeEnregistré en
-
1SWEET GEORGIA BROWNERROLL GARNERB BERNIE00:02:201945
-
2BILLIE S BOUNCEMILES DAVISCHARLIE PARKER00:02:391945
-
3THESE FOOLISH THINGSLESTER YOUNGJ STRACHEY00:03:081945
-
4SLIM S JAMSLIM GAILLARDSLIM GAILLARD00:03:161945
-
5I CAN T GET STARTED (WITH YOU)JAZZ AT THE PHILHARMONICDUKE00:09:131946
-
6LONG TALL DEXTERDEXTERGORDON00:03:011946
-
7ECHOES OF FRANCE (VARIATIONS DE LA MARSEILLAISE)DJANGO REINHARDT00:02:431946
-
8(GET YOUR KICKS ON) ROUTE 66NAT KING COLEBOBBY TROUP00:03:001946
-
9NIGHT IN TUNISIACHARLIE PARKERDIZZY GILLEPSIE00:03:011946
-
10BACK O TOWN BLUESLOUIS ARMSTRONGLOUIS ARMSTRONG00:03:151946
-
11THE MAN I LOVEBILLIE HOLIDAYGEORGE GERSHWIN00:03:051946
-
12MAD BE BOPJAY JAY JOHNSONJAY JAY JOHNSON00:02:411946
-
13THINGS TO COMEDIZZY GILLEPSIEDIZZY GILLEPSIE00:02:441946
-
14FOLL S FANCYBUD POWELLBADEN POWELL00:02:341946
-
15FAT BOYFATS NAVARROFATS NAVARRO00:05:401946
-
16CHINA BOYSIDNEY BECHETBOUTELJE00:03:171946
-
17HAPPY GO LUCKY LOCAL PARTS I AND IIDUKE ELLINGTONMERCER ELLINGTON00:05:271946
JAZZ 36 CHEFS-D’ŒUVRE VOLUME 2
JAZZ 36 CHEFS-D’ŒUVRE - VOLUME 2
La quintessence du jazz distillée en 36 chefs-d’œuvre
The quintessence of jazz distilled into 36 masterpieces
CD I
01. Father Steps In EARL HINES AND HIS ORCHESTRA : Hines (p, lead), Milton Fletcher, Edward Simms, Walter Fuller (tp), George Dixon (tp, reeds), Edward Burke, John «Streamline» Ewing, Joe McLewis (tb), Omer Simeon, Leroy Harris, Albert “Budd” Johnson, Robert Crowder (reeds), Claude Roberts (g), Quinn Wilson (b), Alvin «Mouse» Burroughs (dm). Arrangement : Budd Johnson. New York City, 12 juillet 1939. BLUEBIRD BS-038259-1.
02 Blowing Up A Breeze CHU BERRY AND HIS JAZZ ENSEMBLE : Berry (ts), Oran “Hot Lips” Page (tp), Clyde Hart (p), Albert Casey (g), Al Morgan (b), Harry Jaeger (dm). New York City, 28 août 1941. COMMODORE R-4178-1.
03. McGhee Special ANDY KIRK AND HIS TWELVE CLOUDS OF JOY : Kirk (lead), Howard McGhee, Johnny Burris, Harry Lawson (tp), Ted Donnelly, Milton Robinson (tb), John Harrington, Ben Smith, Edward Inge, Al Sears (reeds), Kenny Kersey (p), Floyd Smith (g), Booker Collins (b), Ben Thigpen (dm). Arrangement : McGhee. New York City, 14 juillet 1942. DECCA 71053-A.
04. Casanova’s Lament THE CAPITOL INTERNATIONAL JAZZMEN : Billy May (tp), Jack Teagarden (tb, voc), Jimmie Noone (cl), Dave Matthews (ts), Joe Sullivan (p), Dave Barbour (g), Art Shapiro (b), Zutty Singleton (dm). Los Angeles, 16 novembre 1943. CAPITOL 105-A.
05. The Gasser ROY ELDRIDGE AND HIS ORCHESTRA :Roy Eldridge (tp), Joe Eldridge, Andrew Gardner (as), Ike Quebec, Tom Archia (ts), Rozelle Gayle (p), Ted Sturgis (b), Harold West (dm). Chicago, 16 novembre 1943. BRUNSWICK C-15095.
06. Artistry In Rhythm STAN KENTON AND HIS ORCHESTRA : Kenton (p, lead), Ray Borden, John Carroll, Buddy Childers, Karl George, Dick Morse (tp), Harry Forbes, George Faye, Bart Varsalona (tb), Eddie Meyers, Art Pepper, Red Dorris, Maury Beeson, Bob Gioga (reeds), Bob Ahern (g), Clyde Singleton (b), Joe Vernon (dm). Arrangement : Stan Kenton. Hollywood, 19 novembre 1943. CAPITOL 114.
07. Basie Strides Again (Along Avenue C) COUNT BASIE AND HIS ORCHESTRA : Basie (p, lead), Harry Edison, Al Killian, Ed Lewis, Joe Newman (tp), Ted Donnelly, Eli Robinson, Louis Taylor, Dicky Wells (tb), Elman «Rudy” Rutherford, Jimmy Powell, Earle Warren, Buddy Tate, Lester Young (reeds), Freddy Green (g), Rodney Richardson (b), Jo Jones (dm). Arrangement : Buck Clayton. New York City, 27 mai 1944.V-DISC J-509.
08. Uncle Sam Blues HOT LIPS PAGE’S SWING SEVEN : Page (tp, voc), George Johnson, Floyd “Horsecollar” Williams (as), Don Byas (ts), Clyde Hart (p), John Simmons (b), Sidney Catlett (dm). New York City, 14 juin 1944. SAVOY S-5463-3.
09. Blowing The Blues Away BILLY ECKSTINE AND HIS ORCHESTRA : Eckstine (voc, lead), Dizzy Gillespie, Shorty McConnell, Gail Brockman, Marion Hazel (tp), Jerry Valentine, Taswell Baird, Howard Baird, Howard Scott, Chips Outcalt (tb), John Jackson, Bill Frazier, Gene Ammons, Dexter Gordon, Leo Parker (reeds), John Malachi (p), Connie Wainwright (g), Tommy Potter (b), Art Blakey (dm). Arrangement : Jerry Valentine. New York City, 5 décembre 1944. DeLUXE 120-3.
10. The Mood To Be Wooed JOHNNY HODGES with DUKE ELLINGTON AND HIS ORCHESTRA : Hodges (as), Ellington (p, lead), Shelton Hemphill, Taft Jordan, Cat Anderson, Ray Nance (tp), Rex Stewart (ct), Joe “Tricky Sam” Nanton, Claude Jones, Lawrence Brown (tb), Johnny Hodges, Otto Hardwick, Al Sears, Jimmy Hamilton, Harry Carney (reeds), Fred Guy (g), Junior Raglin (b), Sonny Greer (dm). Arrangement : Duke Ellington. New York City, 4 janvier 1945. VICTOR D5-VB- 14-2.
11. I Can’t Get Started DIZZY GILLESPIE SEXTET : Gillespie (tp), Trummy Young (tb), Don Byas (ts), Clyde Hart (p), Oscar Pettiford (b), Shelly Manne ? (dm). New York City, 9 janvier 1945. MANOR W-1223.
12. The Grabtown Grapple ARTIE SHAW AND HIS GRAMERCY FIVE : Shaw (cl), Roy Eldridge (tp), Dodo “The Moose” Marmarosa (p), Barney Kessel (g), Morris Rayman (b), Lou Fromm (d). New York City, 9 janvier 1945. VICTOR D5-VB-0032-4.
13. Stuffy COLEMAN HAWKINS AND HIS ORCHESTRA : Hawkins (ts), Howard McGhee (tp), Sir Charles Thompson (p), Allan Reuss (g), Oscar Pettiford (b), Denzil Best (dm). Los Angeles, 23 février 1945. CAPITOL 576.
14. Salt Peanuts AL HAIG with DIZZY GILLESPIE AND HIS ALL STARS : Haig (p), Gillespie (tp,voc), Charlie Parker (as), Curley Russell (b), Sidney Catlett (dm). New York City, 11 mai 1945. GUILD G565A-1.
15. Mean To Me SARAH VAUGHAN (voc) + Dizzy Gillespie (tp), Charlie Parker (ass), Flip Philips (ts), Tadd Dameron (p), Bill De Arango (g), Curley Russell (b), Max Roach (dm). New York City, 25 mai 1945. CONTINENTAL W3327.
16. Congo Blues RED NORVO AND HIS SELECTED SEXTET : Norvo (vib), Dizzy Gillespie (tp), Charlie Parker (as), Flip Philips (ts), Teddy Wilson (p), Slam Stewart (b), Specs Powell (dm). New York City, 6 juin 1945. COMET T11-5.
17. I Got Rhythm DON BYAS (ts), acc. by Slam Stewart (b). New York City, Town Hall, 9 juin 1945. Enregistrement de concert.
18. The Good Earth WOODY HERMAN AND HIS ORCHESTRA : Herman (cl, as, lead), Sonny Berman, Pete Candoli, Conte Candoli, Neal Hefti, Ray Linn (tp), Bill Harris, Ed Kiefer, Ralph Pfiffner (tb), Sam Marowitz, John La porta, Pete Mondello, Flip Philips, Skippy DeSair (reeds), Margie Hyams (vib), Tony Aless (p), Billy Bauer (g), Chubby Jackson (b), Dave Tough (dm). Arrangement : Hefti. New York City, 10 août 1945. COLUMBIA Co35104-1.
CD II
01. Sweet Georgia Brown ERROLL GARNER (p), acc. by Bill DeArango (g), John Levy (b). Transcription d’enregistrement destiné à la diffusion radiophonique. New York City, 7 septembre 1945. TRANSCR. ZZ 4835.
02. Flying Home ELLA FITZGERALD (voc) + Vic Shoen and His Orchestra : Charles Genduso, Ralph Mussilo, Louis Ruggiero (tp), William Pritchard (tb), Sid Cooper, Bernie Kaufman, Harry Feldman, Sid Rubin (reeds), Moe Wechsler (p), Hy White (g), Felix Giobbe (b), Irv Kluger (dm). New York City, 4 octobre 1945. DECCA 73066-A.
03. Billie’s Bounce MILES DAVIS with the CHARLIE PARKER’S REE-BOPPERS : Davis (tp), Parker (as), Dizzy Gillespie (p), Curley Russell (b), Max Roach (dm). New York City, 26 novembre 1945. SAVOY S5850-1.
04. These Foolish Things. LESTER YOUNG AND HIS BAND : Young (ts), Dodo Marmarosa (p), Red Callender (b), Henry Tucker Green (dm). Los Angeles, 20 décembre 1945. ALADDIN 124 A.
05. Slim’s Jam SLIM GAILLARD AND HIS ORCHESTRA : Gaillard (voc, g), Dizzy Gillespie (tp), Charlie Parker (as), Jack McVea (ts), Dodo Marmarosa (p), Bam Brown (b), Zutty Singleton (dm). Los Angeles, 29 décembre 1945. BELTONE BJT41.
06. I Can’t Get Started JAZZ AT THE PHILHARMONIC : Al Killian, Howard McGhee (tp), Charlie Parker, Willie Smith (as), Lester Young (ts), Arnold Ross (p), Billy Hadnott (b), Lee Young (dm). Los Angeles, Philharmonic Auditorium, 28 janvier 1946. DISC 243 et 244.
07. Long Tall Dexter DEXTER GORDON QUINTET : Gordon (ts), Leonard Hawkins
(tp), Bud Powell (p), Curley Russell (b), Max Roach (dm). New York City, 29 janvier 1946. SAVOY 5878.
08. Echoes Of France (Variations sur “La Marseillaise”) DJANGO REINHARDT ET LE QUINTETTE DU HOT CLUB DE FRANCE AVEC STEPHANE GRAPPELLY : Reinhardt (g), Grappelly (vln), Jack Llewelyn, Allan Hodgkiss (g), Coleridge Goode (g). Londres, 31 janvier 1946. SWING OEF 28-1.
09. (Get Your Kicks On) Route 66 THE NAT KING COLE TRIO : Cole (p, voc), Oscar Moore (g), Johnny Miller (b). Los Angeles, 15 mars 1946. CAPITOL 1029-1.
10. Night In Tunisia CHARLIE PARKER SEPTET : Parker (as), Miles Davis (tp), Lucky Thompson (ts), Dodo Marmarosa (p), Arvin Garrison (g), Vic McMillan (b), Roy Porter (dm). Hollywood, 28 mars 1946. DIAL 1013-5.
11. Back O’Town Blues LOUIS ARMSTRONG AND HIS ORCHESTRA : Armstrong (tp, voc, lead), Ed Mullins, Ludwig Jordan, Andrew “Fats” Ford, William “Chieftie” Scott (tp), “Big Chief” Russell Moore, Adam Martin, Norman Powe, Al Cobbs (tb), Don Hill, Amos Gordon, Joe Garland, John Sparrow, Ernest Thompson (reeds), Ed Swanston (p), Elmer Warner (g), Arvell Shaw (b), Butch Ballard (dm), Velma Middleton (voc). New York City, 27 avril 1946. VICTOR D6-VB-1740.
12. The Man I Love BILLIE HOLIDAY/JAZZ AT THE PHILHARMONIC : Holiday (voc), Joe Guy (tp), Georgie Auld (as), Illinois Jacquet, Lester Young (ts), Ken Kersey (p), Tiny Grimes ? (g), Al McKibbon (b), J.C. Heard (dm). New York City, Carnegie Hall, 3 juin 1946.
13. Mad Be Bop JAY JAY JOHNSON’S BE BOPPERS : Johnson (tb), Cecil Payne (as), Bud Powell (p), Leonard Gaskin (b), Max Roach (dm). New York City, 26 juin 1946. SAVOY S3312.
14. Things To Come DIZZY GILLESPIE ORCHESTRA : Gillespie (tp, lead), Dave Burns, Talib Daawud, Kenny Dorham, John Lynch, Elmon Wright (tp), Leon Comegys, Gordon Thomas, Alton “Slim” Moore (tb), Howard Johnson, Sonny Stitt, Ray Abrams or James Moody, Warren Luckey, Leo Parker (reeds), Milt Jackson (vib), John Lewis (p), Ray Brown (b), Kenny Clarke (dm). Arrangement : Gil Fuller. New York City, 9 juillet 1946. MUSICRAFT 5611.
15. Fool’s Fancy BUD POWELL with The SONNY STITT ALL STARS (BE-BOP BOYS) : Powell (p), Stitt (as), Dorham (tp), Hall (b), Wallace Bishop (dm). New York City, 23 août 1946. SAVOY ?.
16. Fat Boy THE BE-BOP BOYS : Kenny Dorham, Fats Navarro (tp), Sonny Stitt (as), Morris Lane (ts), Eddie DeVerteuil (bars), Bud Powell (p), Al Hall (b), Kenny Clarke (dm). New York City, 6 septembre 1946. SAVOY S3348/3349.
17. China Boy JAZZ AT TOWN HALL : Sidney Bechet (ss), James P. Johnson (p), George “Pops” Foster (b), Warren “Baby” Dodds (dm). New York City, 21 septembre 1946. Enregistrement de concert. Acétate.
18. Happy-Go-Lucky Local, Parts I & II DUKE ELLINGTON AND HIS FAMOUS ORCHESTRA : Ellington (p, lead), Harold Baker, Shelton Hemphill, Cat Anderson, Francis Williams, Taft Jordan, Ray Nance (tp), Claude Jones, Wilbur DeParis, Lawrence Brown (tb), Russell Procope, Johnny Hodges, Al Sears, Jimmy Hamilton, Harry Carney (reeds), Fred Guy (g), Oscar Pettiford (b), Sonny Greer (dm). Arrangement : Duke Ellington. New York City, 25 novembre 1946. MUSICRAFT 5816 et 5814.
Voix
Jack Teagarden ne fut pas seulement l’“inventeur” du trombone moderne et un improvisateur d’une stature considérable. Oran “Hot Lips” Page ne s’est pas contenté de marquer de son empreinte l’histoire de la trompette entre Armstrong et Roy Eldrige. Tous deux étaient en outre des maîtres du jazz singing. Chanteurs naturels, certes - c’est-à-dire sans expérience des techniques légitimes -, mais ni chanteurs du dimanche (certaines de leurs séances d’enregistrement ont produit autant de vocaux que de morceaux) et moins encore chanteurs de salle de bain. Le premier, sur ce chapitre, ne s’efface que devant Satchmo, dont il fut à plusieurs reprises le partenaire; le second, dans des faces comme celle que nous avons choisie, se révèle l’égal des plus grands blues shouters de son temps. Chez “Mr. T.”, Texan pure laine (comme d’ailleurs Page), une sorte de génie de la nonchalance est associé (lorsqu’il avait un coup dans l’aile, c’est-à-dire la plupart du temps) à un art de la titubation contrôlée, propice à des effets rythmiques - anticipations et retards combinés - dont le swing est le premier bénéficiaire. Casanova’s Lament (CD I, plage 4) a vu le jour pendant une séance particulièrement féconde, puisqu’elle a engendré d’autres interventions de grande qualité de la part du tromboniste-chanteur ainsi que le dernier grand chorus du clarinettiste Jimmy Noone (sur Clambake In B Flat). Nous sommes en présence d’une formation assez hétéroclite, rassemblée à l’initiative des studios de cinéma de Hollywood, aussitôt après la trop fameuse grève du disque décrétée par l’American Federation Of Musicians. Teagarden dut être satisfait de son travail sur ce morceau taillé à ses mesures par Dave Dexter, Jr. (collaborateur de Down Beat devenu l’un des responsables de Capitol) pour la circonstance, puisqu’il l’inscrivit à son répertoire et l’y maintint une vingtaine d’année, au milieu d’autres spécialités comme Stars Fell On Alabama, Beale Street Blues ou A Hundred Years From Today.
Uncle Sam Blues (CD 1, plage 8) évoque une période de l’histoire où le terrible tonton à gibus tendait le doigt vers les jeunes hommes des Etats-Unis, pour les attirer du côté des casernes, sinon des plages normandes. Privant les orchestres d’éléments parfois irremplaçables, la nécessité d’aller botter les fesses du Führer était la plaie d’un jazz alors en pleine mutation. Des hommes comme Jo Jones et Lester Young ne se sont jamais cachés d’avoir fait des pieds et des mains pour échapper à la mobilisation. Il faut dire que rares étaient alors les Noirs qui pouvaient considérer l’Amérique comme leur pays. L’Oncle Sam n’est pas une femme, dit à peu près le texte, mais il te prendra quand même ton homme. Tout est de premier ordre dans cette interprétation, souvent mentionnée par les encyclopédistes : la contribution de “Lèvres Chaudes”, bien sûr (à la fois effusif et plaintif dans son chorus de trompette, que conclut un ironique Bugle Call), mais aussi le soutien que lui apporte au piano le délicat Clyde Hart et même les quelques mesures d’alto, presque évanescentes dans le contexte.Pendant les années qui séparent ses retrouvailles (houleuses !) avec Béchet en mai 1940 (2:19 Blues, Perdido Street Blues, etc. 1) et Back O’Town Blues (CD II, plage 11), Louis Armstrong n’a pas fait beaucoup mieux que dans cette dernière pièce. Il s’agit là d’un des derniers enregistrements à la tête de son big band, qu’il dissoudra sans appel dans les premières semaines de l’été 1947, après une séance d’adieu pour RCA le 12 mars (I Wonder, I, Wonder, I Wonder, I Believe, etc.). Elmer Warner introduit le thème à la guitare électrique puis revient opérer la transition entre l’exposé à la trompette et le vocal. D’un équilibre exemplaire - maximum de sobriété, maximum d’expressivité -, celui-ci est discrètement ponctué par les relances de la chanteuse Velma Middleton, à laquelle le leader avait déjà fait appel en 1942 et qui appartiendra au All Stars de 1947 jusqu’à sa mort en 1961, au cours d’une tournée. Gravé l’année précédente en compagnie du grand orchestre (un peu mollasson, mais l’oeuvre n’en souffre guère) de Vic Schoen, Flying Home (CD I, plage 2) est précédé de plus de cinquante titres dans la discographie d’Ella Fitzgerald (2). Néanmoins, c’est peut-être le premier enregistrement de la “First Lady” du jazz et du swing dans lequel même un auditeur non averti reconnaît sans la moindre hésitation la chanteuse qui allait s’imposer dans les juke-boxes du monde entier, à partir de 1960, avec Mack The Knife, qu’accompagnait sur les 45 tours simples un trépidant How High The Moon (écho d’un de ses plus gros succès de l’année 47). C’est aussi le premier de ses disques où se manifeste avec une telle évidence cette maîtrise du scat qu’à part Sarah Vaughan dans ses très bons jours, aucune de ses rivales n’approchera. Jamais encore jusque là elle n’avait eu le culot de proposer une pièce où, d’un bout à l’autre, la voix fût traitée comme un instrument. La fréquentation, un peu plus tard, des boppers, et de Dizzy Gillespie en particulier, l’encouragera à persévérer, et même à prendre encore plus de risques (3).
Rien ne mène plus droit au coeur de l’univers de Billie Holiday que les enregistrements effectués au cours de ses premiers concerts avec le J.A.T.P., en 1945-1946, alors même que les effets de la toxicomanie commençaient à fissurer le fringant édifice construit dans les années 30 (4). L’imperfection de ces pièces - entre autres de The Man I Love (CD II, plage 12) - est ce qui les rend plus-que-parfaites, dans la mesure où l’impuissance qu’elle traduit les fait accéder à un niveau d’humanité qu’aucune prouesse technique ne permettra jamais d’atteindre. Une impuissance - il faut le souligner toujours - qui transcende prodigieusement les simples limitations instrumentales auxquelles l’immense majorité des autres vocalistes ne font que se heurter. Ceux-là ne font que révéler une incompétence qui leur est propre, quand Billie exprime l’éternelle et universelle passion de tout être conscient d’avoir été “jeté sur la terre”. The Man I Love n’inspire qu’un seul regret : que Lester Young, présent sur le plateau, n’ait pas été invité à prendre la parole.Née en 1924, Sarah Vaughan (la perle du chœur de la Mount Zion Baptist Church, dans sa ville natale de Newarck) n’avait pas vingt ans lorsque, ayant remporté à Harlem le fameux concours d’amateurs de l’Apollo, puis reçu en conséquence un billet de dix dollars et les encouragements d’Ella Fitzgerald, elle attira l’attention de Billy Eckstine. “Mr. B.” devait la recommander à Earl Hines, dans l’orchestre duquel elle est engagée en avril 1943. Comme chanteuse, mais aussi - ce n’est pas un mince titre de gloire - comme pianiste d’appoint. C’est là qu’elle fait la connaissance du turbulent tandem que forment Charlie Parker et Dizzy Gillespie. Avec eux et sous la direction du trompettiste, elle gravera le 11 mai 1945 un Lover Man resté dans toutes les mémoires, auquel nous avons préféré un Mean To Me (CD I, plage 15) de deux semaines plus tardif, un peu moins attendu mais qui ne le lui cède en rien. Au contraire, le Dingue et l’Oiseau (secondés par Flip Philips au saxophone ténor) s’y expriment plus généreusement. Cinq ans plus tard, Sassy reprendra ce même thème, en compagnie cette fois de Miles Davis et de Budd Johnson, et en tirera de nouveau des merveilles.
Route 66 (CD II, plage 9) fut au trio de Nat King Cole (5) ce que What’d I Say sera au “Genius” Ray Charles et Strangers In The Night à Frank Sinatra. Entendez qu’il est difficile d’évoquer le chanteur sans penser à la chanson. Il s’agit néanmoins, si l’on compare cette pièce à d’autres réalisations du groupe, d’une petite chose toute simple - détail qui, suppose Will Friedwald, a favorisé son impact sur le grand public. En aucun cas, cependant, nous n’avons affaire à de la musique complaisante. “Facile”, elle l’est sans aucun doute, mais au sens où elle témoigne d’une suprême aisance. Nat concevait la légèreté comme une sorte de politesse qu’il devait à ses auditeurs. Et c’est, paradoxalement, cette apparente désinvolture qui a empêché son art, pourtant si aérien, de se volatiliser dans l’air du temps.(Deux autres chanteurs, Billy Eckstine et Slim Gaillard figurent eux aussi au programme de ce florilège, mais dans la mesure où les plages qu’ils ont signées sont essentielles pour d’autres raisons que la part qu’ils y prennent, nous en avons traité plus loin.)
Pistons et coulisse
Roy Eldridge, on le sait, a préparé le terrain à Dizzy Gillespie, principalement avec ses faces Vocalion de janvier 1937 (Wabash Stomp, Florida Stomp et After You’ve Gone (6), entre autres). “Roy était mon idole”, déclarera sans ambages le maître bopper, longtemps après les faits. Et l’intéressé de se souvenir pour sa part : “(Au début des années 40), il me demandait comment je faisais certaines choses et je le lui disais.” Qui douterait d’ailleurs de la générosité de cet homme après avoir entendu son bouillonnant The Gasser (CD I, plage 5), variation sur les accords et la structure rythmique de Sweet Georgia Brown. Si, à la fin de sa carrière,”Little Jazz” devait recourir à la sourdine Harmon (sans le tube, comme Miles Davis une dizaine d’années plus tard) pour escamoter les dérapages auxquels l’entraînait un tempérament casse-cou auquel il ne renonça jamais, il en fait ici un usage magistral, avant de laisser la parole au ténor Ike Quebec dont c’était ce jour-là le baptême du feu dans un studio. Roy reparaît ensuite et, sans sourdine cette fois, se lance dans une aventure plus périlleuse encore. Ce n’est pas seulement Dizzy – a fait remarquer quelque part Dan Morgenstern – , c’est tout le bop qui va se nourrir d’improvisations comme celle-là. Eldrige, cependant, ne sera pas le seul à relier les Anciens aux Modernes. Charlie Shavers accomplira, plus modestement il est vrai, sa part de l’ouvrage. Howard McGhee (qui servira de modèle au jeune Fats Navarro, un temps son compagnon de pupitre chez Andy Kirk) fera le reste. Oeuvre de jeunesse (“Maggie” est né en 1918) inscrite par Alain Tercinet à l’affiche de Birth Of Be Bop (7), le McGhee Special (CD I, plage 3) qu’il composa, orchestra et illustra d’un solo étourdissant pendant son séjour au sein des “Douze Nuages de Joie” demeure l’une de ses œuvres les plus vibrantes et les plus accomplies. D’autant que la partition annonce elle-même les grands chambardements qui affecteront l’écriture du jazz orchestral à partir de 1944.L’extraordinaire étant chez Dizzy Gillespie, chose relativement quotidienne au milieu des années 40, on a scrupule à braquer le projecteur sur I Can’t Get Started (CD I, plage 11) plutôt que sur dix autres pièces de la même époque. Mais on éprouverait du remords à la laisser de côté. Henri Renaud a résumé le sentiment général en la présentant comme “un classique”. Le trompettiste, sans la moindre forfanterie, voyait dans la conclusion de son chorus l’un de ses principaux apports à l’évolution du langage dans lequel il avait choisi de s’exprimer (To Be, or not... to Bop, page 489 de l’édition originale). Par avance, André Hodeir lui avait donné raison en écrivant, dès 1953: “Le point culminant de cette improvisation est sans aucun doute la coda, phrase célèbre que Gillespie ‘replacera’ dans d’autres œuvres, notamment dans l’introduction de ‘Round About Midnight.”
D’évidence, Miles Davis, en 1945, n’était encore l’homme ni des sessions Capitol, ni du Man I love auquel Thelonious Monk ajouta plus qu’un soupçon d’énigme (8), ni du quintette avec John Coltrane ni, a fortiori, celui de Miles Ahead et de Kind Of Blue. Mais, à dix-neuf ans - et quoi qu’on en ait dit - il apparaissait déjà, au côté de Charlie Parker, comme un soliste habité et qui, de surcroît, ne ressemblait à aucun autre. Now’s The Time et Billie’s Bounce (CD II, plage 3) suffisent à en faire la preuve. Qu’il n’y serve pas de repoussoir de l’altiste, en dépit d’une expression encore mal assurée (voir ici l’exposé du thème), c’est déjà beaucoup. Mais ce n’est pas tout. Confronté à ce partenaire génial, au lieu de se borner à limiter la casse il ajoute à l’oeuvre commne une touche de poésie qui lui est propre. Pour son travail sur le second titre (la prise inaugurale, - il est important de le préciser), lui qui ne se pardonnait pas grand chose confessait volontiers une certaine tendresse. C’est qu’il était parvenu à reproduire la sonorité de Freddie Webster (9), jalousée par tous les trompettistes new-yorkais.“Oh, man, c’est comme ça que je veux jouer !” s’écria Fats Navarro la première fois qu’il entendit Gillespie. Pour y parvenir, il se mit à s’entraîner sans relâche. D’après Idrees Sulieman, lui-même trompettiste, Fats, à peine réveillé, s’asseyait dans son lit, adaptait une sourdine au pavillon de l’instrument et passait la journée entière à se perfectionner. Theodore Navarro était, dira Barry Ulanov, “un hippopotame d’homme”. Aussi le surnommait-on “Fat Girl” (Grosse Fille). Chez les jazzmen de l’époque, “Fat Girl” était aussi le nom de code de la cocaïne (l’héroïne, elle, avait été baptisée “Fat Boy”). Il y a là plus qu’une coïncidence : Fats mourra de ses excès le 6 juillet 1950, sans avoir pu fêter son vingt-septième anniversaire. Sa dépouille ne pesait plus que cinquante-cinq kilos. Le plus poignant hommage qu’on lui ait jamais rendu a été écrit par Charles Mingus, dans son livre Moins qu’un chien (10). Le dernier chapitre de l’ouvrage n’est pour l’essentiel qu’une longue conversation entre le contrebassiste et son ami vacillant au bord du gouffre : “Allons, prends bien soin de toi, Mingus. Je t’aime.- Je t’aime aussi, Fats. A plus tard.- Peut-être, peut-être. Mais je crois que c’est plutôt adieu.- C’est bien ce que j’ai voulu dire. A plus tard.- Je comprends. Quand penses-tu que viendra ton tour. Mingus?- Je ne sais pas. Pas avant que j’aie écrit tout ça, je crois. C’est l’ordre que j’ai reçu de l’Homme.- A plus tard, Mingus.- A plus tard, Girl...”
Le 6 septembre 1946, le trompettiste enregistra avec les Be-Bop Boys, une formation à géométrie variable dont Bud Powell était la cheville ouvrière, plusieurs titres, dont Fat Boy (CD II, plage 16) (trop long pour être édité sur une seule face de 78 tours, d’où la rupture audible au milieu du solo de piano). Dans cette plage, comme dans Boppin’ A Riff, que nous aurions pu sélectionner aussi bien, tout n’est pas d’un niveau exceptionnel, il s’en faut. Le baryton Eddie DeVerteuil, par exemple, frôle la catastrophe; Kenny Dorham a quelques progrès à faire (il les fera très vite) et Sonny Stitt lui-même manque encore d’envolée, surtout si on compare son solo à ceux de Bird à la même époque. Si ces morceaux sont passés à la postérité, précédés d’une rumeur flatteuse, c’est exclusivement en raison des magnifiques interventions de Fats et de Bud, incités à livrer le meilleur d’eux-mêmes par un Kenny Clarke d’une pertinence sans faille.Powell, du reste, fait merveille chaque fois qu’il est sur la sellette. Spécialement dans Fool’s Fancy, réalisé par un contingent des Be Bop Boys, mais aussi au côté de Dexter Gordon (Long Tall Dexter) et de Jay Jay Johnson en juin 1946. Cette dernière séance inaugure la carrière phonographique du tromboniste qui - tout en révérant de grands anciens tels que Teagarden, Dicky Wells, Trummy Young ou même Tommy Dorsey (lui-même s’était formé à l’école des big bands) - révolutionnait l’instrument, comme Parker révolutionnait le saxophone, Dizzy la trompette, Bud le piano, Clarke et Roach (ici présent) la batterie (11). Quatre pièces confiées à la cire : quatre précieuses vignettes, entre lesquelles le compilateur n’a que l’embarras du choix. On ne s’étonne plus que, cette année-là, J.J.J. eût été désigné comme le meilleur trombone de sa génération. On notera, avec Tercinet, que Mad Be Bop (CD II, plage 13), comme d’ailleurs les trois autres morceaux gravé par ses “Be Boppers”, illustre, en dépit d’une partie de piano sans concession, une conception du bop moins radicale que celle des Be Bop Boys dans Fat Boy (dont une dizaine de semaines seulement le séparent).
Les Anches
Comme son rival Benny Goodman, Arthur Arshawsky, dit Artie Shaw, aura été un excellent chef d’orchestre, mais aussi et surtout un clarinettiste hors pair, perfectionniste de surcroît. Comme celle de Goodman, sa réputation souffre d’un préjugé auprès de certains critiques et de beaucoup d’amateurs : parce qu’il est un technicien d’élite, on le soupçonne d’être incapable d’improviser avec audace et avec sensibilité. Après quoi, on le condamne pour froideur et inconsistance. Sans preuves. Ce qui du reste est plus prudent, car les preuves se révèlent quelquefois accablantes... pour l’accusation. A commencer par les disques qu’à deux reprises (1940 et 1945), il gravera pour RCA avec une unité restreinte : le “Gramercy Five”. Le deuxième de ces groupes de “jazz de chambre” comprenait entre autres Roy Eldridge (en très grande forme, même s’il eût sans doute préféré se produire à la tête de ses propres troupes), et deux musiciens “modernisants” (plus que modernistes) : Barney Kessel, l’un des principaux disciples du Charlie Christian dernière manière (12) et Dodo “The Moose” Marmarosa, authentique franc-tireur du clavier. Détail intéressant : Charlie Parker, à partir de l’année suivante, les conviera l’un et l’autre à ses enregistrements californiens (cf. par exemple Relaxin’ At Camarillo). The Grabtown Grapple (CD I, plage 12), à la composition duquel participa l’excellent arrangeur Buster Harding (13), est sans aucun doute l’une des pièces qui rendent le mieux justice à cette formation négligée par trop d’historiens. Le second Gramercy Five associait charme, chic et swing d’une manière qui - ce n’est pas un mince compliment - fait songer au sextette de John Kirby. Les quatre solistes, y compris le leader qui se présente en queue de peloton, s’expriment avec autant de grâce que d’intensité, remarquablement épaulés par la basse robuste de Morris Tayman et le jeu de balais dépouillé mais très dense de Lou Fromm, musicien fort apprécié de ses confrères (et des autres batteurs en particulier).Effervescence et jubilation ont rarement fait défaut à la musique de Sidney Béchet. Moins que jamais lors de ce concert au Town Hall de New York où, poussé dans ses retranchements par un Baby Dodds exubérant (et inspiré au point de varier ses effets d’une mesure à l’autre, exploitant pour cela, des toms aux rebords de caisse, tous les accessoires mis à sa disposition), il offrit au public le China Boy (CD II, plage 17) le plus torride de sa carrière (cf. surtout la dernière partie). Dans ces trois minutes de pure lévitation, le plus lumineux de la verve louisianaise se concentre en un faisceau aveuglant
Disciple, et même assesseur, de Béchet à ses débuts (14), Johnny Hodges a eu chez Ellington, en petite comme en grande formation, le chef-d’oeuvre facile. Pour ce qui est des années 1944 à 1955 (date de son retour dans un orchestre dont il s’était absenté depuis 1951), le chef-d’oeuvre de ces chefs-d’oeuvre semble bien être The Mood To Be Wooed (CD I, plage 10), mini-concerto destiné du reste à mettre en valeur ce lyrisme qui réussissait à se faire onctueux sans jamais paraître gominé. C’est tout un univers que l’altiste s’est construit puis aménagé peu à peu, en particulier depuis A Gypsy Without A Song et Finesse, respectivement de 1938 et 1939 (15) : il lui restera fidèle jusqu’à son dernier jour et l’on peut dire que, sur ce terrain précis, même Charlie Parker n’est pas arrivé à lui tenir la dragée haute. Grand admirateur du “Rabbit”, Coleman Hawkins connut après le coup de tonnerre (tonnerre ô combien suave) de Body And Soul, confié à la cire en octobre 1938 (16) plusieurs années d’état de grâce. Entendez : plus fructueuses encore, et beaucoup plus trépidantes, que celles qui allaient suivre et qui, pourtant, produiraient encore, jusqu’à la veille de sa mort, mainte pièce de collection. Les sessions organisées par Capitol entre février 1945 et juin 1947 sont, de ce point de vue, singulièrement révélatrices : les grandes réussites y abondent. La première par exemple a donné, outre Stuffy (CD I, plage 13) un opulent Stardust et un allègre Rifftide dont le thème avait été - comme celui de Stuffy - “emprunté” à Thelonious Monk par le saxophoniste. Hawkins poussera la plaisanterie jusqu’à déposer sous son propre nom le copyright de ce que leur véritable géniteur baptisera de son côté Hackensack et Stuffy Turkey. Dans Stuffy, outre un “Hawk” voluptueusement féroce, on peut apprécier une bonne contribution du pianiste Sir Charles Thompson et du guitariste Allan Reuss, tandis que Howard McGhee donne un coup de main dans les riffs et que “tourne” avec la précision d’un moteur de Rolls la rythmique formée par deux boppers à qui rien du classicisme n’était étranger : le contrebassiste Oscar Pettiford (qui s’était révélé dans le Duke Ellington Orchestra) et le batteur Denzil Best (qu’avait déjà employé Ben Webster).Ni Hawkins ni Lester Young, dans leur propos, n’ont témoigné d’une affection débordante à l’égard de Chu Berry. Est-ce la raison pour laquelle cet immense artiste (qui eut peut-être le tort - mais le panache - de se démarquer des deux maîtres du saxophone ténor) n’a pas toujours dans la littérature spécialisée la place qui lui revient ? Lucien Malson, son plus ardent défenseur, a salué le courage qu’il lui fallut pour “respecter Hawkins sans le révérer”.Et de préciser sa pensée en ces termes : “Il épure la sonorité hawkinsienne de son vibrato énorme, cherche moins à musarder en des méandres mélodiques qu’à emprunter les voies les plus courtes dans ses solos concis, assurés, remarquablement cohérents, qui se teintent d’un accent satirique...” Blowing Up A Breeze (CD I, plage 2) où Hot Lips Page et Clyde Hart ne s’en laissent pas conter non plus, où Al Casey (le guitariste du “Rhythm” de Fats Waller) tend avec discrétion sa carte de visite occupe, de l’avis commun, le dessus du panier qui renferme les oeuvres publiées sous son nom, au cours d’une trop brève carrière (“Chew” mourut à trente-et-un ans dans un accident de la route, le 30 octobre 1941, c’est-à-dire deux mois après cette séance Commodore).
Avec Hawkins, Budd Johnson et Don Byas se partagent l’honneur d’avoir, en dépit des criailleries qui s’élevaient de droite et de gauche, favorisé une transition harmonieuse du middle jazz au be bop. Le premier, qui avait été l’une des stars du grand orchestre d’Earl Hines de 1935 à 1942 et n’était pas resté insensible à l’influence de Lester Young, fut, lorsque les choses commencèrent à bouger vraiment, de tous les coups ou presque. Arrangeur plus que capable, il allait fournir des partitions à Coleman Hawkins pour ce que l’on s’accorde à considérer comme la première séance d’enregistrement typiquement bop (Bu-Dee-Daht, Woody’n You, etc. - 16). On le verra, cette même année 1944, dans la petite formation de Dizzy à l’Onyx Club. Boy Raeburn, Billy Eckstine et Woody Herman lui commanderont des arrangements et, le premier excepté, l’engageront comme soliste. Father Steps In (CD I, plage 1) présente le double avantage de faire apprécier son écriture et ses talents d’improvisateur – à l’alto, en l’occurence – dans l’une des plus mémorables interprétations gravées sous la direction de “Fatha Hines”. Les autres intervenants sont, dans l’ordre de leur entrée en scène, Edward Simms (tp), Robert Crowder (ts) et Walter Fuller (tp).Surnommé “Don Carlos”, Don Byas avait ceci d’un grand seigneur qu’il était très conscient de sa caste et fort chatouilleux sur les questions de préséance, lorsqu’il s’agissait de lui-même. Se rangeait-il sous le blason de Hawkins, ou sous celui de Lester ? C’était la question qu’il ne fallait pas lui poser : il défendait, rappelait-il aussitôt, les seules couleurs de la maison Byas, qui avait elle-même ses propres vassaux, et pas n’importe lesquels s’il vous plaît. Certes, né en 1912, professionnel deuis 1932, Don avait connu la monarchie hawkinsienne absolue, assisté avec intérêt à la sécession youngienne et à la jacquerie chuberrienne. Du Hawk lui plaisait surtout le timbre de voix, du Prez plutôt la pensée. Pourquoi ne pas marier celle-ci avec celui-là ?”C’est comme ça que j’ai commencé, confiera-t-il à Jean-Louis Ginibre en 1967. De plus, j’ai fait la connaissance d’Art Tatum et ça m’a donné d’autres idées. Et c’est ainsi que j’ai fondé la troisième école. Parmi les gens qui ont choisi cette école et m’ont beaucoup piqué, il y a Coltrane, Rollins, Johnny Griffin...” Impossible de le contredire sur ce point. Il faut même ajouter, au premier rang de ses créanciers, Lucky Thompson et Benny Golson.
Je connais un excellent jazzologue qui, en découvrant récemment I Got Rhythm (CD I, plage 17) et les autres réalisations du duo Byas-Slam Stewart au Town Hall de New York, s’est écrié: “Rollins n’avait donc rien inventé!” Don Carlos, décédé il y aura bientôt vingt-cinq ans, n’est plus de ceux vers qui les amateurs, engeance frivole au point d’aller contre son propre intérêt, se tournent spontanément. Mais quiconque lui prête l’oreille ne peut être qu’impressionné par la puissance de son souffle et le souffle de son imagination. Son passage chez Count Basie de 1941 à 1943, au poste qu’avait occupé Lester, n’était pas passé inaperçu (cf. par exemple Harvard Blues - 17). En 1945, il fréquentait beaucoup Gillespie et Hawkins, dans les cabarets comme dans les studios, après avoir été un habitué du Minton’s Playhouse, temple de la New Thing du moment (cf. 7). Parker appréciait sa compagnie et, chaque fois qu’il le pouvait, l’entraînait à partager le hobby dont il était obsédé : la descente des accords de Cherokee en canoë-kayak. A la suite de quoi le ténor, interviewé cette fois par Art Taylor, affirmera : “Bird me doit beaucoup, encore qu’il ait été plus influencé par Prez que par moi”. Un mot de Leroy “Slam” Stewart avant de passer à la plage suivante. Inventeur – lorsqu’il se mit à chantonner à l’octave supérieure les lignes de basse qu’il jouait à l’archet – d’un des plus fameux “gimmicks” de l’histoire du jazz (lui aussi peut se traguer d’avoir été imité par Ella, dans son Oh, Lady Be Good du 18 mars 1947), virtuose de son instrument, l’homme dissimule derrière ces qualités spectaculaires ses vraies richesses, qui consistent d’abord en un sens rythmique à peu près infaillible (mise en place, science du rebond, expressivité des nuances, etc.) et en une intelligence harmonique grâce à quoi – la gageure était à frémir! – il pouvait affronter impunément le monstre Tatum, dont il fut l’interlocuteur au cours d’un long stage (1943-44), puis à différentes reprises à partir de 1946 (cf. les enregistrements Capitol du pianiste en décembre 1952, avec Everett Barksdale à la guitare).
La clarinette mise à part, le saxophone ténor a été l’instrument monodique qui - on s’en est étonné après coup - rencontra les plus grandes difficultés dans l’assimilation de l’idiome à la mode. Au point qu’en 1945-46, les quelques spécialistes qui acceptèrent de tenter l’aventure étaient pour la plupart (mettons de côté Lucky Thompson, émule de Don Byas comme on vient de le voir) au moins autant des lestériens que des parkériens. C’est vrai de Wardell Gray, de Teddy Edwards, de James Moody, d’Allen Eager, du Gene Ammons de cette époque, de Stitt lorsqu’il passe de l’alto au ténor, de Stan Getz avant même que ne se forment les “Brothers” (avec Edwards, le futur grand maître des évanescences apparaîtra curieusement comme le plus pugnace de la bande - 18). Et c’est vrai de Dexter Gordon, qui se résolut à plonger dans le maelström dès octobre 45 (Blow Mr. Dexter). Si j’ai préféré l’un des titres de sa deuxième séance pour Savoy (organisée le 29 janvier de l’année suivante), c’est que Bud Powell et Max Roach étaient alors de la partie, associés au contrebassiste Curley Russell (auquel Parker eut souvent recours, au moins jusqu’en 1953) et au trompettiste Leonard Hawkins (plus habile qu’il n’est célèbre). Sans discussion possible, c’est le pianiste qui emporte le morceau dans le fringant Long Tall Dexter (CD II, plage 7), comme d’ailleurs dans Dexter Rides Again, conçu le même jour. Quand au style de “Dex”, au demeurant des plus efficaces, il hésite entre le bop, le swing à la Young et - via certaines tendances présidentielles : celles que traduisent des faces comme Lester Leaps Again (19) - le genre de rhythm n’blues sophistiqué, climatisé, auquel pouvait s’adonner un Illinois Jacquet lorsqu’il ne cherchait pas d’abord à épater la galerie.
Lester et Parker
Une revue musicale d’Outre-Atlantique attribue sa plus haute récompense sous la forme du label “Un disque pour lequel mourir”. Avec, soit dit en passant, une libéralité confondante. L’entrain que mettent ces bons confrères à se précipiter dans la tombe pour un oui ou un non me laisse songeur. Il me semble aussi que la suprême beauté réclamerait plutôt, afin qu’on pût la contempler à loisir, un supplément d’existence. Mais je m’égare sûrement. Toutefois, si l’on admet que certains enregistrements de jazz méritent qu’on se fasse hara-kiri en leur honneur, le These Foolish Things (CD II, plage 4) enregistré par Lester Young en 1945 (20), et où l’on retrouve Marmarosa, ne peut que faire partie du lot. Disons qu’on tient là l’une des ballades de la musique afro-américaine qui justifient le genre. Et qu’on assiste à une grande première dans l’histoire de l’improvisation : dès les premières notes de l’exposé, l’artiste abandonne le thème de Vernon Duke pour façonner de toute pièce une mélodie de son cru. Voilà donc une performance où, en quelque sorte, le tremplin lui-même fait déjà partie du saut. A ceci près qu’il ne s’agit pas d’un saut, mais plutôt d’une sorte de flottement, semblable à celui d’une fumée de cigarette dans l’atmosphère. Au surplus, l’impact émotionnel est considérable : sans jamais solliciter la compassion, Lester dit en quelques instants toute la détresse et tout l’amour du monde. Parker saura se souvenir de cette expérience (la complète mise entre parenthèses du “prétexte mélodique”) lorsqu’il enregistrera deux ans plus tard, assisté par un très touchant Miles Davis, l’Embraceable You des frères Gershwin. Et lui aussi se tirera de l’épreuve haut la main.Adolescent, dans sa ville natale de Kansas City, Charlie avait admiré Lester (alors chez Count Basie) plus qu’aucun autre jazzman. Il allait se percher dans les cintres du Reno Club avec son alto et ne quittait plus le “Pres” des yeux. Quand celui-ci se levait pour prendre un solo, le garçon empoignait son saxophone et feignait de souffler, tout en essayant de placer à mesure ses doigts sur les mêmes clés que Lester – et s’il y parvenait, il pouvait imaginer, en une trop brève extase, que cette musique venue d’une autre galaxie sortait de sa propre poitrine. On doit à Norman Granz l’association sur disque du disciple (dissident, comme tous les disciples qui ont assimilé leur leçon) et du maître, en un temps où l’influence du premier commençait à dépasser celle du second. Au sein du Jazz At The Philharmonic, ils se produisirent sur les mêmes scènes, enregistrant de conserve à trois reprises : en janvier 1946 au Philharmonic Auditorium et en avril à l’Embassy Auditorium de Los Angeles, en septembre 1949 au Carnegie Hall de New York. Lors du deuxième de ces concerts, “Yardbird” s’adjuge sur Oh, Lady Be Good - dont la version par le “Jones-Smith Incorporated” le 9 novembre 1936 (21) avait marqué l’initiale du mandat présidentiel (un règne, en fait, dans la mesure où, à l’époque, Hawkins s’était exilé en Europe) - un chorus époustouflant qui, selon John Lewis, “donna les cheveux blancs à tous les musiciens sur scène ce soir-là !”. Lester, en tout cas, ne tente pas de relever le gant, mais si, au bout du compte, j’ai renoncé à cette pièce, c’est parce qu’elle ne permet pas d’entendre les deux hommes se succéder sans qu’un autre soliste s’interpose. C’est en revanche ce qui se passe sur I Can’t Get Started (CD II, Plage 6), où cette fois l’aîné, après un solo assez déplaisant de McGhee, prend nettement le pas sur le cadet. Contraint de dompter une anche rêtive, Charlie précède lui-même un Willie Smith qui pâtit de ce voisinage et un Al Killian qui fait regretter “Maggie”. Si bien que - sa charge mythique oubliée - l’interprétation ne doit qu’à Lester la grande estime en laquelle les amateurs la tiennent.
De Parker, on attendait sans doute que j’inscrire à mon tableau d’honneur le foudroyant Koko ou encore Hot House (la version princeps de mai 1945 avec le “All Star Quintet” de Dizzy). Alain Tercinet les avait accueillis déjà dans son Birth Of Be Bop, ainsi d’ailleurs que Now’s The Time, dont j’aurais pu me servir pour démontrer la grandeur précoce de Miles. Autant chasser sur d’autres terres. Voici donc, avec Davis à la trompette une fois de plus, Night In Tunisia (CD II, plage 10). Le solo d’alto s’ouvre sur un break à couper le souffle, dont on peut seulement regretter qu’il n’atteigne pas tout à fait la hauteur vertigineuse où il s’élevait dans une prise primitive que le producteur Ross Russell dut renoncer à publier en l’état, à cause des erreurs commises par les autres membres du septette. Russell raconte que Charlie laissa tomber : “Je ne referai plus jamais ce break”. On peut se procurer aujourd’hui chez tous les bons disquaires, sous le titre de The Famous Alto Break, ces quelques mesures fabuleuses. D’après le même témoin, la suite du chorus, qui n’a pas été conservée, surclassait elle-même ce que nous pouvons entendre ici. Admettons-le. Il n’empêche que cette cinquième et dernière tentative, sur laquelle s’acheva la séance, est proprement renversante.La créativité, la puissance, la virtuosité jamais gratuite du Bird sont encore bien mises en valeur par Congo Blues (CD I, plage 16), fruit d’une réunion oecuménique entre quelques classiques nullement rassis (dont le pianiste Teddy Wilson et le contrebassiste fredonnant Slam Stewart), et les enfants terribles de la 52e Rue : Parker et Gillespie (non moins ébouriffant que son complice). Contacté par Les Schreiber, mélomane fanatique qui souhaitait s’essayer à la production, le vibraphoniste (longtemps xylophoniste) Red Norvo servit de catalyseur, un rôle pour lequel il avait toujours montré de grandes dispositions. Etrangement, rendez-vous fut donné aux participants à neuf heures du matin. “Heure sinistre entre toutes pour les jazzmen. Charlie et Dizzy avaient jammé jusqu’à l’heure de l’enregistrement avec une brève pause pour le petit déjeuner ; et deux des autres musiciens étaient arrivés d’une tournée le matin même” – écrit encore Russell, qui commente ainsi la plage que nous avons sélectionnée : “Congo Blues, sur tempo rapide, est une débauche d’énergie qui semble sortir tout droit d’un four atomique.”
Aussi rien ne contraste-t-il mieux avec cette œuvre explosive que le si détendu Slim’s Jam (CD II, plage 5), gravé sept mois après sous la responsabilité de Slim Gaillard, l’un des hommes qui surent le mieux se faire passer pour des irresponsables. Dizzy est toujours de la fête; Marmarosa, une fois encore, a reçu son carton d’invitation, ainsi que le vétéran Zutty Singleton, qui du coup pourra se vanter d’avoir enregistré avec les deux personnages dont Miles Davis déclarait qu’en l’énoncé de leurs noms pouvait se résumer toute l’histoire du jazz : Louis Armstrong et Charlie Parker. Avec cette miniature exquise, c’est un peu de la nonchalance à la Teagarden qui refait surface. Gaillard ne chante pas dans Slim’ Jam : il se contente d’appeler chacun des trois souffleurs du groupe à effectuer leur tour de piste. En commençant par Jack McVea, ténor qui figurait à l’affiche du premier concert enregistré par le J.A.T.P., le 2 juillet 1944 (Blues, Tea For Two, etc.). Le trompettiste viendra le dernier, avec une intervention sobre et remarquablement construite. Mais c’est Bird, pris en sandwich entre ces deux partenaires et présenté par le maître de cérémonie (avec lequel il plaisante de bonne grâce) comme “Charlie Yardbird-oroony”, qui – pour reprendre l’expression américaine de circonstance – “vole le show” avec un chorus dont chaque phrase, chaque note, chaque inflexion, chaque silence portent le sceau du définitif. On remarquera au passage que la formule qui ouvre ce fragment d’alto avait un bel avenir devant elle. L’ensemble de l’œuvre, pour sa part, offre l’un des meilleurs exemples de swing en tempo lent qui se puisse proposer.
Stéphane et Django
Sans Stéphane Grappelli, resté à Londres où il se trouvait au moment de la déclaration de guerre, Django Reinhardt a confié à la cire après le 31 décembre 1943 (22) quelques improvisations mémorables. En particulier celles que lui inspira, après la libération de Paris, son association avec l’Air Transport Command Band dirigé par le sergent Jack Platt (Uptown Blues, Djangology, Artillerie lourde, Belleville, etc.). En janvier 1946, cependant, l’illustre tandem va pouvoir se reconstituer, après que le guitariste aura traversé la Manche à son tour, accompagné de sa femme Naguine, de leur fils Babik, né un an et demi plus tôt, et de Charles Delaunay, son futur historiographe et son protecteur attitré (23). Grappelli, on le devine, se souviendra de ses retrouvailles lorsqu’il rédigera ses mémoires, Mon violon pour tout bagage. “Au début de la séance, – peut-on lire à la page 126 de l’ouvrage – j’attaque spontanément les premières mesures de La Marseillaise, et Django m’accompagne immédiatement. Nous sommes tous deux heureux de fêter, à notre manière, la joie de la Libération et de nos retrouvailles. Charles Delaunay nous a aussitôt demandé de reprendre cette improvisation et l’a fait graver sur une matrice. Hélas, des gens bornés ont crié au sacrilège et la matrice a été brisée. Il a fallu toute l’habileté d’un ingénieur pour récupérer ce morceau qui a été rebaptisé Echos de France. Je suis heureux qu’on ait finalement pu garder cet enregistrement. Nous avons joué cette Marseillaise avec notre coeur à un moment où elle prenait tout sens sens. Les pseudo-patriotes qui nous ont blâmés auraient dû réagir tout comme nous, avec leur cœur, et non pas invoquer des principes ineptes.”Les émois du citoyen, cependant, sont une chose, et les élans du créateur une autre. Le miracle de Echoes Of France (CD II, plage 8) réside en ceci que l’exigence esthétique réussit à y faire oublier la force de l’anecdote.
Claviers
En dépit d’une affirmation soutenue bien à la légère par des commentateurs ou bien inattentifs ou bien trop pressés, Bud Powell n’a pas adapté au clavier le style de Parker au saxophone : il a imposé au “piano jazz”, et pour longtemps, un style qui n’avait d’autre fondation que le génie de Bud Powell lui-même. Son “vaisseau noir”, Bud y mettait le feu chaque fois qu’il y posait les doigts (24). Après quoi, il ne lui restait plus qu’à se lancer dans l’inconnu. Un inconnu qui devant lui, tout à coup, se transfigurait en évidence. Mais, bien sûr, cela n’empêchait pas le pianiste d’écouter, d’étudier Diz et Bird (et Monk) avec le plus grand soin. Comme il avait décortiqué, à ses débuts, la manière de Billy Kyle (compagnon de John Kirby de 1938 à 1942, puis de nouveau en 45-46), qu’il appréciait entre toutes. Les premiers enregistrements de Powell sous son nom datent du 10 janvier 1947 (I’ll Remember April, Bud’s Bubble...) et par conséquent, à dix jours près, ne sont pas encore du domaine public. Mais des morceaux tels que Fool’s Fancy (CD II, plage 15), officiellement revendiqué par “The Sonny Stitt All Stars”, apportent à notre déconvenue une compensation plus que substantielle. Encore qu’un peu gauche ici et là, l’altiste, qui ouvre le feu, s’y montre sensiblement moins appliqué que sur Fat Boy. Dans la foulée, Kenny Dorham exhibe ce qu’il y avait alors de plus prometteur dans son jeu (ce n’est qu’en 1955, toutefois, qu’il remplira pleinement ses promesses, au sein des Jazz Messengers ou dans ses premiers disques Blue Note - 25). Puis Bud déboule des starting-blocks et relègue tout ce qui précède dans les ténèbres extérieures.
Si Powell n’est pas l’exploiteur de Charlie Parker, Al Haig n’est pas davantage, n’en déplaise aux exégètes à la six-quatre-deux, l’obligé de Powell. Du moins, l’influence de Bud étant inévitable, n’apparaît-il pas d’abord comme un de ses élèves. Henri Renaud, qui l’a bien connu, a caractérisé en peu de phrases l’originalité de son apport (effectif dès 1944, on doit le souligner) : “Caractéristique de son jeu, la façon dont, souvent, sa main gauche accompagne sa main droite - deux octaves au-dessous : ainsi interrompt-il parfois le discours de la main droite, laissant à la gauche le soin de lui donner un commentaire - comme s’il s’agissait d’un dialogue des deux mains (...). Il affectionne les forte et les piano soudains.” (26). Son premier enregistrement personnel datant de 1948, il a fallu, là encore, se rabattre sur une pièce où il ne tient qu’un rôle de comparse. Au moins s’agit-il d’un chef-d’oeuvre en soi : le Salt Peanuts du 11 mai 1945 (CD I, plage 14), qui rassemblait autour de Dizzy Gillespie, dans un studio de New York, Curley Russell, un Sidney Catlett inattendu mais parfaitement à sa place derrière les tambours (27), Parker et le pianiste. Celui-ci n’avait pas encore 21 ans. Le Bird (qui l’avait remarqué dans les clubs de la 52e Rue) l’appréciait tant qu’il devait faire appel à lui à différentes reprises, à partir de 1948 surtout et jusqu’en 1953 (Chi Chi, Confirmation, etc.).
Erroll Garner ne savait pas lire la musique. A quelqu’un qui avait un jour mentionné le fait en sa présence, il avait répliqué : “Hell, man, personne ne peut t’entendre lire.” Il n’en fut pas moins une école de piano à lui tout seul, époustouflant New York dès qu’il s’y installa en 1944. On put l’entendre au Melody Bar, au Rendez-vous, au Jimmy’s Chicken Shack, an Tondelayo’s, au Three Deuces ; il eut l’insigne honneur de remplacer Art Tatum, indisposé, au sein du trio que le maître (qui l’adorait, rapporte Slam Stewart) dirigeait alors. Ce n’est que trois ans plus tard, pourtant, qu’il donnera Erroll’s Bounce, Play, Piano, Play, Trio, Pastel, Frankie And Johnny Fantasy, Cool Blues (avec Charlie Parker) ou Blue Lou (avec Wardell Gray). Ces exploits phonographiques sont salués par des commentateurs qui, presque tous, restent muets sur les (nombreux) enregistrements antérieurs du pianiste. Il faut admettre que ceux-ci retiennent moins l’attention, aussi savoureux soient-ils. Pourtant, je n’ai pas eu le cœur d’écarter Garner de cette anthologie. Encore fallait-il dénicher une plage qui fût en tout point digne du reste de la sélection. J’ai trouvé mon bonheur grâce à Philippe Baudoin, sans qui plus rien ne se fait. Il a cité dans le Dictionnaire du jazz Laffont un Sweet Georgia Brown de 1945 (CD II, plage 1), méconnu, que je suis allé écouter, cité du Midi, à l’Institut très privé des Hautes Etudes Jazzistiques dont il est le fondateur. Je n’ai pas regretté le voyage : avant les plages évoquées plus haut, il est bien possible qu’Erroll ne se soit jamais exprimé sur disque (dans le cas particulier, un disque exclusivement destiné à la diffusion radiophonique) avec plus de liberté, d’élan, de limpidité dans la complexité. Ce jour-là, il avait adopté la formule du trio piano-guitare-contrebasse, popularisée par Nat King Cole et reprise notamment par Art Tatum. Il en profite d’ailleurs pour adresser un discret clin d’oeil à ces deux maîtres : l’approche oblique de la mélodie et des accords du thème, le cavalier seul du piano (à 1’35” du début) n’étonneraient pas de Tatum ; la conclusion, quant à elle, est typiquement colienne. Pour Capitol, le King avait du reste enfourché ce vieux cheval de bataille le 23 mai de la même année, lui réservant un traitement fort différent, basé sur une référence récurrente au Peer Gynt d’Edward Grieg.
Big bands
Count Basie a réalisé de fort belles choses pour V-disc le 27 mai 1944. Par exemple Kansas City Stride, Circus In Rhythm, où Lester s’en donne à coeur-joie) et Basie Strides Again (CD I, plage 7). Sur un thème écrit et arrangé par Buck Clayton, l’orchestre brille de tous ses feux, chacun des solistes (le pianiste en premier lieu) s’ingéniant à entretenir la flamme dans la grande tradition de Kansas City à laquelle, pour notre bonheur, le “Kid from Redbank” n’avait pas renoncé. Jo Jones tire l’ultime fusée, marchant sur les talons d’un Président effusif, bien lancé par Dicky Wells, Buddy Tate et Harry Edison. Le “Saint Homme” Basie ne s’attarde pas sur cette superbe séance dans Good Morning Blues, l’autobiographie qu’il a rédigée dans les années 80 avec le concours d’Albert Murray, mais on sait que l’hyperbole, à la ville comme à la scène, n’était pas son fort.Avec Jam-a-Ditty et Blue Skies (Trumpet No End), Happy-Go-Lucky Local (CD II, plage 18) domine le très bel ensemble de faces ellingtoniennes présentées par la compagnie Musicraft, fondée une dizaine d’années plus tôt. Duke Ellington écrivit ce morceau avec l’aide de son fils Mercer, alors qu’il travaillait à une oeuvre ambitieuse, la Deep South Suite, dont Happy-Go constituera le quatrième mouvement. Cette pièce veut évoquer, selon Mercer, un chauffeur de locomotive noir qui, dans le Sud des Etats-Unis, salue à coup de sifflet les amis et connaissances (féminines notamment) que croise sa machine. Il faut avoir été mis dans la confidence pour s’en aviser, mais quelle importance ? Ce n’est pas, chez Duke (que pataches et express ont toujours ému), l’aspect descriptif de la musique qui impressionne le plus. Mais, bien plutôt, l’extrême richesse d’une palette unique en son genre. Happy-Go-Lucky Local prétendrait-il décrire un ciel d’orage sur les abattoirs de Chicago, nous n’en serions pas moins en présence d’une cire exceptionnelle. Complexe, mais puissante. Raffinée, mais dévastatrice. Une sorte de mirage aux couleurs très fauves prend corps, investit l’espace et s’avance à votre rencontre, telle une ville en marche : oublié le prétexte méridional et bucolique c’est aux faubourgs de New York, aux aciéries de Pittsburgh, aux chaînes de montage de Detroit que l’on songe en effet, tandis que le travail de la pâte orchestrale (tutti, enchevêtrement de sonorités, multiplication des motifs mélodiques, etc.) n’abandonne à ceux que le Duke baptisait ses “prime donne” (Johnny Hodges, Cootie Williams, etc.) qu’un terrain d’exercice limité, le contrebassiste Oscar Pettiford, jouant pour sa part, d’un bout à l’autre, un rôle capital - et avec quelle autorité! (28)
Le be bop orchestral bénéficia de deux laboratoires pour ses expériences en grandeur réelle : le big band d’Earl Hines (quand Parker, Dizzy, le tromboniste Bennie Green et Sarah Vaughan en faisaient partie) et celui que forma Billy Eckstine en 1944, avec le concours de Budd Johnson. Du premier n’existe, du moins dans l’état actuel de nos connaissances, aucune trace acoustique – et c’est un drame pour les historiens, lourdement pénalisés par l’action syndicale à laquelle nous avons déjà fait allusion. Le second, en revanche, a légué à la postérité un nombre respectable de pièces à conviction, dont beaucoup cependant (beaucoup trop, diront les mauvaises langues) sont des vitrines pour “Mr. B.”, le baryton de ces dames. En dépit d’une intervention vocale (pour une fois assez alerte, au demeurant), Blowing The Blues Away (CD I, plage 9) n’entre pas dans cette catégorie. Composé par Eckstine lui-même (musicien à plein titre, qui d’ailleurs s’exprima de temps à autre à la trompette ou au trombone à pistons sans se ridiculiser le moins du monde), orchestré par le tromboniste Jerry Valentine, servi par des exécutants dont certains allaient faire parler d’eux (29), cette plage flamboyante et roborative (la contribution de Dizzy n’y est pas étrangère) vaut surtout par le “chase” de ténors, demeuré exemplaire, entre le fils du pianiste Albert Ammons, Gene (19 ans), et Dexter Gordon (de deux ans son aîné).
Pour autant, Blowin’ The Blues Away n’est encore que du “pré-bop”, tandis que, fidèle à son titre, Things To Come (“Choses à venir”) (CD II, plage 14) illustre l’avant-garde de ce mouvement esthétique. Le même jour que I Can’t Get Started With You, Dizzy Gillespie avait enregistré une de ses propres compositions dont et le titre et la substance se voulaient un manifeste : Be Bop. Things To Come, à la confection duquel prêta la main l’arrangeur Walter Gil Fuller (également associé à la réussite de pièces comme One Bass Hit, Ray’s Idea ou Manteca – 30), n’est rien d’autre qu’une adaptation grandiose, voire cataclysmique (la célébrissime coda anticipe sur les audaces free des années 60) de Be Bop. Dizzy s’y adjuge un glorieux solo de trompette, dont Milt Jackson, au vibraphone, parvient à se montrer digne, en dépit de la médiocre qualité de son matériel. Cependant, comme dans Happy-Go-Lucky Local, les performances individuelles retiennent moins l’intérêt que la partition : celle-ci devait longtemps définir la limite de ce qu’une grande formation pouvait se permettre. Et que les hommes de Dizzy, ayant fait de Things To Come leur indicatif, se permettaient chaque soir! En 1946, ce jazz était à faire dresser les cheveux sur la tête (y compris ceux de certains boppers, on peut le parier). La vitesse d’exécution contribuait pour une large part à terroriser les musiciens qui ne s’étaient pas engagés à fond dans l’aventure. Fuller déclara qu’aucun big band ne s’était encore risqué sur pareil tempo. C’est, expliqua-t-il, qu’il s’agissait de faire la nique à Woody Herman dont le “First Herd”, sur Caldonia en particulier, tricotait de la belle manière.
Même si l’allure est beaucoup plus confortable, on ne peut pas dire que cet orchestre flâne dans son interprétation de The Good Earth (CD , plage 18), l’un des textes – avec Wildroot – qui assirent la réputation de l’arrangeur Neal Hefti. Né en 1922, celui-ci n’était pourtant pas un débutant, puisqu’il s’était produit à la trompette dès l’âge de onze ans. Après avoir écrit en 1948, pour Charlie Parker, le splendide Repetition (standard à retardement, que les années 8o mettront à la mode), il offrira ses services à Count Basie dont il deviendra – surtout à partir de E = mc2, entièrement consacré à ses compositions – un collaborateur privilégié. The Good Earth appartient presque entièrement à Flip Philips, coqueluche du public américain en ce temps-là. Woody, cependant, négocie à son avantage un pont de clarinette et Dave Though prouve, s’il en était besoin, qu’il fut, sans jamais se mettre en avant, un immense batteur de big band, en même temps qu’un des rares membres de la corporation capables, comme Sidney Catlett, d’assurer la transition entre deux époques du jazz.On est loin d’en avoir fini avec la controverse soulevée par le cas de Stan Kenton qui, c’est vrai, n’a pas eu en permanence les moyens de ses ambitions. Quelle drôle d’idée, aussi, que de vouloir être le Wagner du swing ? Il s’est épuisé à courir après ce fantasme, et le swing s’en est parfois ressenti. On ne peut lui refuser toutefois d’avoir très tôt brossé un paysage bien à lui, même si le moins discutable (et le moins prétentieux) de sa contribution se rencontre dans des disques réalisés à partir de 1950, grâce à des arrangeurs comme Shorty Rogers, Bill Russo, Bill Holman ou Gerry Mulligan. Artistry In Rhythm (CD I, plage 6) est emblématique de son écriture personnelle, du moins à l’époque où ce futur obsédé des “innovations en musique” avait pour principaux modèles Jimmie Lunceford et Earl Hines. Kenton imagina cette oeuvre au cours des quelques semaines de retraite qu’il s’accorda à Idyllwind (dans les montagnes de San Jacinto, à l’est de Los Angeles), avant de prendre la décision de monter une formation bien à lui, c’est-à-dire dès 1941. Il en fera son indicatif, aussi en existe-t-il plusieurs enregistrements antérieurs à celui de novembre 43, effectué au cours de sa première séance Capitol, la compagnie en faveur de laquelle il venait de quitter Decca. Une légende tenace veut que le 78 tours où ce titre était couplé avec le non moins remarquable Eager Beaver ait lancé le Kenton Orchestra sur la voie du succès. En réalité, c’est une “relecture” du Do Nothing ‘Til You Hear From Me d’Ellington qui connut la première les faveurs du public, en attendant que And Her Tears Flowed Like Wine ne prît le relais un an plus tard. En revanche, Artistry In Rhythm sera la matrice de toute une série de compositions, à commencer par Artistry Jumps, qui triomphera au hit-parade en 1945. Viendront ensuite Artistry In Boogie, In Percussion, In Bolero, In Harlem Swing, In Tango, In Bossa Nova (et je ne suis pas certain que la liste soit close !). On mesure par là l’importance historique de cette plage qui, en soi, n’est pas l’une des plus admirables du signataire (31). De surcroît, elle apparaît inférieure à nombre d’œuvres signées par d’autres formations au cours de la même période mais qui, elles, ont moins frappé l’imagination des contemporains et laissé une trace moins profonde dans la mémoire collective.
Cette observation fait peser sur la notion de chef-d’oeuvre une suspicion légitime. On préfère ne pas y penser. Disons que le mot est commode et qu’il s’agissait surtout, dans la présente anthologie, de réunir des pièces, au besoin imparfaites (la plupart le sont, dans le jazz), au besoin inégales, voire partiellement ratées (cf. par exemple Fat Boy et le I Can’t Get Started du J.A.T.P., qui commence et finit si mal), au besoin “légères” (Casanova’s Lament, Route 66), mais qui fussent toutes, au moins par un de leurs aspects (le solo de Bud Powell dans Fool’s Fancy, l’arrangement de Neal Hefti sur The Good Earth) révélatrices du génie ou de l’extrême talent d’un homme, significatives d’un style (Flying Home, China Boy) ou d’une époque (Salt Peanuts), riches d’une certitude absolue (The Mood To Be Wooed, Back O’Town Blues), porteuses d’un formidable espoir (McGhee Special) ou d’une indicible angoisse (The Man I Love), incomparablement nostalgiques (These Foolish Things) ou incomparablement prophétiques (Things To Come). Car c’est ainsi la vie du jazz et des jazzmen qui s’expose, plutôt qu’une collection d’objets de musée figés dans la conscience de leur prix, aussi impeccables qu’indifférents à nos amours et à nos peurs. Et dès lors, tant pis – ou plutôt tant mieux – si après le I Can’t Get de Dizzy, en route pour l’éternité, vient le Grabtown Grapple d’Artie Shaw, qui reste avec nous en ce bas monde. Avec nous et comme nous - je veux dire provisoirement.
Alain Gerber
© FRÉMEAUX & ASSOCIÉS S.A. 1997
(1) Cf. Quintessence FA 201, FA 206 et hors série FA 230.
(2) Qui s’ouvre sur un I’ll Chase The Blues Away, gravé le 12 juin 1935 avec l’orchestre de Chick Webb.
(3) Cf. les deux nouvelles versions “piratées” de Flying Home en novembre 1948 et avril 1949, respectivement avec le trio de Hank Jones et avec cette même formation augmentée de Howard McGhee à la trompette et des ténors Flip Philips et Brew Moore.
(4) Cf. par exemple la version de Trav’lin’ Light donnée au Shrine Auditorium de Los Angeles le 7 octobre 1946. (On la trouvera dans le deuxième coffret consacré à Billie dans la collection Quintessence).
(5) Celui auquel participait le guitariste Oscar Moore, grâce auquel on était un peu consolé de la disparition de Charlie Christian.
(6) Cf. le premier volume de Jazz/36 chefs-d’oeuvre (FA O16)
(7) FA 046.
(8) Pour Prestige, le 24 décembre 1954 (la deuxième prise).
(9) Né en 1916, victime d’une crise cardiaque en 1947. Pour Gillespie, il “avait à la trompette la plus belle sonorité qu’on pût avoir depuis l’invention de cet instrument”. Miles partageait un appartement avec lui à New York et bénéficiait de ses conseils. S’il faut en croire Benny Bailey, autre spécialiste des pistons, le solo de Davis sur Billie’s Bounce était note pour note celui Webster “for this particular blues” ; saisi par le trac, le débutant se serait rabattu sur cet expédient faute de pouvoir imaginer ses propres phrases. Le problème est que nous ne disposons pas d’un enregistrement de Freddie susceptible d’étayer cette révélation sensationnelle. Quant à moi, j’ai peine à croire que Miles eût attiré l’attention sur la façon dont il avait suivi les traces de son mentor dans cette pièce s’il s’était livré à un pur et simple plagiat.
(10) Traduit en français par Jacques B. Hess, pour les éditions Parenthèses.
(11) Jay Jay Johnson : “Péniblement, difficultueusement, j’ai tenté de transposer ce style au trombone”.
(12) Cf. Quintessence FA 218.
(13) Il pouvait alimenter avec succès aussi bien le répertoire de Glenn Miller que celui de Dizzy Gillespie.
(14) Cf. Quintessence FA 216.
(15) Ces deux interprétations figurent dans le coffret Quintessence FA 216.
(16) Cf. Quintessence FA 213
(17) In Quintessence FA 202.
(18) Cf., pour Stan, Opus De Bop et surtout Running Water, de juillet 1946, avec Roach à la batterie ; pour Teddy : Up in Dodo’s Room, en octobre de la même année, sous la direction de Howard McGhee et en compagnie de notre vieille connaissance Dodo Marmarosa.
(19) Le 22 mars 1944, sous la bannière de Keynote (cf. Quintessence FA 210)
(20) Sous étiquette Aladdin. A ne pas confondre avec la version Savoy, déjà très belle, d’avril 1944. Il est à noter que Lester signa plusieurs chefs-d’œuvre pour Aladdin, à commencer par D.B. Blues, réalisé le même jour que These Foolish Things.
(21) Cf. Quintessence FA 210.
(22) Date à laquelle il nous a fallu, pour nous conformer à la loi Lang, clore l’anthologie Quintessence consacrée à Django (FA 205).
(23) Ce n’était pas la première fois. Avec le quintette du H.C.F., il avait gravé à Londres dès 1938 quelques œuvres de première importance, notamment My Sweet, Daphné et Stompin’ At Decca.
(24) Dizzy Gillespie : “Bud, Oooooo, he used to burn it!”
(25) Cf. Afro-Cuban (Blue Note BLP 1535).
(26) In Dictionnaire du Jazz (dans la collection Bouquins, chez Robert Laffont).
(27) Il remplaçait au pied levé Stan Levey, le batteur attitré de ce groupe qui se produisait régulièrement au Three Deuces. Diz et Bird, les leaders, avaient engagé Al Haig et c’est seulement après plusieurs mois de cette collaboration que ce dernier découvrit l’existence de Bud Powell, sur les disques Hit de Cootie Williams. “J’ai suggéré à Charlie et à Dizzy – a-t-il déclaré – que c’était là le pianiste qui, plutôt que moi, devait jouer dans l’orchestre.”
(28) Il avait rejoint l’année précédente Ellington, avec lequel il resterait jusqu’en 1948. Mais dès 1944, il avait participé en première ligne à la révolution bop. On peut encore l’apprécier ici dans I Can’t Get Started, avec Gillespie, et surtout dans Stuffy, où il conforte Hawkins dans son attitude jusqu’au-boutiste.
(29) Le pianiste John Malachi, futur accompagnateur de Sarah Vaughan (cf. notamment Shulie a Bop, en 1954), mais aussi le contrebassiste Tommy Potter, le baryton Leo Parker et plus encore le batteur Art Blakey.
(30) Il ne faut pas le confondre avec Walter Fuller, trompettiste chez Earl Hines au cours de la précédente décennie.
(31) Unique soliste à s’y exprimer, et les solos n’ont jamais été son fort. Remerciements à Philippe Baudoin il va de soi, mais aussi à Christian Gauffre et Don Waterhouse.
english notes
36 STEPSFROM THE PROVISIONALTO THE ETERNAL
Voices
Jack Teagarden was not only the “father” of the modern trombone and a tremendous improviser in the same way the Oran “Hot Lips” Page did not uniquely go down in history as a trumpeter ranked between Armstrong and Roy Eldridge. Both also mastered the art of jazz singing. Perhaps they had not learnt the technicalities of the trade, but they were, nevertheless, far from being bathtub amateurs. The former was only shadowed by his occasional partner, Satchmo, and the latter turned out to be one of the greatest blues shouters of the period.“Mr. T.”, a pure bred Texan, had the ability of combining his nonchalance with controlled staggering when tipsy (which was a frequent happening). Swing benefited from the resulting rhythmic phenomenon – combined anticipations and delays. Casanova’s Lament was recorded during a particularly fruitful session, finding Teagarden on good form, as was also the clarinettist, Jimmy Noone. The composition of the band was rather outlandish, having been put together by Hollywood movie studios right after the record strike decreed by the American Federation of Musicians. Anyway, Teagarden was apparently satisfied with this tailor-made number (by Dave Dexter Jr.) as it became a regular feature in his repertory for twenty odd years.Page’s Uncle Sam Blues evokes the period when America’s young men were being lured into warfare, which was devastating for jazz music in full mutation. Many tried avoiding their obligations, and there again, the majority of blacks were not totally patriotic. This number is of quality, with “Hot Lips’” trumpet imitation of the bugle call, and whose playing is enhanced by the delicate pianist, Clyde Hart.Back O’Town Blues was one of the last recordings made by Louis Armstrong at the head of his big band, which he was to break up in Summer 1947. The balance is perfect, oozing with sobriety and expression, and the number is discretely punctuated by the future All Stars singer, Velma Middleton.
The previous year, Ella Fitzgerald cut Flying Home with Vic Schoen’s somewhat spineless orchestra. The “First Lady” of jazz and swing had already made over fifty recordings, but this song was maybe the first where she was easily recognisable, even to the uninitiated. It was also the first time that this singer, who was to become world-famous with Mack The Knife and How High The Moon, blatantly presented her mastery of scat singing, and began using her voice as a veritable instrument (the development of which was later to be encouraged particularly by Dizzy Gillespie).The true essence of Billie Holiday is found in the recordings made during her first concerts with the J.A.T.P. in 1945-46, when her drug abuse was just beginning to take its toll. The imperfections of the songs, including The Man I Love, render them exquisitely flawless. Her helplessness rises her above the limitations of other instruments and techniques, giving her a sense of expression which few have been able to reach. The only regret is that Lester Young, who was present, did not participate. Sarah Vaughan was the prize member of the Mount Zion Baptist Church choir in Newarck before winning the Apollo amateur contest before her twentieth birthday. This fundamental step led her to Billy Eckstine, who, in turn, introduced her to Earl Hines and she was placed in his orchestra in April 1943 principally as a singer, but also as an occasional pianist. Through her new contacts she met Charlie Parker and Dizzy Gillespie with whom she recorded Mean to Me in May 1945 (another excellent version was waxed five years later with Miles Davis and Budd Johnson).It is impossible to imagine Route 66 without the Nat King Cole trio in the same way that Strangers In The Night is associated with Frank Sinatra. Its simplicity is apparent compared the musicians’ other titles, but, paradoxically, it is Nat’s breeziness which has prevented his works from evaporating with the time.
Valves And Slides
We all know that Dizzy Gillespie’s career was somewhat aided by his idol Roy Eldridge. Roy’s generous side can be heard in his bubbling The Gasser, a variation of Sweet Georgia Brown. Towards the end of his professional life “Little Jazz” used a Harmon mute to conceal his skidding, but here it is used with expertise before he continues on an even more hazardous journey without his mute. The whole world of bop was inspired by his improvisations.Charlie Shavers, to some extent, and Howard McGhee also participated in the linking of the old and new schools of thinking. McGhee Special was one of the latter’s most vibrant works, and its music score is a forerunner to the great upheaval in written orchestral jazz from 1944 onwards.Dizzy Gillespie was fond of the extraordinary during the forties, rendering it hard to choose a representative title. I Can’t Get Started, included in the present collection, is considered as a classic, where the unbragging trumpeter concludes with the famous line “To Be, or not...to Bop” – a coda which was to be found in later numbers.In 1945, a mighty path lay ahead of the nineteen-year-old Miles Davis. Nevertheless he had already taken his stance next to Charlie Parker, and was an artist in his own right, as is proved by Now’s The Time and Billie’s Bounce. In the company of this tremendous partner, his musical contribution has a poetic touch, and in the second title he manages to capture Freddie Webster’s sought-after sonority.“Oh, man, that’s the way I want to play”, cried Fats Navarro the first time he heard Gillespie. In the attempt, Fats spent days on end practising with his mute. Theodore Navarro’s size was impressive, hence his nickname “Fat Girl”, which was also a term meaning cocaine (whereas “Fat Boy” represented heroine). Ironically, Fats died of an overdose before his twenty-seventh birthday. Four years previously, in 1946, the trumpeter cut several sides including Fat Boy with the Be-Bop Boys. Its length, incompatible with the 78 record’s standards, accounts for the break in the piano solo. Its perfection is slightly marred by the incompetence of Eddie De Verteuil, Kenny Dorham and Sonny Stitt, but Fats and Bud Powell’s interventions make up for it. Powell was also able to unveil his prowess alongside Dexter Gordon and then with Jay Jay Johnson in 1946. The career of this revolutionary trombonist was then dawning. Four titles, including Mad Be Bop, were waxed on the same day, and all of which contributed to J.J.J. being designated as the best trombonist of his generation.
Reeds
Arthur Arshawsky, otherwise known as Artie Shaw, could have made an excellent band leader, but was, above all, an unrivalled clarinettist. Like Benny Goodman, his capacities as a technician left a glimmer of doubt as to his talents on the improvisation front. He entered the recording studios with his “Gramercy Five” in 1940 and 1945. The second session included The Grabtown Grapple, arranged by the competent Buster Harding, and which probably puts this often neglected band in its best light. The four soloists express themselves with grace and intensity, and the outcome could be compared to John Kirby’s sextet. Sidney Béchet is renowned for his jubilant and effervescent style, but he truly excelled in his Town Hall, New York concert where he was encouraged by an exuberant “Baby” Dodds. The concert gave birth to his most torrid version of China Boy where the dazzle of spirited Louisiana is concentrated in a three-minute blaze.One of Béchet’s disciples was the alto-saxophonist, Johnny Hodges, whose inter-connected career with Ellington gave way to a flourishing repertoire. During the 1944 to 1955 period, his greatest chef-d’œuvre is no doubt The Mood To Be Wooed, a mini-concerto which exudes an unctuous lyricism. This extraordinary musician managed to create his own universe in which he abided faithfully until the end, unequalled even by Charlie Parker.After the thunderous impact of Body And Soul, waxed in 1938, Coleman Hawkins had several years of grace. His music was increasingly vibrating, and the sheer quality can be heard in the Capitol recording sessions between February 1945 and June 1947. The first included Stuffy, Stardust and Rifftide, the theme of which (as that of Stuffy) was “borrowed” from Thelonious Monk. In Stuffy, Hawk puts over dissipated ferocity, and is well-backed by the rest of the team.
Neither Hawk nor Lester Young were particularly tender when they evoked Chu Berry. It was maybe due to the fact that this prodigious artist strayed from the paths set by the two masters of the tenor saxophone that he never gained deserved recognition. Blowing Up A Breeze is generally judged as the best of his works produced during his brief career (“Chew” was killed in a car accident at the age of thirty-one, two months after this session).Budd Johnson and Don Byas, along with Hawkins, were directly implicated in the smooth transition from middle jazz to be bop. Budd, previously a star of Earl Hines’ big band, and somewhat shaped by Lester Young’s style, had a finger in nearly every pie, predominantly due to his talents as an arranger. Father Steps In is representative of his skills in this field and also as an improviser in a memorable interpretation under the leadership of “Fatha Hines”.Don Byas, otherwise known as “Don Carlos” was fully aware of his prestige and was ever-apprehensive of being bettered. His professional life began in 1932, and followed the absolute Hawkinsian monarchy, the Youngian secession and the Chuberrian Jacquerie. He subsequently founded his own movement, primarily based on borrowed concepts from others, although he only admitted to his own heraldry. Notwithstanding, many others, including Coltrane, Rollins, Lucky Thompson and Benny Golson opted for his discipline.The amateur jazz fiends do not tend to seek out Don Carlos’ works spontaneously, but those who do must admit to his powerful puff and imaginative streak. I Got Rhythm as other Byas-Slam Stewart numbers from their Town Hall, New York concert never fail to amaze the unaccustomed. His vocation also led him to replace Lester with Count Basie from 1941 to 1943, and was often found with Gillespie and Hawkins in 1945. Parker also sought out his company.
A few words on Leroy “Slam” Stewart before going onto the next track. His illustrious gimmick consisted of singing an octave higher than the notes played on the bass. He mastered his instrument with competence, his sense of rhythm was faultless and his harmonic coherence could compete with that of the giant Tatum.The tenor saxophone was the monodic instrument which encountered the biggest difficulties in being assimilated into the flavour of the period. Most of those who launched into the adventure emerged from the Lester or the Parker school of thought. This was the case of Dexter Gordon who dived into the deep end in October 1945 (Blow Mr. Dexter). Long Tall Dexter, included in this collection, was extracted from his second Savoy session in January 1946 where Bud Powell’s sublime accompaniment is also complimented by Max Roach, Curley Russell and Leonard Hawkins. “Dex” mingles bop, Young-style swing and sophisticated and airy rhythm n’ blues to produce an extremely effective genre.
Lester and Parker
If one had to choose the cream of all jazz discs, Lester Young’s 1945 recording of These Foolish Things would have to take a prime position. It is revolutionary in the history of improvisation – right from the first notes, Vernon Duke’s original theme is forsaken as the artist ventures into new territory. The music could be compared to smoke, wafting up into the atmosphere, and has a tremendously emotional impact. Lester manages to resume during these instants the dismay and love in the entire world.As a teenager, Charlie Parker esteemed Lester more than any other jazz musician. He tailed “Pres” in the Reno Club, simulating his every action on his own saxophone. Master and disciple were finally reunited, thanks to Norman Granz, and under the Jazz At The Philharmonic outfit they played on the same stage and recorded together on three occasions. In the 1949 Carnegie Hall concert, “Yardbird’s” contribution in Oh, Lady Be Good was breath-taking, but in I Can’t Get Started, the product of the 1946 concert, the two artists can be appreciated individually and Lester takes distinct leadership. Parker’s other pieces, notably Koko and Hot House have already appeared in Alain Tercinet’s Birth Of Be Bop. Here, we discover, with Miles Davis on the trumpet, Night In Tunisia. Parker opens his solo with a mind-blasting break, which was only bettered by one in a previous taken which had been rejected by the director, Ross Russell, due to errors committed by the other members. These fabulous phrases can be found in The Famous Alto Break, available in all good record shops.Bird’s creativity, strength and virtuosity are also present in Congo Blues, interpreted by a few of the regulars and with the 52nd Street terrors, Parker and Gillespie. The vibraphonist, Red Norvo was used as the catalyst in this 9 o’clock session, a rather hostile hour of day for most jazz artists. As Russell put it, the Congo Blues, with its rapid tempo, is a riot of energy, seemingly coming straight from an atomic furnace.In quite another vein is Slim Gaillard’s laid-back Slim’s Jam. Dizzy and Marmarosa partake once again, as does the veteran Zutty Singleton. Gaillard does not sing in this piece but acts as Master of Ceremony for the three blowers. “Charlie Yardbirdoroony” manages to steal the show with each inflection bearing the mark of absolution. It is, altogether, one of the best examples of slow tempo swing.
Stéphane and Django
During his separation from Stéphane Grappelli, who was in London when war was declared, Django Reinhardt cut several unforgettable improvisations. The illustrious duo was able to reunite in January 1946 and Stéphane recalls in his memoirs their celebrated meeting which they accompanied with a spontaneous improvisation of La Marseillaise. Charles Delaunay, Django’s future historiographer, quickly requested them to repeat it while he put it onto a matrix. Unfortunately, it was considered as sacrilege by some, and the evidence was destroyed. The piece was salvaged with difficulty, to be rechristened Echos de France.
Keyboards
Contrary to what is believed by some, Bud Powell’s piano jazz belongs to himself alone, and is no way a keyboard adaptation of Parker’s saxophone. This fact does not, however, prevent him from analysing the music of others, in particular, that of Diz, Bird and Monk, as well as that of Billy Kyle previously. Powell’s first recordings in his name cut in January 1947 never really got off the ground, but they are compensated by others, such as Fool’s Fancy, the credit of which is officially claimed by “The Sonny Stitt All Stars”. Whereas Stitt’s performance is somewhat clumsy in places, Kenny Dorham shows great promise (he was to truly bloom in 1955). And then Bud sprints from the starting line, pushing everyone else to one side.Al Haig didn’t belong to the Parker school either, but was, on the other hand, unconsciously influenced by Powell. His style of playing consisted, according to Henri Renaud, of his left hand accompanying his right two octaves below, and the former was occasionally left to comment alone – creating a kind of dialogue between the two. His first personal recording dates from 1948, although he is only given a minor role. Salt Peanuts, recorded in 1945 is, however, a masterpiece, reuniting Curley Russell, Sidney Catlett, Parker (who wasextremely appreciative of Haig’s talents) and Haig around Dizzy Gillespie. Erroll Garner was incapable of reading music. When once reminded of this fact, he retorted, “Hell, man, nobody can hear you read”. Nevertheless, he took New York by surprise when he unfolded his gifts in 1944, playing in multiple bars and clubs. It was three years later that his choice recordings (Erroll’s Bounce, Play, Cool Blues and Blue Lou to name but a few) gave him the deserved credit. His anterior pieces, as pleasant as they are, are less appealing, apart from his 1945 radio recording of Sweet Georgia Brown which was discovered thanks to Philippe Baudoin. In this track he adopts the Nat King Cole piano-guitar-bass formula which Art Tatum was also partial to.
Big bands
Count Basie came out with some stunning numbers on the V-disc label on the 27th May 1944, including Basie Strides Again, composed and arranged by Buck Clayton. The orchestra is dazzling and each of the soloists bear the torch in the great Kansas City tradition. This superb session is barely referred to in Basie’s autobiography, but there again, he was never one for exaggeration. Happy-Go-Lucky Local is at the top of the list of the quality sides recorded by Musicraft. Duke Ellington wrote this piece with his son, Mercer, the essence of which is supposed to evoke a train driver in the Southern States, who greets his passing friends and acquaintances. It is, all the same, an exceptional creation – complex yet powerful, refined yet ravaging.Two big bands experimented extensively with orchestral be bop: that of Earl Hines (although no waxed trace exists to our knowledge), and that of Billy Eckstine, helped along by Budd Johnson. The latter bequeathed a considerable amount of evidence. Eckstine’s Blowing The Blues Away, a flamboyant and invigorating composition belongs to it.In Things To Come, we discover Dizzy Gillespie’s “pre-bop”, the forerunner of the above-mentioned movement. This piece, arranged by Walter Gil Fuller, is no other than an imposing, even cataclysmic, adaptation of Be Bop. With Dizzy’s sublime trumpet solo, and its audacious tempo, it became the band’s theme tune, and was performed daily.The Good Earth resumes a more comfortable pace. Neal Hefti, the arranger, wrote the splendid Repetition for Parker in 1948, and he became a mainstay in Count Basie’s career. The success of The Good Earth mainly revolves around Flip Philips (America’s darling of the period), but the other musicians also prove their worthiness.Stan Kenton, whose intentions were to become the Wagner of swing, did, undeniably, have his own style, even though his best records appeared after 1950. Artistry In Rhythm is representative of his compositions during his “innovating” phase. Perhaps it is not the highest ranked work in Kenton’s repertoire, but holds a strong place for historical reasons, for its led to a whole series of compositions (Artistry In Boogie, In Percussion, In Bolero...) and had a huge impact on his contemporaries.All these above-mentioned imperfections could lead to confusion when it comes to the term “masterpieces”. Some are partially ineffectual (e.g. Fat Boy and I Can’t Get Started), or flighty (Casanova’s Lament, Route 66) but all contain at least one aspect that reveals the genius of at least one artist (Bud Powell in Fool’s Fancy, Neal Hefti’s arrangement of The Good Earth), that denotes a certain style (Flying Home, China Boy), or a period (Salt Peanuts), that exudes in richness (The Mood To Be Wooed, Back O’Town Blues), that brings optimism (McGhee Special), or anguish (The Man I Love), or nostalgia (These Foolish Things) or that is prophetic (Things To Come). And what does it matter if after Dizzy’s I Can’t Get which is on its way to eternity came Artie Shaw’s Grabtown Grapple which stays with and like us on earth – provisionally.
Adapted by Laure WRIGHT from the French text of Alain GERBER
CD 36 Masterpieces of Jazz Music © Frémeaux & Associés (frémeaux, frémaux, frémau, frémaud, frémault, frémo, frémont, fermeaux, fremeaux, fremaux, fremau, fremaud, fremault, fremo, fremont, CD audio, 78 tours, disques anciens, CD à acheter, écouter des vieux enregistrements, albums, rééditions, anthologies ou intégrales sont disponibles sous forme de CD et par téléchargement.)