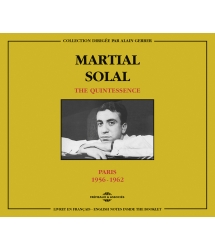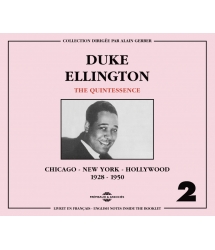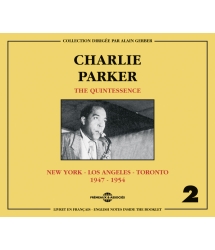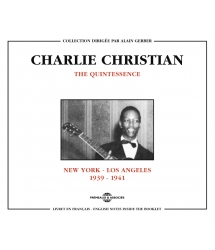- Notre Catalogue
- Philosophie
- Philosophes du XXème siècle et d'aujourd'hui
- Histoire de la philosophie (PUF)
- Contre-Histoire et Brève encyclopédie par Michel Onfray
- L'œuvre philosophique expliquée par Luc Ferry
- La pensée antique
- Les penseurs d'hier vus par les philosophes d'aujourd'hui
- Textes philosophiques historiques interprétés par de grands comédiens
- Histoire
- Livres
- Sciences Humaines
- Paroles historiques
- Livres audio & Littérature
- Notre Catalogue
- Jazz
- Blues - R'n'B - Soul - Gospel
- Rock - Country - Cajun
- Chanson française
- Musiques du monde
- Afrique
- France
- Québec / Canada
- Hawaï
- Antilles
- Caraïbes
- Cuba & Afro-cubain
- Mexique
- Amérique du Sud
- Tango
- Brésil
- Tzigane / Gypsy
- Fado / Portugal
- Flamenco / Espagne
- Yiddish / Israël
- Chine
- Tibet / Népal
- Asie
- Océan indien / Madagascar
- Japon
- Indonésie
- Océanie
- Inde
- Bangladesh
- URSS / Chants communistes
- Musiques du monde / Divers
- Musique classique
- Compositeurs - Musiques de film - B.O.
- Sons de la nature
- Notre Catalogue
- Jeunesse
- Philosophie
- Nouveautés
- Comment commander ?
- Recevoir le catalogue
- Manifeste
- Dictionnaire











- Notre Catalogue
- Philosophie
- Philosophes du XXème siècle et d'aujourd'hui
- Histoire de la philosophie (PUF)
- Contre-Histoire et Brève encyclopédie par Michel Onfray
- L'œuvre philosophique expliquée par Luc Ferry
- La pensée antique
- Les penseurs d'hier vus par les philosophes d'aujourd'hui
- Textes philosophiques historiques interprétés par de grands comédiens
- Histoire
- Livres
- Sciences Humaines
- Paroles historiques
- Livres audio & Littérature
- Notre Catalogue
- Jazz
- Blues - R'n'B - Soul - Gospel
- Rock - Country - Cajun
- Chanson française
- Musiques du monde
- Afrique
- France
- Québec / Canada
- Hawaï
- Antilles
- Caraïbes
- Cuba & Afro-cubain
- Mexique
- Amérique du Sud
- Tango
- Brésil
- Tzigane / Gypsy
- Fado / Portugal
- Flamenco / Espagne
- Yiddish / Israël
- Chine
- Tibet / Népal
- Asie
- Océan indien / Madagascar
- Japon
- Indonésie
- Océanie
- Inde
- Bangladesh
- URSS / Chants communistes
- Musiques du monde / Divers
- Musique classique
- Compositeurs - Musiques de film - B.O.
- Sons de la nature
- Notre Catalogue
- Jeunesse
- Philosophie
- Nouveautés
- Comment commander ?
- Recevoir le catalogue
- Manifeste
- Dictionnaire
DUKE ELLINGTON
Ref.: FA236
Direction Artistique : ALAIN GERBER
Label : Frémeaux & Associés
Durée totale de l'œuvre : 1 heures 46 minutes
Nbre. CD : 2

- - PLAYLIST TSF
- - CHOC JAZZMAN
- - DUKE ELLINGTON VOL 2 / PLAYLIST TSF
- - “INDISPENSABLE” JAZZ HOT
- - RECOMMANDÉ PAR JAZZ CLASSIQUE
- - CHOC JAZZMAN
- - SÉLECTION JAZZ NOTES
“C’était aussi un pianiste d’enfer.”
Ralph J. Gleason
Les coffrets « The Quintessence » jazz et blues, reconnus pour leur qualité dans le monde entier, font l’objet des meilleurs transferts analogiques à partir des disques sources, et d’une restauration numérique utilisant les technologies les plus sophistiquées sans jamais recourir à une modification du son d’origine qui nuirait à l’exhaustivité des informations sonores, à la dynamique et la cohérence de l’acoustique, et à l’authenticité de l’enregistrement original. Chaque ouvrage sonore de la marque « Frémeaux & Associés » est accompagné d’un livret explicatif en langue française et d’un certificat de garantie.
Edition sous la direction d'Alain Gerber et Patrick Frémeaux, Notice discographique par Alain Tercinet, Discographie par Daniel Nevers, Editorialisation par Claude Colombini.
Frémeaux & Associés’ « Quintessence » products have undergone an analogical and digital restoration process which is recognized throughout the world. Each 2 CD set edition includes liner notes in English as well as a guarantee.
Les "incontournables" de l'Histoire du jazz, une présentation sobre, de bon goût, des livrets opulents (personnels, dates et lieux d'enregistrement, noms et références des labels d'origine, etc..), une " direction artistique" assurée par l'un des meilleurs écrivains du jazz, Alain Gerber (magnifique liner notes).
Frédéric Goaty - Jazz Magazine
Droits d'éditorialisation : Groupe Frémeaux Colombini SAS.
SOLOS : Swampy River • Mood Indigo/Solitude • Informal Blues • Dear Old Southland • There Was Nobody Looking - QUASI-SOLOS : Fast And Furious • The Clothed Woman - DUOS : Sophisticated Lady • Mr J.B. Blues • Dancers In Love • Tonk • Drawing Room Blues - TRIOS : Frankie And Johnny • Jumpin’ Room Only • Cottontail • C Jam Blues • Johnny Come Lately • Great Times - UNE MINIATURISATION DE LA GRANDEUR : The Six Jolly Jesters Goin’ Nuts • Duke Ellington Sextet Tough Truckin’ • Indigo Echoes • Rex Stewart & His 52nd Street Stompers Rexatious • Love In My Heart • Fat Stuff Serenade • Rex Stewart & His 0rchestra My Sunday Gal • Mobile Bay • Subtle Slough • Menelik The Lion Of Judah • Barney Bigard & His Jazzopators Clouds In My Heart • Stompy Jones • Lament For A Lost Love • Barney Bigard & His Orchestra A Lull At Dawn • Cootie Williams & His Rug Cutters Blue Reverie • Echoes Of Harlem • Delta Mood • Mobile Blues.
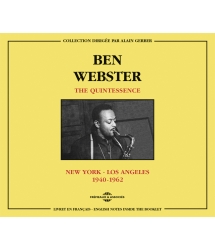
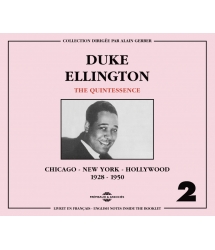
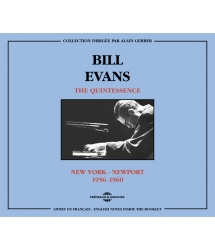
-
PisteTitreArtiste principalAuteurDuréeEnregistré en
-
1SWAMPY RIVERDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:02:471940
-
2MOOD INDIGO SOLITUDEDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:03:091936
-
3INFORMAL BLUESDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:02:441939
-
4DEAR OLD SOUTHLANDDUKE ELLINGTONHENRY CREAMER00:03:211941
-
5THERE WAS NOBODY LOOKINGDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:02:561946
-
6FAST AND FURIOUS LOTS OF FINGERSDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:02:521932
-
7THE CLOTHED WOMANDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:02:571947
-
8SOPHISTICATED LADYDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:02:481946
-
9MR JB BLUESDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:03:071940
-
10DANCERS IN LOVEDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:02:211945
-
11TONKDUKE ELLINGTONBILLY STRAYHORN00:02:481946
-
12FRANKIE AND JOHNNYDUKE ELLINGTOND P00:03:391945
-
13JUMPIN ROOM ONLYDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:02:401945
-
14COTTONTAILDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:02:361950
-
15C JAM BLUESDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:03:021950
-
16JOHNNY COME LATELYDUKE ELLINGTONBILLY STRAYHORN00:03:051950
-
17GREAT TIMESDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:03:001950
-
18GOIN NUTSDUKE ELLINGTONJOHNNY HODGES00:02:541929
-
PisteTitreArtiste principalAuteurDuréeEnregistré en
-
1TOUGH TRUCKINDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:02:381935
-
2INDIGO ECHOESDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:03:071935
-
3REXATIOUSDUKE ELLINGTONREX STEWART00:02:521936
-
4LOVE IN MY HEARTDUKE ELLINGTONH ALVIS00:02:481937
-
5FAT STUFF SERENADEDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:02:361939
-
6MY SUNDAY GALDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:02:421940
-
7MOBILE BAYDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:03:151940
-
8SUBTLE SLOUGHDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:03:091940
-
9MENELIK THE LION OF JUDAHDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:03:211940
-
10CLOUDS IN MY HEARTDUKE ELLINGTONB BIGARD00:03:201936
-
11STOMPY JONESDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:03:021936
-
12LAMENT FOR A LOST LOVEDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:02:441937
-
13A LULL AT DAWNDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:02:451940
-
14BLUE REVERIEDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:03:341937
-
15ECHOES OF HARLEMDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:03:021938
-
16DELTA MOODDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:03:131938
-
17MOBILE BLUESDUKE ELLINGTONDUKE ELLINGTON00:02:491938
-
18DRAWING ROOM BLUESDUKE ELLINGTONBILLY STRAYHORN00:02:251946
DUKE ELLINGTON THE QUINTESSENCE fa236
DUKE ELLINGTON
THE QUINTESSENCE
CHICAGO - NEW YORK - HOLLYWOOD
1928 - 1950
DISCOGRAPHIE
CD I Solos, duos, trios
Edward Kennedy “Duke” Ellington (piano dans toutes les plages)
Solos
01. Swampy River. New York City, 1er octobre 1928. OKEH W 401173-B.
02. Mood Indigo/Solitude. Hollywood, 26 décembre 1936. BRUNSWICK LO 377-1.
03. Informal Blues. New York City, 8 mars 1939. BRUNSWICK M-991-1.
04. Dear Old Southland. New York City, 14 mai 1941. VICTOR BS 065 504-2.05. There Was Nobody Looking. New York City, Carnegie Hall, 23 novembre 1946. V-DISC 759.
Quasi-solos
06. Fast And Furious (Lots O’Fingers). D.E. (lead) and his band. New York City, 17 mai 1932. BRUNSWICK B-11851-A
07. The Clothed Woman. D.E. (lead) + Harold Baker (tp), Johnny Hodges (as), Harry Carney (reeds), Alvin “Junior” Raglin (b), Sonny Greer (dm). New York City, 30 décembre 1947. COLUMBIA CO 38671-1.
Duos
08. Sophisticated Lady. D.E. + Jimmy Blanton (b). Chicago, 1er octobre 1940. VICTOR BS 053 506-2.
09. Mr J.B. Blues. Même séance que pour Sophisticated Lady. VICTOR BS 053 507-1.
10. Dancers In Love. D.E. + Junior Raglin. New York City, 30 juillet 1945. VICTOR D5VB 519-1.
11. Tonk. DUKE ELLINGTON AND BILLY STRAYHORN : D.E. + Strayhorn (p). New York, 10 janvier 1946. VICTOR D6VB 1518-1.
12. Drawing Room Blues. Même séance que pour Tonk. VICTOR D6VB 1519-1.
Trios
13. Frankie And Johnny. DUKE ELLINGTON & HIS RHYTHM : D.E. (lead), Junior Raglin (b), Sonny Greer (dm). New York City, 16 mai 1945. VICTOR D5VB 271-1.
14. Jumpin’ Room Only. Même séance que pour Frankie And Johnny. VICTOR D5VB 272-1.
15. Cottontail. BILLY STRAYHORN TRIO : Strayhorn, D.E. (p), Wendell Marshall (b). New York City, 3 octobre 1950. MERCER 5710.
16. C Jam Blues. Même séance que pour Cotton Tail. MERCER 5711.
17. Johnny Come Lately. Même formation que pour Cotton Tail, mais Joe Shulman (b) remplace Wendel Marshall. New York City, novembre 1950. MERCER M2480.
18. Great Times. Même séance que pour Johnny Come Lately. MERCER M2482.
CD II Combos
The Six Jolly Jesters
01. Goin’ Nuts. D.E. + Cootie Williams (tp), Freddy Jenkins (tp, voc), Joe “Tricky Sam” Nanton (tb), Johnny Hodges (as), Teddy Bunn (g), Fred Guy (bjo), Wellman Braud (b), Sonny Greer (dm), Bruce Johnson (washboard), Harold “Blinky” Randolph (kazoo). New York City, 29 octobre 1929. VOCALION E31371-A
Duke Ellington Sextet
02. Tough Truckin’. DUKE ELLINGTON SEXTET : D.E. (lead) + Rex Stewart (ct), Hodges, Harry Carney (anches), Braud, Billy Taylor (b). New York City, 5 mars 1935. COLUMBIA B-16975-2.
03. Indigo Echoes. Même séance que pour Tough Truckin’. COLUMBIA B-16976-2.
Rex Stewart & His 52nd Street Stompers
04. Rexatious. Stewart (ct, lead), D.E., Lawrence Brown (tb), Hodges, Carney (reeds), Ceele Burke (g), Taylor (b), Greer (dm). Hollywod, 16 décembre 1936. VARIETY B-4369-A.
05. Love In My Heart. Stewart (ct, lead), D.E., Freddy Jenkins (tp), Hodges, Carney (reeds), Brick Fleagle (g, arr), Hayes Alvis (b), Jack Maisel (dm). New York City, 7 juillet 1937. VARIETY M-550-1.
06. Fat Stuff Serenade. Stewart (ct, lead), D.E., Louis Bacon (tp), Nanton (tb), Bigard (cl), Fleagle (g), Taylor (b), Greer (dm). New York City, 20 mars 1939. VOCALION WM-996-1.
Rex Stewart & His 0rchestra
07. My Sunday Gal. Stewart (ct, lead), D.E., Brown (tb), Ben Webster, Carney (reeds), Jimmy Blanton (b), Greer (dm). Chicago, 2 novembre 1940. BLUEBIRD BS 053 608-1.
08. Mobile Bay. Même séance que pour My Sunday Gal. BLUEBIRD BS 053 609-1.
09. Subtle Slough. Même formation que pour My Sunday Gal. Hollywood, 3 juillet 1941. BLUEBIRD BS 061 243-1.
10. Menelik The Lion Of Judah. Même séance que pour Subtle Slough. BLUEBIRD BS 061 344-1.
Barney Bigard & His Jazzopators
11. Clouds In My Heart. Bigard (cl, lead), D.E., Williams (tp), Juan Tizol (valve tb), Carney (bars), Taylor (b), Greer (dm). Hollywood, 19 décembre 1936. VARIETY LO 371-2.
12. Stompy Jones. Même séance que pour Clouds In My Heart. VARIETY LO 374-2.
13. Lament For A Lost Love. Même formation que pour Clouds In My Heart. New York City, 29 avril 1937. VARIETY M-433-2.
Barney Bigard & His Orchestra
14. A Lull At Dawn. Bigard (cl, lead), D.E., Ray Nance (tp), Tizol (valve tb), Webster (ts), Blanton (b), Greer (dm). Chicago, 11 novembre 1940. BLUEBIRD BS 053 623-3.
Cootie Williams & His Rug Cutters
15. Blue RÊverie. Williams (tp, lead), D.E., Nanton (tb), Hodges, Carney (reeds), Alvis (b), Greer (dm). New York City, 8 mars 1937. VARIETY M-188-2.
16. Echoes Of Harlem. Williams (tp, lead), D.E., Nanton (tb), Bigard, Hodges, Carney (reeds), Guy (g), Taylor (b), Greer (dm). New York City, 19 janvier 1938. VOCALION M-729-2.
17. Delta Mood. Williams (tp, lead), D.E., Bigard, Hodges, Carney, Otto Hardwick (reeds), Taylor (b), Greer (dm). New York City, 21 décembre 1938. VOCALION M-954-1.
18. Mobile Blues. Même séance que pour Delta Mood. VOCALION M-956-2.
LE PIANISTE
The piano player out of the band
Son instrument, on le sait bien, ce n’était pas le piano, c’était l’orchestre. Au point que son arrivée sur scène suffisait à modifier la couleur, la texture, la tonicité, la dynamique de ce que ses hommes étaient en train de jouer : avant et après qu’il surgisse, estimait Earl Hines, “c‘était le jour et la nuit”. A l’inverse, lorsqu’il improvisait sur un clavier, il traitait celui-ci comme s’il avait eu toute une palette orchestrale à sa disposition. De sorte que les quelques perles déposées par lui, tels les cailloux blancs du Petit Poucet, au seuil de la caverne d’Ali Baba, rivalisaient parfois de prix avec le trésor qu’on allait découvrir à l’intérieur (1)...A l’image de Hines, voire d’Art Tatum, mais avec des moyens techniques autrement plus limités, le soliste Edward Kennedy “Duke” Ellington fut un pianiste-orchestre. Il fut aussi, comme le souligne judicieusement Jacques Réda dans un article de référence (2), le “pianiste de l’orchestre” qu’il se flattait d’être, et de plus d’une façon : “La formule peut être entendue non seulement dans une acception d’appartenance, mais dans un sens pour ainsi dire génératif : le pianiste de l’orchestre est aussi le pianiste que l’orchestre a engendré, mais c’est réciproquement l’homme qui joue du piano dans l’orchestre, qui a fait que cet orchestre devînt capable d’être celui où il se façonnerait.” L’approche pianistique si singulière d’Ellington s’est coulée dans le moule d’un contexte symphonique lui-même influencé, “informé” par cette conception-là du clavier (3). Dès lors, on imagine sans peine que les plus mémorables interventions de Duke furent celles qu’il signa en tant que “Duke’s man”, au même titre que Billy Strayhorn, Johnny Hodges ou Cootie Williams.Pour l’essentiel, un examen clinique des centaines d’enregistrements (4) qui s’échelonnent sur un demi-siècle (1924-1974) vérifie cette intuition.
Néanmoins, il faut considérer deux choses au terme de cette enquête. Primo : en matière de quintessence, l’oeuvre la plus révélatrice n’est pas moins précieuse que la plus aboutie. Ainsi, une pièce comme Informal Blues (5) ne mérite pas l’immortalisation, mais c’est une de celles qui dévoilent le mieux la tentation d’aventurisme par quoi la musique ducale échappe au pittoresque et transcende le pictural, une de celles qui soulignent avec le plus de netteté l’articulation entre l’ellingtonisme et l’esthétique du tâtonnement qu’illustrera bientôt Thelonious Monk, avec un génie considérable (6). Secundo : dans le domaine que nous avons choisi d’explorer se rencontrent aussi des réalisations majeures, en particulier les duos d’octobre 1940 en compagnie de Jimmy Blanton (7) ou les morceaux à quatre mains avec Strayhorn, en 1946 et surtout en 1950.Au demeurant, peut-être n’est-il pas nécessaire de justifier un parti-pris qui n’incite pas à la polémique : comment laisserait-on dans l’ombre une région de l’oeuvre dont tout le monde s’accorde à dire qu’elle en est l’une des clés et cependant l’un des aspects les plus méconnus ? Le pianiste des monologues, tandems et trios apparaît à la fois comme le complément/le négatif, l’éclaireur/le gestionnaire, le bon génie/ le démon tentateur du “piano player of the band”. Lequel d’ailleurs va bientôt l’affronter de manière moins souterraine. A partir du 13 avril 1953, en effet, Duke enregistrera en solo ou en comité très restreint non plus seulement des faces isolées (8) ou des mouvements inscrits dans des suites impliquant la formation au complet (9), mais, de temps à autre, des séries d’interprétations présentées au public comme des ensembles cohérents, sinon homogènes. Ainsi l’“album” Capitol H/T477 réunira-t-il sous le titre de The Duke Plays Ellington douze plages qui font apprécier le signataire à la tête d’un trio que complètent le contrebassiste Wendell Marshall (10) et, le batteur Butch Ballard. D’autres microsillons suivront : Piano In The Foreground, en 1961, avec Aaron Bell et Sam Woodyard, l’année suivante : le tourneboulant Money Jungle, avec Charles Mingus et Max Roach ; The Pianist, toujours en trio, en 1970 ; This One’s For Blanton!, duo avec Ray Brown, en 72 et, un an plus tard, Duke’s Big 4, qui unit aux protagonistes de This One’s le guitariste Joe Pass et le batteur Louie Bellson (11).
Une histoire de bouton
Avant 1953, lorsqu’il lui arrive de quitter le vaisseau amiral, le Duke mène sa barque avec une certaine désinvolture. Plus exactement : un manque à peu près total d’ambition (12). Informal Blues en atteste, ainsi que le vibrillonnant Fats And Furious, au sous-titre explicite (“Des tas de doigts”), cette attitude ne signifie pas que l’artiste n’exige rien de lui-même. Au contraire, reconnaissance en terrain miné ou exercice de prestidigitation, ce sont le plus souvent des défis qu’il se lance. S’il lui arrive de se replier sur des positions acquises, comme dans le pot-pourri du 21 décembre 1936 (Mood Indigo/ Solitude), c’est le moins souvent possible. Lorsqu’il prend en charge une oeuvre, fût-elle mineure, cet homme qui veille à maintenir une distance aristocratique entre le monde et lui ne se résout pas facilement à laisser glisser. Il se révèle, mine de rien, perfectionniste jusque dans la frivolité. Perfectionniste à outrance : perfectionniste du genre obsessionnel. Mais qui pourtant ne revient pas en arrière, ne rature ni ne ravaude...Une confidence de Rex Stewart permet peut-être de mieux comprendre (du moins de mieux cerner le mystère). Dans un portrait qu’il consacra en 1967 à son ancien patron (13), le cornettiste raconte : “Si un bouton pend au bout d’un fil ou - pire encore - est parti, jamais plus le vêtement auquel il appartient ne sera porté par Duke. Il est à la disposition des camarades de l’orchestre (14).” Joli symbole.Ellington le pianiste est incapable de jouer du bout des doigts. Ce qu’il sait le moins faire, ce sont les choses à moitié. D’une façon ou d’une autre, il a besoin de s’investir. Pourquoi? J’imagine trois raisons principales à cette attitude dont il ne s’est jamais départi (15).
D’abord, formé à l’exigeante, à l’éprouvante école du stride où, au début des années 20, vous ne surviviez qu’en réchappant nuit après nuit d’une compétition permanente (16), il était porté à faire fumer son instrument. Quelques décennies plus tard, Sam Woodyard le baptisera encore “Piano Red”, surnom qu’on pourrait traduire par “Celui-qui-chauffe-les-claviers-au-rouge”.Ensuite, si l’homme n’était pas insensible à la poudre aux yeux, que lui-même du reste dispensait largement, le créateur, en revanche, restait à travers tout un monstre de lucidité. Pris dans les turbulences de Fast And Furious ou étrennant le malaise d’Informal Blues, il contrôlait encore trop bien sa trajectoire pour songer à lâcher le palonnier. Enfin - et ce n’est pas contradictoire - il avait le culte de l’imprévisible. Soumis dès ses débuts (comme Louis Armstrong, comme Fats Waller, comme tout le monde à l’époque) aux lois du showbusiness, il craignait d’ennuyer. Dans les années fauves de la Prohibition, tenir en éveil l’intérêt d’un public en mal de distraction (d’amusement, mais aussi d’anesthésie mentale) représentait pour l’“entertainer” un défi qu’il était vital de relever. Et comme, de surcroît, s’ennuyer soi-même était péché mortel aux yeux du satrape Elington, son style montrait - selon Hodeir - “plus de variété, plus de fantaisie” que l’approche des autres représentants de la tradition à laquelle il se rattachait (17) : “celle des pianistes de la côte Est, dont Sticky Mac, Doc Perry et Willie “The Lion” Smith furent les initiateurs, et James P. Johnson et Fats Waller les grands maîtres.” Jugement qui le hisse d’un coup parmi l’élite des malaxeurs d’ivoire. Ce style, précise le même auteur, “est le reflet d’une personnalité musicale plus complexe, capable d’embrasser de plus vastes horizons.”Néanmoins, Hodeir l’analyse sans complaisance : “Duke Ellington, écrit-il dans une monographie éditée en 1971 (18), n’est certes pas un grand pianiste : son toucher est rude, sa technique quelquefois défaillante... (Il) joue avec peu de précision.” Mais voilà : “...il lui arrive de se servir du piano en grand musicien... Sa phrase, où s’intègrent des accents nerveux, des accords massifs et des traits souvent stéréotypés, est toujours logiquement construite et bien équilibrée.”
Un génie pressé
Tout se passe comme si, ignorant avec superbe le fait que ses moyens sont limités, il s’imposait une obligation de résultats. Duke ne mène pas nécessairement sa course dans toutes les règles de l’art, mais il touche presque toujours au but qu’il s’était fixé. Réussir d’abord, essayer après : on dirait que cet incomparable stratège a trop de batailles à gagner pour s’attarder aux questions de tactique. Duke est un génie pressé. Et du coup, tout en restant de saison, les réserves hodeiriennes demandent d’être nuancées. Le toucher dont il fait état apparaît moins rude que pugnace quand on l’imagine galvanisé par la volonté, la démangeaison de vaincre. On voit des mains qui se lancent à l’assaut du clavier (19), impatientes d’avaler les obstacles. Dans cette sorte d’urgence, les incidents de parcours n’importent guère. Non seulement les défaillances motrices, les approximations formelles trahissent le peu de valeur accordé aux détours de la technicité et aux ronds de jambe protocolaires, comparés aux raccourcis du système D et aux pieds de nez complices : elles proclament sans ambages la préséance du tout sur les parties, la primauté de l’impression d’ensemble sur la revue de détail. L’éthique musicale, en somme, ne saurait se ramener à des questions d’étiquette. L’essentiel n’est pas que chaque pièce soit à sa place et comme neuve : c’est que la machine fonctionne. En gros, peut-être – du moment que c’est aussi en grand. Seigneur dans l’âme, Duke ne se préoccupe pas des ratés de l’engin pour autant qu’il le domine. C’est-à-dire pour autant que l’engin le mène là où il veut au rythme qu’il veut, et en suivant le tracé précis qu’il a dans la tête. Il peut connaître en cours de route toutes sortes d’anicroches, au bout du compte il sera quand même un voyageur heureux. Parvenu à l’étape frais comme l’oeil sans avoir manqué aucun des rendez-vous prévus sur son itinénaire.Le bonheur, justement, fait qu’il n’y a pas trace de violence dans son agressivité, ni trace de bâclage dans sa précipitation : Duke ne veut pas perdre le bénéfice d’une telle ardeur, d’un tel élan – rien de plus.
Et c’est le bonheur, on l’aura deviné, qui confère à son art de pianiste - à sa sonorité en premier lieu - cette plénitude qui associe, non sans prodige, volume, densité, intensité, profondeur (20). “The Ellington’s tone”! Une sombre luisance en émane, qui jaillit de la pénombre et crève les yeux. Ce son pèse, énormément – et pourtant il vous tire vers le haut d’une manière irrésistible. Deux vertiges de sens contraire tantôt s’annulent et tantôt s’additionnent. Au point d’équilibre, on se croirait sous les architraves d’une cathédrale caverneuse, à demi enfoncée dans la glaise, hérissée cependant de flèches tranchantes : effilées, cristallines, lumineuses comme des aiguilles de glace...Certains pianistes ont les mains qui dansent avec les touches. D’autres peuvent donner le sentiment d’entrenir une relation directe avec les cordes. Ellington est l’un des rares avec Monk et Eddie Costa dont l’effort paraît s’être concentré sur les marteaux. C’est peu de dire qu’il est percussif : il burine et frappe l’enclume. Forge. Chaudronne à tout va. Dans une gerbe d’incandescences, un tablier de cuir passé sur son costume rose, il ferre les chevaux d’une voiture dont on ne sait plus si c’est le carrosse de Cendrillon ou la calèche du comte Dracula.Ne comptez pas sur lui pour vous renseigner. Midi, minuit, la fin de la fête et son début se sont toujours un peu mélangés dans sa tête. De même, la perversité et la candeur. L’ingénuité et l’ingéniosité. La sophistication et l’attentat. Les marlous, les marquis. Les couleurs du prisme et les femmes de sa vie. La brousse et le ghetto. L’indigo et le jour qui se lève. Avec Duke, ce qui ramène aux origines devient indiscernable de ce qui précipite au déclin. Lorsqu’il tend le miroir, on est toujours un peu en train de regarder la mort en face, et tenté de faire à cette enjôleuse une cour anachronique. Simultanément, on a beau vouloir garder les pieds sur terre, on est en train de se voir renaître. Le soir qui tombe sent la rosée du matin, les requiems ont plus qu’un arrière-goût de revenez-y... D’ailleurs, c’est clair, son fantôme lui-même n’a toujours pas l’air de savoir qu’Edward Kennedy Ellington a passé l’arme à gauche, il y a plus de vingt-cinq ans de cela.
Notes complémentaires
sur certains titres
- On n’y a jamais insisté à ma connaissance, mais les faces du 16 mai 1945, Frankie And Johnny et Jumpin’ Room Only, comptent parmi les premiers enregistrements en studio (21) d’un trio formé d’un piano, d’une contrebasse à cordes et d’une batterie.
- Si nous avons retenu Fast And Furious et The Clothed Woman en dépit d’interventions du big band au grand complet dans le premier morceau et de trois “souffleurs” dans le second, c’est que les contributions de ceux-ci et de celui-là se limitent à relativement peu de chose. Pendant près de 2’10, D.E. s’exprime seul sur Fats And Furious; le morceau s’achève quarante secondes plus tard, non sans qu’il ait monopolisé la parole une fois de plus (de 2’31 à 2’44). Dans la version du 30 décembre 1947 de The Clothed Woman (22), l’orchestre ne se manifeste qu’entre 0’48 et 1’03, dans un rôle très subalterne.
- Le medley de 1936 et le charmant There Was Nobody Looking gravé un an plus tard remettent en mémoire une réflexion de Ralph J. Gleason (23) : “...il pouvait vous la jouer bluesman de rent party à neuf heures du matin, après une longue nuit blanche. Mais il pouvait aussi vous la jouer amant à la guitare, poussant la sérénade sous les fenêtres d’une dame...”
- Ce n’est pas le pianiste qui se taille la part du lion dans Mr J.B. Blues, au titre d’ailleurs explicite. Il nous a semblé toutefois que cette pièce cruciale – parce que révolutionnaire pour l’époque et fondatrice de tout un courant esthétique qu’entretiendront tour à tour Oscar Pettiford, Red Mitchell et Scott LaFaro – ne pouvait être séparée du patrimoine ellingtonien. Jimmy Blanton, de toute façon, apportait à l’ellingtonisme sa contestation interne, c’est-à-dire une occasion paradoxale de se surpasser. Dans les duos d’octobre 1940, “non seulement (il) tient de bout en bout la dragée haute au pianiste mais, en tant qu’instrumentiste virtuose et swingman aux réflexes innés, il répond du tac au tac à la moindre sollicitation du maître. Le tête-à-tête aurait-il pu virer au face-à-face?” observe Alain Pailler dans son magnifique Plaisir d’Ellington (24). Au surplus, on ne peut jurer que le contrebassiste aurait exercé la même influence sur l’évolution du rôle de l’instrument et de la section rythmique dans le jazz (donc sur les nouvelles orientations de cette musique tout entière pendant la Deuxième Guerre mondiale), si Duke ne l’avait pas arraché à l’orchestre Jeter-Pillars et aux dancings de St. Louis.
- Dans leurs enregistrements communs pour RCA, Strayhorn et son employeur se partagent le même instrument : Duke s’était installé à gauche, du côté des graves ; Billy avait pris possession de l’autre moitié. Cependant, il arrive que le maître se réserve plus que sa juste part du registre médium, tandis que le disciple doit se limiter aux octaves supérieures. On remarquera que les deux hommes peuvent ou bien combiner leurs lignes, comme dans Tonk, ou bien les alterner comme dans Drawing Room Blues, gravé au cours de la même séance (25). Contrairement à leur valeur intrinsèque et à leur intérêt documentaire, la qualité acoustique des quatre mains de 1950 n’est pas exemplaire. Lorsque Riverside prépara au début des années 60 la première réédition de ces oeuvres produites à l’origine par le fils de Duke, Mercer Ellington, on s’aperçut que la plupart des “mères” métalliques s’étaient égarées dans la nature. Aussi fallut-il recourir aux copies commerciales dont pouvaient disposer des collectionneurs qui, on s’en doute, ne les avaient pas forcément ménagées.
Alain Gerber
(1) Cf. par exemple, dans le volume 1 (FA 204), les introductions à Take The “A” Train et All Too Soon.
(2) Duke Elington : “The Piano Player Of The Band” (1924-1939)”, in L’Improviste. Une lecture du jazz. (Folio essais).
(3) N’oubions pas qu’il fut en outre un pianiste pour l’orchestre inégalé dans ce rôle. “Bien peu d’accompagnateurs peuvent lui être comparés”, a noté André Hodeir. En fait, personne ne réussit mieux que lui à installer un tempo, à cadrer une interprétation, à disposer des masses sonores dans l’espace et à les faire jouer entre elles, à ménager des transitions ou à creuser des contrastes, à donner sa valeur exacte à chaque nuance dynamique, à inciter chaque soliste à livrer le meilleur et surtout le plus intime de sa personnalité. Sur le vif, il affirme, affine et prolonge au piano son prodigieux travail d’orchestrateur. Earl Hines a déclaré : “Je pense que ce qui fit de lui un pianiste aussi unique fut qu’en plus d’être un styliste et un arrangeur, il composait. J’aurais souhaité qu’il grave plus de disques en solitaire, mais je n’ai jamais oublié la manière qu’il avait de stimuler ses gens. (...) L’influx rythmique n’était pas ce qui lui faisait défaut.” En un certain sens, chaque pièce continuait grâce à lui de s’écrire dans l’instant où les musiciens l’interprétaient et où le public la déchiffrait. Il était bel et bien le principe vital qui animait le Duke Ellington Orchestra, cet organisme d’une rare complexité, fragile, en raison même de la capacité explosive qui le rendait instable.(
4) La discographie ellingtonienne est d’assez loin la plus riche de toute l’histoire du jazz.
(5) Elle ne fut pas commercialisée à l’époque. Réda, peu suspect d’allergie au pianiste, y qualifie son jeu de “médiocre, un peu lourd et laborieux”.
(6) Cf. entre autres le disque Thelonious Monk Plays Duke Ellington (Riverside RLP 12-201) et notamment la version presque réticente de Solitude qu’il propose.
(7) Si le formidable Pitter Panther Patter ne figure pas ici, c’est qu’il servait déjà de conclusion au précédent volume. Quant à Body And Soul, nous ne l’avons écarté que pour varier les plaisirs.
(8) Au tout premier rang de celles-ci, on citera une version de Lotus Blossom en solo, tranquille et bouleversant adieu à Billy Strayhorn capté par les micros de RCA Victor en 1967, à l’insu de son interprète.
(9) Comme ici Dancers In Love, emprunté à la Perfume Suite dont il constitue le troisième et avant-dernier élément.
(10) Son seul interlocuteur dans trois d’entre elles.
(11) Déjà partenaire d’Ellington, pour lequel il composa et arrangea aussi quelques oeuvres (Skin Deep, The Hawk Talks, etc.), entre 1951 et 1953.
(12) Jusqu’aux duos avec Blanton, manifestement, rien n’est destiné à marquer le siècle. On a rejoint l’espace de la récréation, ou du moins de l’interlude (du jeu sans enjeu).
(13) Sketches In A Ducal Vein, publié en août dans Music Maker puis repris dans le recueil de Stewart édité par Macmillan en 1972 sous le titre de Jazz Masters Of The 30’s.
(14) On ne résiste pas au plaisir de livrer la suite de l’histoire : “Par cette générosité, Ellington marque sa faveur envers tel ou tel membre de sa formation. Certains des musiciens entrés dans ses bonnes grâces s’étaient rendus célèbres pour avoir délibérément donné du mou à un bouton appartenant à un beau manteau ou à une veste de sport qu’ils convoitaient.”
(15) Cf. par exemple Cotton Tail dans Duke’s Big 4 (CD. Pablo/Fantasy 2310703-2), déjà cité et réalisé peu de temps avant sa mort.
(16) Peut-être n’aurait-il jamais fait carrière à New York s’il n’y avait triomphé en combat singulier de champions aussi teigneux que Willie Hope ou Minnesota Fats.
(17) Des plages telles que Swampy River, Fast And Furious, (voire Dear Old Southland, malgré la discontinuité du discours) témoignent clairement de cette filiation.
(18) Dont l’offensive va couvrir l’entière étendue.
(19) Dans un recueil collectif publié chez Casterman sous la direction de Henri Renaud : Jazz Classique.
(20) J’entends : refus de superficialité.
(21) Après ceux d’Erroll Garner le 18 décembre 1944.
(22) A ne pas confondre avec celle, plus longue – plus recueillie et plus “concertante” à la fois –, donnée trois jours plus tôt devant le public du Carnegie Hall de New York.
(23) In Celebrating The Duke & Louis, Bessie, Billie, Bird, Carmen, Miles, Dizzy, & Other Heroes (Delta).
(24) Plaisir d’Ellington. Le Duke et ses hommes, 1940-1942 (Actes Sud).
(25) Ils se partagent les cinq chorus de la façon suivante : les trois chorus impairs pour Strayhorn, les deux pairs pour Ellington.
LES PETITES FORMATIONS
“... Depuis toujours, a écrit Claude Carrière (a), le “famous orchestra” n’est pas vraiment un big band comme les autres. C’est plutôt une grande petite formation en un seul grand orchestre, au gré de l’imagination féconde d’un maître d’oeuvre de génie.” Car, en comité restreint, Duke reste le patron. Il publie peu de pièces sous son nom, en dehors de Tough Truckin’ et d’Indigo Echoes, mais continue de tenir la plume. Non seulement parce qu’il signe ou cosigne beaucoup de thèmes, imagine nombre d’arrangements, mais parce qu’il imprègne ou inspire d’une façon ou d’une autre - à l’exception peut-être de Goin’ Nuts - la plupart des mélodies écrites par des tiers et parce qu’il contrôle de son banc le déroulement des opérations qui, par accident (b), auraient échappé à son impulsion personnelle (c).En 1975 (c’est-à-dire après la mort du maître, il n’est pas inutile de le souligner), le clarinettiste Albany Barney Bigard s’est plaint auprès du critique anglais Max Jones, alors collaborateur vedette de Melody Maker, d’avoir écrit pendant qu’il était membre du D.E. Orchestra, soit entre décembre 1927 et juin 1942, une bonne douzaine de thèmes, parmi lesquels des réussites du calibre de Stompy Jones, Clarinet Lament ou même Mood Indigo, dont aucun ne sera copyrighté sous son seul nom.
Pire, il serait avec Johnny Hodges l’auteur de l’exultant Rockin’ In Rhythm (d), dont les “crédits” ne les mentionnent ni l’un ni l’autre... Que cette revendication soit fondée, d’instinct je parierais que oui. Pourtant, elle ne tire pas à conséquence le moins du monde. Bigard n’oublie qu’une chose : s’il est arrivé à Miles Davis de s’approprier des morceaux qui ne lui ressemblent guère (e), “the Ellington touch” confère à Rockin’ In Rhythm, ainsi qu’à Mood Indigo ou à Clouds In My Heart, l’essentiel de leur personnalité et, surtout, la presque totalité de leur charme. Duke a peut-être délibérément privé Barney de ses droits légitimes, mais, à l’insu de celui-ci, il est clair qu’une large part de responsabilité lui revenait dans les créations de son clarinettiste. La vraie question est : dans le cas où il serait resté sideman chez King Oliver ou chez Luis Russell, Bigard aurait-il seulement songé à écrire des pièces de ce genre? Il est bien difficile de le croire. Ellington ne tirait sa subsistance du milieu où il baignait que dans la mesure où ce milieu se révélait perméable à ce qu’il diffusait en lui, aux virus qu’il lui inoculait. En bref : tous les échanges qu’il entretint avec ses collaborateurs jusqu’à sa mort obéirent au schéma primitif de ses relations privilégiées avec Bubber Miley entre 1924 et 1929 (f).Plus important : la relation ambigüe – cultivée en tant que telle – entre le grand ensemble et les unités réduites qui en émanent. Chacun sait que de la polyphonie massive émergent fréquemment des agrégats sonores plus modestes, mais non pas moins envoûtants, comme ces associations (à quatre, trois ou deux) entre bois et cuivres bouchés dont D.E. fut le précurseur et, d’emblée, le magicien.
On n’entend pas assez proclamer, en revanche, que les petites formations ellingtoniennes sont presque tout aussi souvent – plutôt que des abrégés – des concentrés de big band. Disons, pour mettre tout le monde d’accord, des réductions au sens culinaire du terme. On ne diminue pas : on miniaturise. Mais surtout, lorsque les circonstances s’y prêtent, on profite de ce qu’on s’étend moins loin pour aller plus profond. Bien entendu, il serait absurde de prétendre que les oeuvres exécutées par toute la troupe (au nombre desquelles Black And Tan Fantasy et Ko-Ko, entre autres) sont plus superficielles que les autres. Ce qui est vrai – mais ne va nullement de soi, comme une réflexion trop rapide pourrait le donner à penser –, c’est qu’il leur arrive en plus d’une occasion de creuser davantage la dimension intimiste d’une œuvre dont les deux sommets (fin des années 20/début des années 40) relèvent largement d’une esthétique expressionniste. Et cela, même – c’est l’un des grands paradoxes et des plus beaux miracles ellingtoniens – lorsqu’ils se réclament d’un certain impressionnisme (je pense par exemple à des pièces “atmosphériques” comme Chloe (g), du 28 octobre 1940, voire à tel ou tel détail du Chelsea Bridge (h) du 2 décembre 1951).D’ailleurs, “intimiste” n’est peut-être pas le mot qui convient. Il pourrait suggérer que les pièces concernées présentent davantage de finesse et de délicatesse, témoignent d’une plus grande pudeur ou d’une plus grande impudeur que les réalisations en big band. Fausse piste : la différence se situe ailleurs. Elle apparaît à un niveau déjà subtil de l’analyse. Voire de la simple perception. Preuve en est que bien des auditeurs indifférents aux précisions discographiques et accoutumés à ne recevoir de la musique que des impressions globales ignorent tout bonnement que les versions princeps de Mood Indigo (i), déjà cité, ou de Caravan (j) ont été confiées à la cire par des contingents limités. Lorsque ceux-ci fouillent l’intimité de l’ellingtonisme, ils l’explorent dans toutes les directions.
Et l’on sait que plus d’une piste se détournait des trajectoires susceptibles de déboucher sur un quelconque intimisme. Autant que l’intimité pastel, l’intimité fauve était mise à nu (en particulier lorsque Rex Stewart ou Cootie Williams prenait les choses en mains). Fût-il “savant”, “stylisé”, “décanté”, “fictif” le primitivisme auquel Miley avait initié le sophisticated gentleman dont il s’était fait l’âme damnée ne sera jamais répudié que provisoirement, le temps par exemple d’une ballade onctueuse ou d’un blues voluptueux comme ceux que secréta en abondance Johnny Hodges (k).The intimate Ellington n’était pas moins canaille, mal embouché, menaçant, terrible parfois, que raffiné. De surcroît, une part de son génie consistait justement à être l’un et l’autre à la fois. Et c’est cette ambivalence qu’il sut – pour le meilleur neuf fois sur dix – communiquer aux hommes qui occupaient dans son dispositif les positions stratégiques. S’il ne fallait en citer que trois : Cootie, successeur de Bubber en 1929, Ben Webster entre 1942 et 1943 (l) et – encore une vérité qui ne s’énonce guère – le batteur Sonny Greer, coloriste, certes, mais aussi, à sa façon diaboliquement sournoise, pousse-au-crime (m).Il arrive que, dans la section rythmique des small bands, le Duke se fasse tout petit (n). Mais il n’arrive jamais qu’il fasse oublier sa grandeur. Lorsqu’il se cache derrière ses “prime done”, comme il avait baptisé ses solistes, il en profite non pour se dissiper mais, au contraire, pour se recentrer, se ressourcer, se refaire une innocence. Se dérobant, il ne s’en dévoile que mieux. Le masque sous lequel il s’avance est son portrait craché, et cette manière de mensonge ressemble beaucoup à l’aveu d’un secret.
Notes complémentaires sur certains titres
- Philippe Baudoin, à propos de Goin’ Nuts : “Bruce Johnson, le ‘Chick Webb du washboard’, possède une puissance, une sonorité et un drive insurpassé sur une planche à laver. Grâce au renfort d’un contingent de l’orchestre d’Ellington, il nous donne son chef-d’oeuvre dans (ce morceau) basé sur les accords de Nagasaki (o).” C’est Cootie Williams qui ouvre les hostilités à la trompette.
- Bien qu’ils ne furent commercialisés que de nombreuses années après la séance où - pense-t-on généralement - ils furent inscrits au programme sans préméditation, Tough Truckin’ et Indigo Echoes comptent parmi les joyaux de la couronne ducale. Johnny Hodges, au saxophone soprano, y rappelle qu’il avait été l’élève et le protégé de Sidney Bechet, plusieurs années avant de rejoindre Ellington.- Bruiteur sensationnel et cocasse (Menelik), expert dans l’art de faire parler un cornet (p) et de triturer le son par un jeu de lèvres inorthodoxe et sa technique de pistons abaissés à mi-course, improvisateur franchement romantique (My Sunday Gal) ou vaguement patibulaire (Mobile Bay), William “Rex” Stewart (1907-1067) fut salarié de l’orchestre à deux reprises : de 1934 à 1943, puis, après un séjour chez Benny Carter, entre 43 et 46. Il avait fait ses débuts professionnels à 14 ans sur les riverboats et s’était imposé en intégrant cinq ans plus tard la phalange de Fletcher Henderson. Très rares, chez les musiciens “colored”, sont les spécialistes de l’instrument à avoir été comme lui fascinés par Bix Beiderbecke avant de prendre conscience du génie de Louis Armstrong et d’en tirer la leçon. Néanmoins, il se démarquera plus nettement de ce modèle (source d’inspiration, mais aussi force castratrice) que tous ses confrères de l’époque, Henry “Red” Allen et Jabbo Smith exceptés. Pour beaucoup de commentateurs, il est avec eux - en attendant l’intervention décisive de Roy Eldridge à partir de 1935 - l’un des précurseurs, sinon du be-bop, du moins d’une certaine conception de la trompette qu’illustrera Dizzy Gillespie. Il faut aussi saluer en lui un chroniqueur de jazz de grand talent. On lui doit notamment un recueil de souvenirs, d’anecdotes, de portraits et d’aperçus édité par Macmillan en 1972 sous le titre de Jazz Masters Of The 30’s.
- Disparu le 27 juin 1980, le clarinettiste (et saxophoniste - q) Leon Albany Barney Bigard était né le 3 mars 1906 à La Nouvelle-Orléans, où, à l’instar de Jimmie Noone, Albert Nicholas et Omer Simeon, il bénéficia des leçons du légendaire Papa Tio et de son neveu Lorenzo (membre du Lyre Symphony Orchestra dès 1897). Ellington l’accueillit dans sa formation en décembre 1927 (premier solo enregistré : sur Sweet Mama, le 9 janvier suivant); il n’abandonnera pas son poste avant le mois de juin 1942. L’un de ses principaux sujets de gloire? Avoir été, le 27 février 1936, le premier souffleur de l’orchestre, avec Cootie Williams, autour de qui Duke éleva l’édifice d’une oeuvre complète. En l’espèce, il s’agissait de Clarinet Lament, explicitement sous-titré Barney’s Concerto. Un fort parti de critiques (peut-être pour le venger d’avoir été éclipsé par Benny Goodman; peut-être aussi parce qu’il leur fit moins peur que Pee Wee Russell - r) veut voir en Bigard le clarinettiste majuscule du jazz classique, voire du jazz tout court. Que cette hypothèse ne semble pas exorbitante, c’est déjà un formidable compliment. Une chose est certaine : l’alliance dans son art d’un phrasé fluide et d’une sonorité boisée promet à l’auditeur un de ces régals vers lesquels on irait en se traînant à plat-ventre.
- Le jour où Barney’s Concerto est mis en boîte, D.E. propose un aussi un Cootie’s Concerto, que l’histoire retiendra sous le titre de Echoes Of Harlem (s). A cette date, le trompettiste Charles Melvin “Cootie” Williams (1910-1985) était son partenaire depuis une demi-douzaine d’années. Il arrivait de chez Chick Webb, via le Fletcher Henderson Orchestra, après s’être produit avec, entre autres, l’orchestre familial que dirigeait le père de Lester Young. En 1940, il ne résistera pas aux propositions alléchantes de Benny Goodman, sous la direction duquel il travaillera une année durant. En 1962, ayant réussi tant bien que mal à se maintenir à la tête de ses propres équipes pendant plus de vingt ans, il reviendra vers Duke et lui restera fidèle jusqu’à la mort de ce dernier en 1974. Poète de la sourdine wa-wa (t), orfèvre des orages, horloger de la brutalité, Cootie Williams se révèle en outre le plus sombre des peintres de la lumière et le plus incandescent des jazzmen nocturnes. Il a fourni, et nous concluerons là-dessus, sa description et son explication personnelles du fonctionnement en coopérative des groupes ellingtoniens, grands ou petits (u) : “...l’argent nous était indifférent. Notre intention était d’avoir la possibilité de faire quelque chose, de donner des suggestions sur ce que l’orchestre ferait bien de jouer. Nous vivions ainsi. Tout le monde voulait être dans le coup et participer. C’était excitant et nous étions jeunes. ‘Fais comme ca, Duke, disions-nous. ça nous plaît comme ci et comme ça.’ Tout le monde donnait son avis, c’était une affaire de famille... Aujourd’hui, la plupart des musiciens ne se préoccupent que de leur salaire. Ils pensent : Qu’est-ce que cela va me rapporter? Il en résulte qu’il manque actuellement quelque chose sur le plan de la créativité : l’apport désintéressé de plusieurs cerveaux.”
A.G.
© FRÉMEAUX & ASSOCIÉS/GROUPE FRÉMEAUX COLOMBINI SA, 2001
(a) En 1985, dans le texte de présentation du double album RCA Jazz Tribune The Indispensable Duke Ellington and the Small Groups (aujourd’hui double CD 74321 155232).
(b) L’hypothèse est fragile.
(c) Les discographies ne précisent pas qui a arrangé quoi, sauf lorsqu’il s’agit du guitariste Brick Fleagle (cf. ici Love In My Heart). Celui-ci était un vieil ami de Rex Stewart. Il fournit des partitions à plusieurs formations dont celles de Fletcher Henderson, Chick Webb, Jimmie Lunceford. Pour Ellington, il travailla comme copiste.
(d) Cf. volume 1, CD I, plage 13. Le thème est attribué à Duke, à Irving Mills (comme souvent, bien que celui-ci l’ait sans doute découvert en entendant la formation le répéter) et à Harry Carney, auquel dès cette époque son patron ne détestait pas accorder quelques faveurs – et la cosignature d’un morceau promis au succès présentait l’avantage d’être une faveur monnayable.
(e) Four et Tune Up, par exemple, seraient des créations de l’altiste et chanteur de blues Eddie “Cleanhead” Vinson. “Miles, raconte ce dernier, se trouvait à Kansas City et avait besoin d’élargir son répertoire. Il me demande : ‘Dis, vieux, est-ce que je peux prendre ceux-là ?’ Et moi : ‘Bien sûr. N’oublie pas d’y mettre mon nom.’ Je n’avais pas pris la peine de déposer le copyright... Nous nous sommes rencontrés souvent depuis et nous sommes toujours copains ! Oh, il a voulu me rembourser à plusieurs reprises, mais j’ai toujours décliné cette offre : j’aime trop sa façon de jouer.” (Extrait d’un entretien avec Brian Priestley dans Melody Maker, le 3 juin 1972).
(f) Cf. texte de présentation du précédent volume.
(g) Cf. vol. 1, CD II, plage 14.
(h) Cette interprétation figure dans Ballads In Jazz (FA 022, CD II, plage 11).
(i) Le 17 octobre 1930. Cf. vol. 1, CD I, plage 12.
(j) Le 19 décembre 1936, par les Jazzopators de Barney Bigard.
(k) Cf. le coffret Quintessence qui lui a été consacré (FA 216). Cette anthologie comportant, de Jeep’s Blues à Things Ain’t What They Used To Be, ses plus mémorables pièces en petite formation avec D.E., nous n’avons pas jugé nécessaire d’en faire figurer ici d’autres qui, quoique superbes (Goin’ Out The Back Way) ne les valent pas tout à fait.
(l) Faut-il rappeler qu’il fut à la fois “The Brute” (l’un de ses surnoms) et, après Hodges, le grand sensuel de l’orchestre?
(m) On doit lire et relire les pages inspirées qu’Alain Pailler lui consacre dans son livre.
(n) Ses interventions peuvent frapper l’auditeur, comme dans Indigo Echoes ou Love In My Heart, mais elles sont rares et parfois, en outre, des plus discrètes (Clouds In My Heart, Lament For A Lost Love). Dans la présente sélection, il ne prend pas le moindre chorus sur Goin’ Nuts, Tough Truckin’, Rexatious, Fat Stuff Serenade, My Sunday Gal, Mobile Bay, Subtle Slough, Menelik, Stompy Jones, A Lull At Dawn, Echoes Of Harlem et Delta Mood,
(o) In texte de présentation du CD Anthology of Jazz Drumming Volume 2 1928-1935 (Masters Of Jazz MJCD 805).
(p) En 1959, il enregistra en compagnie du tromboniste Dicky Wells un microsillon impayable intitulé Chatter Jazz - The Talkative Horns Of Rex Stewart And Dickie (sic)Wells (CD RCA/BMG 74321 18525 2).
(q) Il était aussi batteur à ses heures, comme dans l’illustrissime séance des Feetwarmers de Rex Stewart à Paris, avec Django Reinhardt, le 5 avril 1939 (cf. Intégrale Django Reinhardt Vol. 9 - FA 309).
(r) Que lui-même détestait sans mesure !
(s) A ne pas confondre avec la version des Rug Cutters qui figure dans ce coffret, ni avec l’insurpassable Concerto For Cootie du 6 mars 1940 (cf. vol. 1, CD II, plage 9).
(t) Il ne l’adopta que parce qu’il devait prendre la succession de Miley.
(u) In The World of Duke Ellington, recueil de textes et d’entretiens réalisés par Stanley Dance (Charles Scribner’s Sons). Traduction d’Antoinette Roubichou pour l’édition française publiée en 1976 aux éditions Filipacchi.
english notes
The Piano Player Out Of The Band
As we all know, his instrument wasn’t the piano, it was the orchestra. When he came on stage, the colour and texture of the piece being played was completely modified. And when he set about improvisation on the keyboard, he treated the instrument as if it were an entire orchestra. The soloist Edward Kennedy ‘Duke’ Ellington can thus be considered as a pianist-cum-orchestra. When we study the pianist and his orchestra as two separate entities, we find the relationship is twofold and reciprocal. In the same way that the pianist in an orchestra is the pianist created by the orchestra, the man who plays the piano in an orchestra has ensured that the orchestra be fit for his development.Before 1953, when Duke stepped aside from his orchestra, he went about things in a somewhat detached manner which could be interpreted as a lack of ambition, as witnessed in Informal Blues and Fats And Furious (otherwise known as Lots O’Fingers). This does not imply that the musician was not self-demanding as far as his art was concerned as he often set himself challenges. He occasionally returned to conquered ground as in the pot-pourri of 21 December 1936 (Mood Indigo/Solitude), but this was rare. When he made the decision to take on a fresh piece of work, not matter its size, this man who always checked his aristocratic distance between the world and himself forever aimed for flawlessness. He was an excessive and obsessional perfectionist. Taking a step backwards can sometimes enable past achievements to be modified and improved, but Duke never did this.There were no half measures as far as Ellington was concerned – he felt obliged to put heart and soul into his projects.
The following points could account for this attitude. Firstly, he had been trained in the arduous school of stride where, during the twenties, non-stop competition was essential for survival. Several decades later, Sam Woodyard gave him the nickname of ‘Piano Red’ due to the way in which he heated up the keys. Moreover, as a creator, he remained in perfect control of any situation and even during the most turbulent of pieces he guided his way through without getting lost. Finally – and this is not contradictory – he had the knack of being unpredictable. Right from his debuting days, in the same way as Louis Armstrong, Fats Waller and others, he had to abide to the laws of showbiz and could not allow the audience to get bored. During the wild years of Prohibition, the punters wanted to be distracted in every sense of the term, thus providing an almighty challenge for the entertainer. And as Ellington considered that personal boredom was a mortal sin, he endeavoured to add ‘more variety and more fantasy’ to his style, as Hodeir noticed. This ranked him with other representatives of the genre – “pianists from the east coast, including Sticky Mac, Doc Perry and Willie ‘The Lion’ Smith were the pioneers, and James P. Johnson and Fats Waller were the high masters”, to again quote Hodeir. This raised him to the realms of the elite tinklers of the ivories. The same author commented that this style, “reflects a more complex musical personality, capable of covering wider horizons”.However, Hodeir’s analysis of the pianist was not always complementary : “Duke Ellington is certainly not a great pianist : his touch is rough, his technique is sometimes faulty... (He) plays with little precision.” But, “he can sometimes use the piano like a great musician.”It would seem as though Duke ignored his limited means and didn’t always abide by the rules of art, but put emphasis on the results.
His motto was first to succeed and then to experiment. He was a hasty genius. In this light, Hodeir’s reflections can be toned down.In fact, his touch was more pugnacious than rough, stemming from his will to succeed. His hands flew around the keyboard, eagerly watching out for obstacles. Given the urgent nature of his performance, small slip-ups could be forgiven. Duke remained lordly down to the core and as far as he was concerned the number had to tick over, following the intended route without it being perfect for so much. The path he chose was occasionally bumpy, but the traveller was nevertheless content after the journey.As a result of this contentment, there was never violence in his aggression, nor perfunctoriness in his haste. He preferred to extract the positive side of his zeal And this happiness has a direct relationship with his art as a pianist, giving him his distinct sonority, ‘The Ellington’s tone’. His sounds are weighty and yet draw you upwards, resulting in two contradictory yet complementary forms of giddiness. Some pianists have hands which dance on the keys, whereas others have a privileged relationship with the wire strings. Ellington, along with Monk and Eddie Costa, belongs to the rare circle whose concentration is fixed on the hammers, with all the chiselling and forging it involves.
The Small Bands
As Claude Carrière once wrote, “The ‘famous orchestra’ has never really been a big band like others. It is more of a big small band in one big orchestra, guided by the rich imagination of an inspired leader.” As Duke remained the boss in small gatherings. Little was issued under his name, apart from Tough Truckin’ and Indigo Echoes, but he still held the pen. Not only because he signed or co-signed a large number of tunes and was behind many arrangements, but he always managed to prompt or impregnate most music composed by others (apart from Goin’ Nuts perhaps), and controlled the development of events.In 1975 (that is after the death of the master), clarinettist Albany Barney Bigard complained to Melody Maker’s Max Jones that during the December 1927 to June 1942 period when he belonged to the D.E. Orchestra, he had written at least twelve titles, including worthy hits such as Stompy Jones, Clarinet Lament and even Mood Indigo, but was not sole proprietor of any copyright whatsoever. It would appear that along with Johnny Hodges, he even wrote Rockin’ In Rhythm, but neither creator is mentioned on the credit titles. His claim may well be founded, but Bigard neglected the fact that in all these pieces, the Ellington touch along with his essence are present. It is obvious that Duke had a mighty word to say in the creations of his clarinettist. Indeed, if Bigard had remained as sideman with King Oliver or Luis Russell, would he have considered writing such pieces? Most probably not.Of greater importance was the ambiguous relationship between the big band and the smaller offspring which emerged. More modest aggregates often spring from huge polyphonic ensembles, but the diminished Ellingtonian bands are not only reduced – but can be considered as intensified versions of the big band. Indeed, miniaturisation often permits a deeper and more intimist dimension, without implying for so much that the pieces performed by the entire orchestra were superficial.
Yet the intimate Ellington had a vulgar, threatening streak at the same time as being refined. His capacity to combine these two facets formed one part of his genius. Moreover, he was capable of imparting this ambivalence to eminent members of his team, including trumpeter Cootie Williams, Bubber’s successor in 1929, Ben Webster from 1942-43 and drummer Sonny Greer.According to Williams, who was still close to Duke when he passed away, the team spirit in the Ellington set-ups, both large and small, was vital. Money was not the essential issue to them, but each member participated in the family affair with enthusiasm.In the rhythmic section of small bands, Duke occasionally kept a low profile, but his importance was never forgotten. When he hid behind his soloists, it was not to eclipse, but to gather his strength. When he withdrew, he became more apparent. The Ellingtonian radiance continued to glow.
Adapted by Laure WRIGHT from the French text of Alain Gerber
© FRÉMEAUX & ASSOCIÉS/GROUPE FRÉMEAUX COLOMBINI SA, 2001
CD Duke Ellington The Quintessence © Frémeaux & Associés (frémeaux, frémaux, frémau, frémaud, frémault, frémo, frémont, fermeaux, fremeaux, fremaux, fremau, fremaud, fremault, fremo, fremont, CD audio, 78 tours, disques anciens, CD à acheter, écouter des vieux enregistrements, albums, rééditions, anthologies ou intégrales sont disponibles sous forme de CD et par téléchargement.)